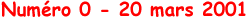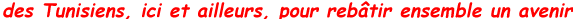es manifestants du 9 avril 1938, qui sont tombés
nombreux en martyrs, scandaient « Parlement
tunisien ! ». Ils inscrivaient leur combat dans la
continuité de leurs prédécesseurs, les patriotes
nourris des principes constitutionnels. Depuis le début de la
renaissance tunisienne, il y a 150 ans, les réformateurs
résumaient leurs revendications en la réclamation de
l'État de droit.
es manifestants du 9 avril 1938, qui sont tombés
nombreux en martyrs, scandaient « Parlement
tunisien ! ». Ils inscrivaient leur combat dans la
continuité de leurs prédécesseurs, les patriotes
nourris des principes constitutionnels. Depuis le début de la
renaissance tunisienne, il y a 150 ans, les réformateurs
résumaient leurs revendications en la réclamation de
l'État de droit.
Le penseur tunisien Ibn Abi Dhiaf écrivait
au milieu du XIXe siècle : « il existe deux genres
de pouvoirs, le pouvoir absolu et le pouvoir lié par une
loi » et il réclamait une constitution et des lois. Il
reprenait ainsi l'essentiel du message du fondateur de la Tunisie
moderne, Khéreddine,
développé dans son livre
écrit en 1868, « Essai sur les réformes
nécessaires aux États musulmans » (traduit par M. Morsy,
publié à l'époque à Paris et
réédité en 1987 par Edisud, Tunis, traduit
aussi, en son temps en Turc et en Persan)
Ce n'est pas par hasard que le premier parti de la
lutte pour l'indépendance ait été appelé
Parti Libéral Destourien (Constitutionnel), puis
néo-Destour. Dans l'esprit de tous les combattants, les
objectifs de liberté, d'indépendance et d'État de droit
étaient intimement liés.
Dès les premières années de
l'indépendance, en 1959, la Constitution est venue
répondre à cette aspiration populaire, en instaurant un
régime de séparation des pouvoirs et en affirmant
clairement le principe de l'indépendance de la justice. Mais,
sur ce chapitre comme sur celui de toutes les libertés
publiques, les constituants se sont contentés de poser des
principes et ont confié à la loi le soin d'en fixer les
modalités d'application. Malheureusement, avec la
complicité des uns et la résignation des autres, le
législateur n'a pas respecté les idéaux pour
lesquels les « pères fondateurs » ont combattu.
Il est un principe international, admis depuis
longtemps par tous les juristes dignes de ce nom, qu'il n'y a pas de
justice indépendante sans deux garanties essentielles :
l'inamovibilité des juges et la non-interférence du
pouvoir exécutif dans la gestion de la carrière des
magistrats.
En Tunisie, ces deux garanties font défaut.
Le principe de l'inamovibilité des magistrats n'a jamais
été posé. Les juges peuvent à tout moment
être mutés. Ensuite, leur carrière est
décidée par un conseil supérieur de la
magistrature dont la majorité des membres sont nommés
par l'exécutif. Dès lors, la Constitution a beau
proclamer que la justice est indépendante, cette affirmation ne
correspond à aucune réalité. Elle signifie
simplement que le gouvernement ne peut pas orienter la
décision du juge par un ordre officiel et avoué.
Théoriquement, les magistrats doivent
appliquer la loi en toute impartialité. Mais ils ont besoin de
la garantie que, s'ils statuent selon leur conscience, cela n'aura
aucun inconvénient pour eux-mêmes. Le juge, comme tout
homme, a ses intérêts légitimes à
sauvegarder et une tranquillité personnelle à assurer.
Il doit pouvoir rendre la justice honnêtement sans craindre une
réaction du pouvoir exécutif, réaction qui
pourrait causer un drame pour lui et pour sa famille.
Prenons le cas d'un magistrat qui exerce ses
fonctions dans une grande ville. Son conjoint exerce une autre
fonction dans la même ville. Dans cette même
localité, leurs enfants poursuivent leur scolarité. La
famille habite la maison que le magistrat a achetée grâce
à un crédit dont il rembourse les
échéances tous les mois. S'il fait l'objet d'une
mutation dans une ville lointaine, même sous la forme d'une
promotion à un grade supérieur, cette mutation va
bouleverser sa vie, déranger son bien-être, le couper de
sa famille et lui occasionner des dépenses que son budget ne
pourra pas supporter. Bien plus, il est légitime pour les
magistrats d'espérer avoir une bonne carrière,
c'est-à-dire le bénéfice des promotions qu'il
mérite. Le pouvoir exécutif ne doit disposer d'aucun
moyen pour gêner cette carrière. Autrement, il serait
à même de punir ceux qui refusent par exemple de
réprimer les auteurs de délits politiques injustement
poursuivis.
Le statut des magistrats n'est donc pas de nature
à garantir l'indépendance de la justice. Nous exigeons
du juge qu'il se comporte en héros chaque fois que nous lui
demandons de se prononcer en toute honnêteté dans les
affaires « sensibles ».
Cette mauvaise législation est
héritée du temps de Bourguiba. Rien d'étonnant.
Ce dernier avait une ligne politique claire. Il a milité pour
l'indépendance. Puis, il a construit l'État et dirigé la
nation avec des objectifs bien précis et clairement
déclarés : développement et modernisation.
Il ne se présentait pas en champion de la démocratie. Un
des secrets de sa réussite est peut-être sa
sincérité. Son attitude était cohérente.
Son action était, dans l'ensemble, conforme à sa
parole.
Aujourd'hui, les choses ont changé. Les
autorités parlent tous les jours de démocratie et de
droits de l'homme, de « l'État de droit et des
institutions ». Alors, d'une certaine manière, nous sommes
plus à l'aise pour exiger une profonde réforme du statut
de la magistrature puisque nous ne demandons que l'application des
professions de foi du régime. Mais, d'un autre coté, la
revendication était plus aisée par le passé
(avant et pendant le Protectorat) quand il n'y avait ni conseil
supérieur de la magistrature ni principe constitutionnel
d'indépendance de la justice.
En Tunisie, comme dans la plupart des pays arabes,
les précurseurs réclamaient une constitution et des lois
pour lier les autorités et mettre fin aux abus. Les gouvernants
autoritaires ont alors trouvé la parade. Partout ont
été adoptées des constitutions et des lois. Mais,
ce n'est qu'un décor, car, à travers les textes
d'application des beaux principes posés, on a
aménagé des moyens techniques pour vider les principes
de leur contenu et poursuivre l'exercice du pouvoir absolu.
En somme, la revendication de l'État de droit est
toujours d'actualité. Le principal changement est qu'elle passe
désormais par la tâche plus difficile de la
dénonciation des décors démocratiques.