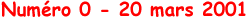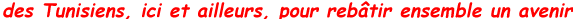l y a le livre et il y a la pièce, Néjia
Zemni et Jalila Baccar-Fadhel Jaïbi, Discours d'un
schizophrène et Jounoun. La pièce a fait
connaître le livre dont elle se veut l'adaptation
théâtrale. Mais parlent-ils tous deux de la même
chose ? De l'un - le livre - à l'autre - la
pièce - ne s'opère-t-il pas un furtif glissement
de sens qui crée l'interespace où se construit le regard
du metteur en scène, espace à nouveau reconduit de la
scène au public ?
l y a le livre et il y a la pièce, Néjia
Zemni et Jalila Baccar-Fadhel Jaïbi, Discours d'un
schizophrène et Jounoun. La pièce a fait
connaître le livre dont elle se veut l'adaptation
théâtrale. Mais parlent-ils tous deux de la même
chose ? De l'un - le livre - à l'autre - la
pièce - ne s'opère-t-il pas un furtif glissement
de sens qui crée l'interespace où se construit le regard
du metteur en scène, espace à nouveau reconduit de la
scène au public ?
Car, de même, le spectateur voit-il la
même chose que ce que Baccar-Jaïbi ont voulu mettre
à nu ? Finalement, entre celle qui a écrit ce texte
et ceux qui l'ont adapté pour la scène, y a-t-il eu
communication réelle avec effet de feedback sous-tendant
l'existence d'une codification commune du langage et des
idées ? A-t-elle eu lieu de la scène au
public ? L'enthousiasme soulevé par Jounoun qui en
fait l'événement théâtral de la saison
n'est-il pas un peu surprenant, d'autant que la pièce
dérange les valeurs sociales en cours ? D'où la
question : l'objet pour lequel s'émeut un public par
ailleurs averti de la chose intellectuelle et théâtrale
est-il celui-là même dont ont voulu traiter Fadhel
et Jalila dans Jounoun ?
De quoi souffre donc Noun dans la pièce et
dans le livre ? De l'enfermement, mais de l'une à l'autre,
s'agit-il du même enfermement ?
Pour Néjia Zemni, inscrite dans le courant
anti-psychiatrique des années 60-70, l'enfermement est celui de
la psychiatrie - avec ses méthodes
pontifiées - et de l'asile - avec son univers
carcéral - d'où les tentatives de la
psychothérapeute de soigner son malade à
l'extérieur des murs de l'asile : dans la famille comme
une replongée dans une identité de bas, salutaire
à la reconstruction de la personnalité, et dans certains
lieux sociaux - un café, une plage, le cabinet de la
psychothérapeute dans la mesure où celui-ci ne s'inscrit
pas dans l'univers asilaire. La sortie du malade de l'asile et de la
médicamentalisation, chère à la psychiatrie,
n'est-elle pas une des conditions de la guérison ? Une
des conditions seulement, car l'enfermement est dans les traumatismes
que porte Noun comme autant de stigmates, des perversions et
déviances sociales (y compris celles vécues au sein de
la famille)
Or, dans Jounoun, l'enfermement est total et
l'individu Noun n'échappe pas aux multiples formes de
quadrillages : c'est l'asile, certes, mais c'est d'abord la
famille, les rapports sociaux, fondés sur les rapports
d'autorité et de pouvoir, qui autorisent et justifient tous les
abus ; c'est Noun lui-même dans ses limites, ses
hésitations et ses dérives. À ce titre, l'asile
n'apparaît plus que comme la caricature outrancière de ce qui
se vit au quotidien dans le social.
Dans Jounoun, l'enfermement est sur la
scène elle-même, dans les rideaux qui dissimulent les
coulisses comme autant de barreaux, dans l'estrade qui limite l'espace
scénique. Et nous assistons au double mouvement de Noun, allant
vers la mer pour fuir l'enfermement et de l'acteur, descendant de
l'estrade pour se fondre parmi les spectateurs et s'y perdre.
Noun est donc malade d'enfermement, celui de
l'asile, celui du social, mais aussi celui de l'image de
déraison qu'il lui renvoie et qui constitue le seuil de
l'inaudibilité de son discours.
Quant au public, il est placé face à
la scène, dans cet autre lieu d'enfermement, fait des murs de
la salle, des fauteuils dans lesquels il est installé et
surtout de son statut de spectateur-voyeur, acteur passif d'un drame
qui se déroule sous ses yeux ; lieu d'enfermement
différent à la fois de celui où évolue
Noun et de celui où évolue la pièce.
Extérieur à l'espace scénique, extérieur
à l'espace de la folie, extérieur aussi à
l'espace d'enfermement du milieu social dans lequel se meuvent les
personnages, quelle communication peut-elle s'établir entre le
spectateur et l'acteur, le public et la pièce ? N'est-ce
pas au contraire à la faveur d'un deuxième glissement de
sens, d'une distance établie de prime abord, que se construit
cet autre enfermement de l'enthousiasme du public, de son
émotion qui semble dire qu'on comprend, qu'on saisit, qu'on
adhère, mais qui en fait pourrait dire aussi autre chose :
que Noun, c'est l'Autre. Que le drame qui se joue est celui des
Autres.
Et l'émotion elle-même
déclenchée ne l'est-elle pas à la manière
dont on peut éprouver enthousiasme, admiration pour les luttes
des Autres, pour les révoltes des Autres ? Elles peuvent
emporter nos adhésions, nos passions même, parce que nous
y voyons, peut-être, le reflet de ce que nous voudrions
être, que nous ne sommes pas, que nous ne serons jamais, que
nous n'identifions pas comme Nous. Et si Jalila et Fadhel ont voulu
signaler que nous évoluons tous dans des univers d'enfermement
que nous forgeons parfois de nos mains ou qui sont, pour nous tous, le
produit d'un univers social quadrillé, est-ce bien le message
reçu par le public ? Et la chute des rideaux de la
scène est-elle perçue comme la tombée des
barreaux de Noun ou comme celle de nos propres barreaux ?
Pourtant, l'espace de la pièce et de la
scène est lui-même un espace non homogène, lieux
où s'enchevêtrent, où se côtoient des
espaces d'enfermement qui semblent à peine communiquer :
celui de Noun, celui de l'asile, celui de la famille, mais aussi celui
d'une psychothérapeute évoluant entre ombre et
lumière et dont les vêtements stricts et les paroles
contrôlées sont des frontières derrière
lesquelles explosent mal - mais explosent quand même
parfois - ses passions et ses révoltes et se meut cette
relation étrange et violente entre médecin et son
malade, une femme et un homme ; n'est-ce pas alors au point de
rencontre de ces multiples non-communications que se joue le destin
de la folie ?
Subversive, Jounoun l'est. Qui brouille les
cartes de la normalité et de l'anormalité, de la
rationalité et de l'irrationalité ; qui nous
signale que des millénaires après la naissance de
l'humanité, les rapports humains sont encore emprunts de cette
sauvagerie animale à peine dissimulée sous les rapports
d'autorité et de pouvoir les plus communément admis par
la société. Pouvoir du parent sur l'enfant, du
père sur la mère, de l'homme sur la femme, de
l'aîné sur le cadet, du travailleur sur le chômeur,
du policier sur le délinquant, du médecin sur le malade,
du gardien sur le prisonnier, de l'État sur le citoyen. Et c'est
pourtant sur les ronces de cette sauvagerie et à l'interstice
du normal et du pathologique, de l'acceptation et du refus, que
naît la plus belle des poésies, que fleurissent les plus
beaux des mots, ceux de Mnaouar Smeidah et ceux de Noun.