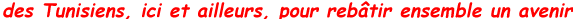Nadia Omrane : Au vu du rapport économique et social dont vous avez assuré la
coordination, quelles sont à votre avis les urgences qui seront au coeur des
négociations sociales ou qui devraient être l'objet de grands débats de société
où l'UGTT aurait son mot à dire ?
Hassine Dimassi : Je pense que ce qui est le plus urgent et nécessaire pour l'UGTT, c'est de rénover,
voire de reconstruire, ses bases, qui demeurent en grande partie encore assommées par
le vide étouffant qu'a subi cette centrale syndicale durant les années 90. Car, quels que
soient ses choix et ses revendications, l'UGTT ne pourrait pas les défendre et les
concrétiser avec des bases affaiblies et déboussolées.
 Cette reconstruction des bases implique d'abord un combat pour reconquérir la liberté
de l'action syndicale, sérieusement érodée depuis le début des années 80. Cette
reconstruction des bases nécessite aussi une véritable décentralisation du militantisme
syndical, en impliquant les fédérations, les régions et les syndicats de base, non
seulement dans les décisions corporatistes mais aussi dans les grands débats de
société. Cette reconstruction exige enfin que l'accent soit mis sur la recherche et la
formation des cadres, afin d'élever le niveau des débats et de rationaliser les
revendications. Car, face à la terrible complexité des problèmes socio-économiques qui
se posent aujourd'hui, les structures de l'UGTT restent entachées par ceux qui vivent
encore sur des creux slogans d'antan ou par ceux qui se comportent en de « simples
soldats de position ».
Cette reconstruction des bases implique d'abord un combat pour reconquérir la liberté
de l'action syndicale, sérieusement érodée depuis le début des années 80. Cette
reconstruction des bases nécessite aussi une véritable décentralisation du militantisme
syndical, en impliquant les fédérations, les régions et les syndicats de base, non
seulement dans les décisions corporatistes mais aussi dans les grands débats de
société. Cette reconstruction exige enfin que l'accent soit mis sur la recherche et la
formation des cadres, afin d'élever le niveau des débats et de rationaliser les
revendications. Car, face à la terrible complexité des problèmes socio-économiques qui
se posent aujourd'hui, les structures de l'UGTT restent entachées par ceux qui vivent
encore sur des creux slogans d'antan ou par ceux qui se comportent en de « simples
soldats de position ».
Quant aux grands débats de société où l'UGTT aurait son mot à dire, ils sont
nombreux. Cependant, trois de ces débats retiennent l'attention.
Le premier de ces débats est relatif aux implications majeures de l'accord de libre-
échange avec l'Union européenne. Car en signant cet accord, la Tunisie a engagé,
consciemment ou inconsciemment, son devenir. Afin d'acquérir une capacité de
résistance aux répercussions de cet accord, les travailleurs devraient saisir l'ampleur de
cet enjeu en débattant de ses origines, de ses buts, de ses règles et des profonds
bouleversements susceptibles d'être provoqués. Sur ce plan, l'UGTT a déjà fait un
pas respectable, en réalisant une vaste étude sur ce thème (en 2000) et en lui
consacrant une de ses « universités d'été ». Mais le chemin reste encore long, car les
contraintes générées par cet Accord ne sont pas des contraintes de conjoncture mais
plutôt de structure.
Le second de ces débats est celui concernant le rôle régulateur de l'État. Le discours
dominant tout au long des années 90 a été de ceux qui voulaient substituer au « tout-
État » le « tout-marché ». Actuellement, ce discours, démenti par les faits,
s'essouffle, et la raison humaine penche de plus en plus vers le « mieux d'État ». Les
travailleurs devraient donc être en mesure d'orienter les grands choix de l'État, afin de
rééquilibrer la charge fiscale et de rationaliser l'allocation des ressources publiques. Ce
chantier est vaste et ardu, car il soulève des questions complexes mais vitales pour
l'avenir du pays, telles celles des prélèvement fiscaux, de l'endettement de l'État, des
entreprises publiques, de la sécurité sociale, de l'éducation et la formation, de la santé,
des transferts sociaux,...
Le troisième grand débat est celui de la liberté, et j'entends par là la liberté tout court.
Car la liberté n'est pas divisible, et on ne peut concevoir une liberté syndicale sans une
liberté d'organisation et d'expression dans le sens commun des termes. Et en l'absence
de cette liberté, tous les grands débats de société, dont je viens de citer quelques uns,
demeurent biaisés et donc viciés. Autrement dit, sans liberté, la boussole-débat devient
elle-même déboussolée.
En tout cas, à travers les débats, les travailleurs devraient, pour l'essentiel, pouvoir
prendre conscience qu'aujourd'hui nous transitons historiquement non d'une phase à
une autre mais d'une époque à une autre. En effet, sur le plan socio-économique (et ce
n'est pas peu de chose), nous sommes en train de glisser d'un processus
d'accumulation extensif (vice) régulé par l'État (atout) à un processus d'accumulation
extensif (vice) régulé par le marché extérieur (vice). Les travailleurs devraient pouvoir
tenir, du moins en partie, la barre, pour que le processus soit le moins vicié possible.
L'espoir étant de pouvoir engager un jour un processus d'accumulation intensif (atout)
régulé par l'État (atout). Remarquons que le langage que je tiens ici paraît un peu
barbare pour le commun des citoyens, mais c'est justement là où réside la nécessité
d'une liberté d'expression et de réflexion.
N.O. : La première inquiétude des salariés est l'emploi. Pouvez-vous nous
avancer un taux de chômage crédible ? Quels sont les secteurs qui sont déjà ou
qui seront les plus touchés ? Que dire du chômage des jeunes, surtout des
jeunes diplômés ? Est-il vrai qu'en proportion, il y a parmi les chômeurs un
plus fort taux de diplômés que par le passé ? Qu'en déduire ?
H.D. : Oui, l'emploi tend à devenir une préoccupation de plus en plus angoissante pour
les salariés. En effet, jusqu'au milieu des années 90, le chômage touchait pour
l'essentiel les travailleurs non organisés, composés des primo-demandeurs d'emploi et
de la main d'oeuvre banale en majorité occasionnelle et saisonnière. Or, depuis la seconde
moitié des années 90, suite à l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, la
privatisation d'un grand nombre d'entreprises publiques et la modification de la
législation du travail dans le sens de plus de flexibilité, des salariés permanents plus ou
moins qualifiés et bénéficiant d'une certaine ancienneté sont devenus exposés à leur
tour au risque du chômage. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'UGTT a posé pour
la première fois et de façon sérieuse la question d'une « caisse de chômage »,
revendication en gestation vu son importance pour un grand nombre de travailleurs
menacés par le licenciement.
D'après la dernière source officielle (l'enquête population-emploi de 1999), le taux de
chômage de la population active âgée de 15 ans et plus est de l'ordre de 16.2%.
Durant le dernier tiers de siècle (1966-1999), ce taux de chômage a eu tendance à se
stabiliser entre 15% et 16%, ce qui signifie que, constamment et pendant longtemps,
environ un actif sur six a été à la recherche d'un emploi, et ce malgré la louable
politique active et volontariste de l'État en matière d'emploi, visant à temporiser le
fléau du chômage et du sous-emploi. Toutefois, en termes absolus, le volume de
chômage n'a cessé de se gonfler pour atteindre plus d'un demi-million en 1999 contre
environ 166 000 en 1966. Si on ajoute à ces chômeurs les sous-employés (ceux qui
travaillent moins de six mois par an), ce volume aurait atteint environ 870 000 en
1999, soit l'équivalent de 27.7% de la population active.
Certes, comparé à celui d'autres pays similaires (l'Algérie par exemple où le taux de
chômage atteint actuellement 30% sans compter les sous-employés), le chômage n'a
pas encore atteint en Tunisie un seuil intolérable. Cependant, dans la décennie à venir,
ce chômage risque de s'y amplifier à un rythme difficilement maîtrisable, suite non
seulement aux sauts technologiques en cours et à la large ouverture des frontières sur
l'économie mondiale, mais aussi à l'accentuation de la rupture entre le système
éducatif et le marché de travail.
À moyen terme, l'activité qui semble être la plus exposée aux risques résultant de ces
mutations technologiques et géopolitiques est celle du textile et plus particulièrement
de la confection ; activité qui emploie actuellement presque la moitié du total des actifs
occupés dans les industries manufacturières.
Par classe d'âge, le chômage touche surtout les jeunes de 18-29 ans qui, en 1999, ont
représenté 68% du total des chômeurs âgés de 18 à 59 ans. En fait, cette tendance
n'est pas nouvelle en Tunisie, puisque, depuis les années 60, ces jeunes ont toujours
constitué entre 60% et 75% du total des chômeurs.
Ce qui est vraiment nouveau, c'est l'amplification du chômage parmi les sortants de
l'enseignement supérieur. En 1999, le nombre de chômeurs ayant un niveau
d'instruction supérieur a atteint plus de 21 000, soit 4.7% du total des chômeurs, alors
qu'en 1975 ce type de chômage était insignifiant (400 et 0.2%). En l'absence d'une
refonte radicale du système éducatif, cette tendance, qui a débuté à partir du milieu des
années 90, risque de devenir alarmante.
N.O. : Notre système d'enseignement a-t-il un taux de rendement interne
acceptable ou ne produit-il que des défaillants et futurs chômeurs ? Que penser
de l'employabilité de nos diplômés ? Avons-nous un enseignement, surtout
supérieur, en phase avec les exigences d'une économie mondialisée ?
H.D. : Depuis le début des années 80, le rendement interne de notre système éducatif
semble connaître, du moins en apparence, une nette amélioration. Ceci se reflète à
travers la baisse des taux d'abandon du primaire et du secondaire, d'une part, et la
hausse des taux de réussite dans les examens des fins des cycles (l'ex-sixième, le
baccalauréat et les maîtrises), d'autre part. Cependant, cette apparente amélioration du
rendement interne de notre système éducatif ne résulte pas d'une amélioration du
niveau cognitif des élèves mais plutôt d'un certain laxisme dans le passage d'un cycle
d'enseignement à un autre.
En tout cas, l'efficience d'un système éducatif se mesure beaucoup plus par sa
rentabilité externe (degré d'adéquation de ses sortants avec les besoins du marché de
travail) que par sa rentabilité interne. Or, nous vivons actuellement une quasi-rupture
entre notre système éducatif et le marché de travail. Cette rupture se manifeste surtout
par le gonflement rapide de la masse de chômeurs titulaires d'un diplôme de
l'enseignement supérieur.
Durant le quart de siècle compris entre 1960 et 1985, nous avons vécu en Tunisie une
économie protégée et administrée dans laquelle l'État jouait un rôle central de
régulation. De ce fait, les sortants de l'enseignement supérieur ont été absorbés sans
difficultés, essentiellement par l'administration et les entreprises publiques et dans
une moindre mesure par certaines professions libérales de rente (médecins,
pharmaciens, avocats,...). Depuis le milieu des années 80, alors que le pays transitait
d'une économie protégée et administrée à une économie ouverte et libéralisée, le
système éducatif a continué à produire les mêmes profils de diplômés du supérieur
prévalant au début de l'indépendance. Ce qui est étonnant et préoccupant, c'est qu'au
lieu de réformer radicalement notre système éducatif afin de l'adapter à la base aux
profondes mutations en cours, on continue à attendre que les étudiants achèvent
leurs études dans des maîtrises révolues (à l'âge de 25 à 26 ans), pour tenter de les
recycler à la hâte et de manière improvisée, au prix d'une charge supplémentaire
prohibitive pour la collectivité.
N.O. : Le pouvoir d'achat des Tunisiens s'est-il vraiment détérioré depuis une
quinzaine d'années ? Si oui, comment expliquer la consommation effrénée des
ménages ? Par l'endettement ? Y aurait-il, au plan de la qualité de vie, une
Tunisie à deux vitesses ?
H.D. : Oui, par comparaison à son niveau du début des années 80, le pouvoir d'achat des
salariés tunisiens (et non des Tunisiens) s'est sensiblement détérioré. En effet, le
pouvoir d'achat des salariés a atteint son maximum en 1983 ; depuis, il n'a jamais
retrouvé ce niveau. Actuellement, le pouvoir d'achat des salariés est presque
équivalent à celui qui prévalait en 1977.
La grande chute du pouvoir d'achat des salariés a eu lieu entre 1984 et 1989, suite au
démantèlement brutal de l'UGTT, et par là au blocage systématique des salaires
nominaux. Depuis 1990 et jusqu'à nos jours, l'on a opté pour une révision régulière à
la hausse des salaires nominaux, dans le cadre d'accords triennaux entre l'État,
l'UTICA et l'UGTT. Des augmentations des salaires sont décidées d'avance pour trois
ans, sans référence à aucun indicateur macroéconomique (hausse des prix à la
consommation, gains de productivité, croissance du PIB,...). Cette politique salariale,
suivie depuis le début des années 90, a permis de stopper la dégradation du pouvoir
d'achat des salariés, sans contribuer à l'améliorer.
Depuis dix ans, l'on semble effectivement vivre un paradoxe en Tunisie : d'un côté on
assiste à une stagnation du pouvoir des salariés (qui constituent la majorité des
consommateurs), et d'un autre coté, on observe une consommation effrénée des
ménages. Ce paradoxe est vraiment à étudier.
De ma part, je pense que ce paradoxe résulte, entre autres, de trois facteurs combinés :
le laxisme dans l'octroi des crédits à la consommation, en particulier ceux accordés par
les organismes de sécurité sociale (CNSS et CNRPS) pour l'acquisition de voitures et
de l'électroménager ; la diffusion sur une large échelle des ventes par facilité ; et le
repli de l'épargne surtout des jeunes générations. Celles-ci tendent à vivre au jour le
jour sans trop se préoccuper de l'avenir. Si ces impressions s'avèrent vraies, cela
signifie que nous évoluons vers une société qui « mange son blé en l'herbe ».
En Tunisie, je ne pense pas que nous sommes déjà dans une société à deux vitesses du
point de vue qualité de la vie. Mais dans l'avenir, cette tendance n'est pas à exclure. La
marginalisation d'une partie croissante de la jeunesse, la stagnation, voire la régression,
du pouvoir d'achat des salariés, la diffusion des emplois instables et précaires, le sur-
endettement des ménages, leur pressurisation fiscale excessive et la marchandisation des
services publics de base (enseignement, santé, transport,...), constituent tous des
facteurs qui pourraient contribuer à briser la classe moyenne, c'est-à-dire la colonne
vertébrale de la société. C'est là où se situe le risque d'aboutir à une société à deux
vitesses ; société ni viable ni vivable.
N.O. : Le droit égal à la santé va-t-il se perdre avec la réforme de l'assurance-
maladie ? Et d'une façon générale, l'État se désengage-t-il de la protection
sociale ?
H.D. : Je ne pense pas que la réforme de l'assurance-maladie en cours va mettre
totalement fin à un certain droit à la santé (et pas au droit égal à la santé qui d'ailleurs
n'a jamais existé). La preuve, c'est que l'UGTT n'est pas contre cette réforme à
quelques modifications partielles près. En fait, cette réforme constitue un certain frein
à la tendance de la marchandisation totale de la santé. C'est pour cette raison que les
médecins et le pharmaciens privés sont les plus opposés à cette réforme, car se sont
eux qui s'en sentent les plus lésés. Je crois qu'au-delà des mécanismes de l'assurance-
maladie, un certain droit à la santé ne pourrait demeurer comme acquis qu'en
préservant, voire en renforçant, le service de santé public d'une qualité acceptable.
En Tunisie, l'État ne s'est pas encore désengagé de la protection sociale même si
certains signes par-ci par-là le laissent penser. Au contraire même, durant les deux
dernières décennies, l'État n'a fait que renforcer son rôle de protection sociale.
Plusieurs programmes et fonds d'aide et de solidarité sont venus s'ajouter aux
transferts classiques en matière d'éducation, de santé et de sécurité sociale. D'ailleurs,
il n'y a pas pire pour un État, qui puise l'essentiel de sa légitimité plutôt des
transferts sociaux que des urnes, que de se désengager totalement de la protection
sociale.
Toutefois, comme un peu partout dans le monde, l'État évolue sur « le fil de rasoir »,
car, tout en le privant de certaines de ses ressources principales (droits de douane,
impôts sur les bénéfices des sociétés exportatrices, rente pétrolière, etc.), on lui
impose simultanément deux nouvelles exigences : préparer l'économie du pays à faire
face à plus de concurrence sauvage sur un marché mondial (plus et mieux
d'infrastructure de base, de télécommunications, de formation des ressources
humaines...), d'une part, et prendre à sa charge les retombées néfastes de la
mondialisation (chômage, appauvrissement, marginalisation), d'autre part. Dans ce
contexte ambigu et contradictoire, l'État peut glisser vers un sur-endettement intenable
qui le poussera à se métamorphoser imperceptiblement d'un acteur de protection
sociale en un acteur de répression sociale.
N.O. : En prenant un peu de distance et en se projetant dans l'avenir, l'UGTT
devra-t-elle hausser la barre de la revendication sociale ou accepter que les
salariés fassent les frais d'une plus grande rigueur budgétaire, sous peine de
voir la Tunisie s'engager vers une pente dangereuse à l'Argentine ?
H.D. : Si l'UGTT accepte que les salariés fassent les frais d'une plus grande rigueur
budgétaire, elle perd non seulement son rôle régulateur mais sa raison d'être même. De
même, dans le contexte actuel, l'UGTT n'a pas intérêt à hausser la barre de la
revendication sociale au delà d'une certaine limite, au risque d'être lamentablement
brisée. Il faut avoir présent en tête que la Tunisie, avec tous ses acteurs y compris
l'État, n'est pas isolée du reste du monde et qu'elle est en plein dans le tourbillon qui
désarçonne l'humanité. Je pense que, dans l'état actuel des choses, la mission de
l'UGTT consiste à militer pour préserver sans grands dégâts les intérêts acquis des
salariés.
N.O. : L'UGTT aura-t-elle une grande marge de manoeuvre dans la négociation
sociale ou se retrouvera-t-elle coincée entre des contraintes économiques et des
pesanteurs politiques ?
H.D. : Au cours des prochaines négociations sociales (à partir de mars 2002), l'UGTT
aura à manoeuvrer dans un contexte tendu, miné par deux positions en apparence
justifiées. Celle de l'UTICA qui penchera vers un blocage des salaires et une plus
grande flexibilité de l'emploi, au nom de la concurrence et de la compétitivité ; et celle
de l'État qui rechignera à réviser les salaires de l'Administration et des entreprises
publiques, au nom d'une nécessaire austérité budgétaire.
Dans ce contexte, la position de l'UGTT devrait s'élever d'un simple discours de
revendication corporatiste à une persuasion sociétale. Dans ce sens, l'UGTT devrait
être en mesure de convaincre les autres partenaires sociaux :
- Que les bas salaires, en tant que coût de production, ne constituent plus, du
moins à eux seuls, un avantage comparatif de compétition ; et que la
compétitivité s'acquière aujourd'hui par d'autres avantages, tels la créativité,
l'économie d'échelle, la qualité des produits, la rapidité dans l'exécution et la
livraison, la transparence entre les partenaires sociaux et entre l'État et la
société, l'absence de la pesanteur bureaucratique,...
- Que le patronat n'a aucun intérêt à figer, voire à comprimer, le pouvoir d'achat
des salariés, c'est-à-dire à casser la demande solvable interne, dans l'espoir
(chimérique d'ailleurs) de conquérir plus de marchés externes. L'histoire a
prouvé qu'aucune économie ne peut durablement progresser sur une seule
béquille à savoir l'exportation.
- Qu'on ne peut rien attendre de bon des accords de libre-échange avec l'Union
européenne, tant que ces accords sont menés en rangs dispersés par les pays
arabes, et tant que l'Union européenne est déchirée entre des intérêts de
« quartiers » et des intérêts de continent.
- Que l'État n'a aucun intérêt à figer durablement le niveau de vie de ses
fonctionnaires, car, dans ce cas, il risque de se mettre sur le dos son propre
appareil d'exécution.
N.O. : Quel peut être le rôle des intellectuels, ou du moins des universitaires,
dans l'élaboration d'une stratégie syndicale ? Le syndicalisme tunisien est-il
favorable et disposé à intégrer des intellectuels critiques qui l'aideront à
définir une stratégie pour les années à venir et à poser l'UGTT comme la
locomotive d'un changement social ?
H.D. : Rappelons d'abord qu'au cours des années 70 et la première moitié des années 80,
l'UGTT n'a pu jouer son éminent rôle régulateur que grâce, entre autres, à l'appui des
intellectuels et plus particulièrement des universitaires, non seulement en tant que
force de revendication, mais aussi et surtout en tant que soutien d'analyse et de
réflexion. Par contre, si durant les quinze dernières années l'UGTT s'est beaucoup
affaiblie, c'est parce qu'elle s'est désistée, entre autres, de ce soutien de réflexion.
Le départ de Sahbani, et surtout le dernier congrès le l'UGTT ayant introduit plus de
diversité-complémentarité dans sa direction, redonnent l'espoir dans la ré-édification
d'une centrale syndicale jouant réellement son rôle en tant qu'acteur régulateur.
Un grand nombre d'intellectuels critiques sont disposés à l'épauler dans l'élaboration
non d'un programme économique et social (l'UGTT n'est pas un parti politique) mais
plutôt d'une stratégie de résistance face aux menaces et aux défis potentiels d'avenir.
Ce soutien des intellectuels ne dépend que d'une seule condition : que l'UGTT
demeure un champ de libre expression.