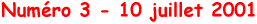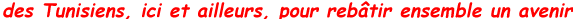'investissement dans le capital humain, par le biais de l'éducation,
est un des plus précieux acquis de la Tunisie indépendante. La
démocratisation, jointe à la gratuité jusqu'à ces dernières années, de
l'enseignement a cependant le revers de sa médaille. Les effectifs
sont pléthoriques dans le premier cycle (enseignement de base de 9
ans) et même dans le second cycle jusqu'au baccalauréat. Différents
mécanismes de filtrage, ramenant au 2/3 le taux de réussite au bout
des neuf premières années (toutefois, ce taux s'est amélioré jusqu'à
80% cette année) ainsi qu'une sélection très sévère au bac (un taux de
63% maximal de réussite), enfin, une orientation rigoureuse (et
parfois mécanique et à courte vue) des bacheliers ne peuvent empêcher
que l'enseignement de masse soit le lot de l'université tunisienne.
Toutes les projections ont été déjouées jusqu'ici, mettant à mal les
prévisions budgétaires. Il y a aujourd'hui 210 000 étudiants (dont 51%
sont des filles, telle est la dernière conquête des femmes) et l'on
attendrait pour 2005, selon tous les analystes, un effectif de
420 000
à 500 000 étudiants. Enfin, une prévision alarmante du mathématicien
Mohamed Jaoua envisage un million d'étudiants en 2010, chiffre que les
pouvoirs publics ramènent à 700 000 ou 800 000. Cette formation
supérieure serait une victoire, si l'intendance suivait au plan des
budgets d'équipement et de fonctionnement et si le rendement interne
et externe de l'université était efficient.
'investissement dans le capital humain, par le biais de l'éducation,
est un des plus précieux acquis de la Tunisie indépendante. La
démocratisation, jointe à la gratuité jusqu'à ces dernières années, de
l'enseignement a cependant le revers de sa médaille. Les effectifs
sont pléthoriques dans le premier cycle (enseignement de base de 9
ans) et même dans le second cycle jusqu'au baccalauréat. Différents
mécanismes de filtrage, ramenant au 2/3 le taux de réussite au bout
des neuf premières années (toutefois, ce taux s'est amélioré jusqu'à
80% cette année) ainsi qu'une sélection très sévère au bac (un taux de
63% maximal de réussite), enfin, une orientation rigoureuse (et
parfois mécanique et à courte vue) des bacheliers ne peuvent empêcher
que l'enseignement de masse soit le lot de l'université tunisienne.
Toutes les projections ont été déjouées jusqu'ici, mettant à mal les
prévisions budgétaires. Il y a aujourd'hui 210 000 étudiants (dont 51%
sont des filles, telle est la dernière conquête des femmes) et l'on
attendrait pour 2005, selon tous les analystes, un effectif de
420 000
à 500 000 étudiants. Enfin, une prévision alarmante du mathématicien
Mohamed Jaoua envisage un million d'étudiants en 2010, chiffre que les
pouvoirs publics ramènent à 700 000 ou 800 000. Cette formation
supérieure serait une victoire, si l'intendance suivait au plan des
budgets d'équipement et de fonctionnement et si le rendement interne
et externe de l'université était efficient.
Cela n'est pas le cas. Les économistes considèrent que le coût
unitaire de l'étudiant a été ramené à la baisse (quelques 1300
dinars). Mais des calculs plus fins font apparaître de désolantes
différences entre les investissements destinés aux facultés,
véritables usines, et ceux accordés aux pôles d'excellence privilégiés
que sont quelques instituts préparatoires, quelques écoles
polytechniques. Ainsi, selon un rapport fait par des enseignants-chercheurs de la Faculté de sciences de Tunis, le coût d'un de leurs
étudiants serait 50 fois moindre que le coût d'un étudiant de l'École
polytechnique de Tunis (135 dinars et 7000 dinars respectivement).
Répercutées sur les conditions de travail, ces béances financières des
grandes facultés aggravent la détérioration des conditions de travail
sur lesquelles les pouvoirs publics voudraient jeter un cache-misère
(informatique, net learning...).
Le rendement interne de ces usines à broyer les jeunes espérances
s'affiche en conséquence : selon le même rapport (précité), un
étudiant sur deux quitte l'université sans formation qualifiante ou
sans diplôme. Le redoublement (il faudrait en moyenne 2, 4 années pour
accomplir une année universitaire) surcharge encore plus effectifs et
dépenses.
De cette logique d'échec, installée au coeur du processus
universitaire, il faut accuser une orientation universitaire peu
judicieuse et castratrice des potentialités, un encadrement
pédagogique numériquement déficient et qualitativement souvent
problématique : en effet, le recrutement des enseignants-chercheurs
bat de l'aile (insuffisance des postes ouverts et même pas entièrement
pourvus), affectation d'enseignants-technologues qui marginalisent les
enseignants-chercheurs et détachement de maîtres d'enseignement
secondaire amenant à une véritable secondarisation de l'enseignement
supérieur.
Les pôles d'excellence échappent-ils à cette déliquescence ? Certains
fleurons sont sans doute préservés, tel l'Institut préparatoire aux
études scientifiques et techniques (IPEST) dont l'efficacité est
attestée par la réussite d'au moins 50 étudiants par an aux épreuves
écrites des concours d'entrée aux grandes écoles françaises. L'oral
est une autre affaire, car d'une façon générale pour les écoles
d'ingénieurs ou les maîtrises valorisées, l'enseignement y est très
académique, dispensé au pas de charge, mobilisant sans répit les
étudiants. Il n'en est pas moins, à quelques égards, obsolète dans sa
formation méthodologique, vétuste dans ses programmes et conduit
souvent par des enseignants dont les meilleurs sont besogneux, mais
qui ne bénéficient d'aucun système d'évaluation, d'aucun environnement
scientifique stimulant et de très peu d'occasions de mise à niveau
(stages ou années sabbatiques à l'étranger).
Comment s'étonner dès lors que les diplômes de second cycle ou
d'ingéniorat tunisiens bénéficient de si peu de considération et que
même les majors de promotion, candidats à des DEA étrangers
performants, soient soumis à refaire une année de mise à niveau aux
normes universitaires d'outre-mer. Cette retrogradation des meilleurs,
appelés à passer sous ces fourches caudines pour intégrer un bon
laboratoire étranger, n'est-elle que le produit d'un racisme
anti-maghrébin ? Hélas non, et les meilleurs des professeurs
tunisiens, conduisant ici des études doctorales le savent bien !
Toutefois, il n'est pas bon de crier sur les toits et même, consigne
est donnée pour la rétention des étudiants qui veulent s'échapper du
giron national par une somme de petites chicaneries (notes et diplômes
délivrés avec des retards inadmissibles qui font rater les délais
d'inscription).
Mais pourquoi nos jeunes, peu diplômés ou brillants, partent-ils ? En
dehors du bol d'air citoyen qu'ils cherchent sous d'autres cieux - ce qui
ouvre des chapitres de griefs et de récrimination - du strict point de
vue universitaire, puis professionnel, ils ont tout à gagner en
partant.
D'abord, ils sentent bien le décalage de leur enseignement tunisien et
de leur environnement intellectuel avec ce qu'ils entrevoient
ailleurs. Ils l'éprouvent chaque jour dans le détail des incohérences,
des archaïsmes, des passe-droits, de l'étouffement, de la répression
de la parole, de l'injustice, de cette manière obtuse, au péril de
l'avenir du pays, qu'on a de leur couper les ailes. Sur cet aspect, le
réglement est global, il porte un seul nom : démocratie. De plus en
plus, les langues se délient et cherchent à mettre à plat les
problèmes gravissimes de la formation des jeunes dans l'intérêt même
du pays.
Cependant, la conduite des autorités n'est pas seule à mettre en cause
et il faut reconnaître des initiatives méritoires de certains
responsables, auxquels n'est pas laissée une très grande marge de
manoeuvre.
Ce qui prend en tenaille et annule le volontarisme positif, c'est
aussi la transition libérale dont les jeunes diplômés sont « les
perdants », selon les mots de la Banque Mondiale. Il y a aujourd'hui
près de 20 000 diplômés dont le taux d'insertion professionnelle est
très préoccupant.
La faillite du système public, soumis à privatisation, et le passage à
l'économie de marché à laquelle les PME tunisiennes ont du mal à
s'adapter (2/3 devraient prendre l'eau) engloutissent les jeunes
demandeurs d'emploi dans une mer de désespérance. La fonction publique
- notamment l'enseignement, la magistrature et
l'administration -
posent les goulets d'étranglement des concours. La petite technicité
(bac+2 au niveau du DEUG ou des filières courtes plus qualifiantes)
est davantage recherchée, car elle a peu de prétentions salariales.
Une étude de l'économiste tunisien Said Ben Sedrine (publication de
l'IRMC, CNRS) démontre que ces techniciens sont préférés aux
ingénieurs gestionnaires (bac+5) car sous-payés, ils sont plus
dociles et peuvent accomplir un surplus de formation à l'intérieur de
l'entreprise. Pour exemple, ce sont les ingénieurs qui attendent le
plus longuement un emploi (42 mois !) et les plus malheureux sont les
ingénieurs agronomes que les propriétaires de grandes terres
domaniales, bradées par l'État aux privés, ravalent au statut de
jardiniers. Les pouvoirs publics aident par la formule de stage
d'insertion (SIVP) moyennant ristourne aux patrons, lesquels rajoutent
rarement leur quote-part à ce salaire d'attente ! Autant dire que ces
cadres dits de « l'excellence », devenus corvéables, n'ont qu'une
envie, celle de fuir, d'autant que les stages leur apprennent rarement
autre chose que servir le café ou jouer au manutentionnaire !
Encore faut-il que l'Europe ou les Amériques leur ouvrent les bras.
Les conditions de visas ou d'inscriptions sont draconiennes et très
onéreuses. Aussi apparaît-il ce phénomène nouveau et inquiétant,
signalé par Vincent Geisser (in Stratégies sociales et itinéraires
migratoires, éd. CNRS, 2000) : les diplômés partent aussi en
clandestins, cachés dans les cales des navires ou entre des caisses
d'oranges ! Mais quand ils arrivent et s'accrochent à leur destin,
s'ils ne finissent pas en dealers ou ne reviennent pas dans cercueils
plombés, alors ils forment à l'étranger une diaspora compétente et
créative, la plus grande chance de la Tunisie.