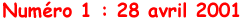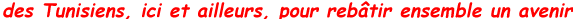n ce mois de célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse
et 45 ans après l'indépendance du pays, il est impérieux de nous
demander aujourd'hui pourquoi notre paysage médiatique et
journalistique s'est subitement affadi. Comment tous ces espaces de
débats et d'expression qui assouvissaient notre curiosité et notre
soif d'apprendre, ont-ils été réduits à néant ? Comment toutes ces belles
et étincelantes plumes qui reflétaient à merveille la fine fleur de
cette Tunisie ouverte et moderne en soient condamnées à l'exil sous
toutes ces formes ou astreintes à une conversion professionnelle forcée ? Et le comble aujourd'hui, voilà que toute opinion contraire, toute
analyse qui tranche avec cette uniformité ambiante qui règne, devient
l'objet de méfiance et d'attaques, parfois des plus abjectes humiliations...
n ce mois de célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse
et 45 ans après l'indépendance du pays, il est impérieux de nous
demander aujourd'hui pourquoi notre paysage médiatique et
journalistique s'est subitement affadi. Comment tous ces espaces de
débats et d'expression qui assouvissaient notre curiosité et notre
soif d'apprendre, ont-ils été réduits à néant ? Comment toutes ces belles
et étincelantes plumes qui reflétaient à merveille la fine fleur de
cette Tunisie ouverte et moderne en soient condamnées à l'exil sous
toutes ces formes ou astreintes à une conversion professionnelle forcée ? Et le comble aujourd'hui, voilà que toute opinion contraire, toute
analyse qui tranche avec cette uniformité ambiante qui règne, devient
l'objet de méfiance et d'attaques, parfois des plus abjectes humiliations...
Au même moment, des pays voisins s'ouvrent au pluralisme des idées et
au débat contradictoire, et des Tunisiens, de plus en plus nombreux, ont recours aux nouvelles technologies de communication via la
« clandestinité immatérielle », pour s'informer et exercer leur
citoyenneté. Mais comment sommes-nous arrivés à un tel degré
d'indigence du débat d'idées et de discrédit de nos médias ?
Je me permets de réitérer l'idée que le principal obstacle à
l'épanouissement de notre presse résulte de cette mainmise pesante et
étouffante de l'État - mais aussi de tous ceux qui s'expriment en son
nom - sur tous les rouages de l'information et de la circulation des
idées. En plus du secteur de l'audiovisuel complètement sous la
tutelle de l'État, le secteur de la presse écrite qui, en théorie, est
censé être autonome, n'échappe pas pour autant à son emprise. Il en est
ainsi du droit de faire paraître un titre, d'accéder aux sources de
l'information, de mettre en circulation le journal via les sociétés de
distribution, de tirer profits de la manne publicitaire, des
abonnements, de bénéficier des subsides de l'État.
Dans tous les cas,
le propriétaire d'une publication se trouve assujetti à un « code de
bonne conduite » non écrit, constitué de variables - explicites mais
aussi implicites - dictées par des contingences politico-personnelles
du moment. Tout directeur de journal - quelle que soit la nature de la
publication qu'il dirige - doit nécessairement être à l'affût des
interprétations possibles qui découlent de l'application officielle de
ce code à un moment précis. Il doit, ce faisant, faire preuve de
beaucoup de flair pour naviguer dans ces eaux troubles. Et tout risque
de chavirement entraîne de lourdes sanctions qui peuvent tout autant
être directes, comme l'interdiction de paraître, qu'indirectes, comme
le refus de la société de diffusion de distribuer le journal ou,
carrément, la fermeture de la pompe publicitaire ou la résiliation des
abonnements. Dans un tel environnement, la surenchère, la flagornerie
d'un côté, la désinformation et les effets contre-productifs de
l'autre, sont légion, et les notions de « privé » et de « public » ou
encore, de presse « indépendante » ou « d'opposition », se trouvent diluées
dans cette étatisation rampante de la société. Et à partir de ce
constat, toute approche légaliste basée sur une énième refonte des
dispositions du code de la presse s'avère d'une totale inefficacité si
l'on ne circonscrit pas au préalable, pour les mettre à nu, tous ces
mécanismes invisibles de censure et d'autocensure, engendrés par ce
« code de conduite ».
En conséquence, pour qu'une volonté s'exprime aujourd'hui pour faire
évoluer ce secteur en stimulant le débat d'idées contradictoires et en
renouant avec cette presse plurielle et captivante, il faut, au
préalable, nous défaire à jamais de ce système particulièrement
pernicieux en nous employant à désétatiser l'information. Autrement
dit, il est inadmissible aujourd'hui que ceux qui parlent et agissent
au nom de l'État se permettent de régenter l'information, la presse et
les journalistes à leur guise. Des dispositions légales, mêmes les
plus libérales en cette matière, ne peuvent produire les effets
escomptés en l'absence de structures de contre-pouvoir à même de se
déployer en toute quiétude pour arrêter et dénoncer les dérapages, d'où
qu'ils viennent.
Et dans cette perspective, il devient urgent d'envisager la création
d'une structure de la communication qui soit réellement l'émanation de
la société et non de l'État, à qui reviendra le droit d'organiser et
de protéger ce secteur contre toute forme de mainmise. Elle veillera
scrupuleusement à la protection de la liberté de communication, à
l'éthique et la déontologie qui découlent de l'exercice de cette
liberté, et statuera sur tout abus ou manquement commis par
l'administration ou le privé en cette matière. Une telle structure
devra comprendre des personnes élues par toutes les représentations des
corporations qui exercent dans ce secteur. Elle devra bénéficier de
toute l'indépendance mais aussi de la transparence nécessaire tant dans
son fonctionnement que dans la prise des décisions. Autrement dit,
l'autorité, la compétence et le rayonnement de cette structure
indépendante à créer dépendra en premier lieu de la légitimité qu'elle
acquerra aux yeux des citoyens, et non de l'État.
Or, il ne fait pas de doute, au regard de la configuration actuelle du
secteur des médias et de la communication, que l'État demeure encore le
principal, sinon l'unique acteur. Et toute la question qui mérite
d'être posée est de savoir si, à la longue, la société à travers toutes
ses composantes citoyennes, peut se mouvoir et se développer en
dehors des structures de l'État pour gérer et organiser ce secteur
vital de la vie sociale.
En attendant, la première manifestation de cette volonté de
désétatisation pourrait déjà provenir de la suppression du régime des
récépissés, en permettant à toute personne qui en a fait et qui en fera
la demande de se voir accorder aussitôt le droit de publier son journal.
Une chose est sûre : il importe d'accepter et de concrétiser l'idée que
le monde de la communication et de la presse ne peut s'épanouir que
dans un espace public où l'État coexistera avec la société et non dans
une société complètement absorbée par l'État.
Pour conclure, il me paraît tout autant nécessaire, en ce jour de
commémoration, de rappeler ces titres prestigieux, comme Le Phare, Er-raï, Le Maghreb, le dernier en date 7 sur 7, et bien d'autres,
qui avaient été la préfiguration de cette Tunisie plurielle, tolérante
et intelligente à laquelle nous restons toujours attachés. Il importe
aussi de nous remémorer l'action de ces journalistes et intellectuels
de renom qui exprimaient avec verve et pugnacité toutes nos attentes,
qui secouaient nos esprits tout en les éclairant par leurs plumes
acerbes et alertes. Je voudrais leur adresser une pensée affectueuse,
pleine de reconnaissance pour leurs actions audacieuses,
particulièrement à celles et ceux qui ont été acculés à un exil - sous
toutes ses formes - faute de pouvoir exercer leur métier selon leur
conscience et leur éthique, et principalement, à notre ami Kamel
Labidi, à qui je souhaite vivement son retour proche parmi nous.