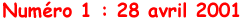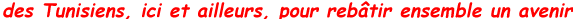a littérature tunisienne est d'abord une littérature orale. Les jeunes
trouvent des
possibilités de s'exprimer sur le plan littéraire. Les clubs existent
dans les Maisons de la
culture. Les concours abondent. Une émission radiodiffusée leur est
consacrée. On organise des
festivals qui permettent à celles et ceux de l'intérieur de participer à
l'activité de création.
Des prix sont attribués aux plus méritants.
a littérature tunisienne est d'abord une littérature orale. Les jeunes
trouvent des
possibilités de s'exprimer sur le plan littéraire. Les clubs existent
dans les Maisons de la
culture. Les concours abondent. Une émission radiodiffusée leur est
consacrée. On organise des
festivals qui permettent à celles et ceux de l'intérieur de participer à
l'activité de création.
Des prix sont attribués aux plus méritants.
La littérature tunisienne est ensuite une littérature de presse. Ceux
qui ont pu émerger des
instances précédemment citées voient leurs textes publiés dans les
divers organismes écrits qui
diffusent en Tunisie. Il n'est pas rare de voir des quotidiens et des
hebdomadaires réserver une
page entière à la production littéraire. Celle-ci est alors étudiée par
des « critiques » qui
apprécient diversement les qualités artistiques, mais plus souvent
morales (!) de ces écrits.
La littérature tunisienne contemporaine est enfin une littérature pour
la presse. Cela veut dire
que seront privilégiés les textes courts, à savoir poèmes et « nouvelles ». Sous le premier mot,
on trouve des vers de circonstance ou des jeux de mots. Sous le second,
on range des
contributions brèves, des « pensées », des impressions qui n'ont qu'un
lointain rapport avec ce
que l'on entend habituellement par la nouvelle.
Ainsi, pour l'écrivain, le club (comme le Club de la Nouvelle, fondé en
1964) et le journal sont
deux passages quasiment obligés pour se faire reconnaître sur la scène
littéraire tunisienne.
L'écrivain peut aussi participer aux multiples soirées littéraires au
cours desquelles il est
invité à déclamer un poème ou à lire un texte en prose, parfois
moyennant un chèque non
négligeable.
Parmi les organes de presse, la palme de la persévérance revient au
journal al-Sabâh (« Le Matin ») qui, à travers les trois régimes politiques que la Tunisie a connus
depuis cinquante ans, a
réussi à maintenir le flambeau d'une littérature classique, certes, mais
autonome et enracinée
dans le terroir.
Le passage de l'oral ou de l'article de presse au livre n'est pas aisé.
Pourtant plus de 700
Tunisiens l'ont réussi depuis l'indépendance du pays en 1956. Dans ce
chiffre, un nombre
respectable édite à compte d'auteur. En effet, l'auteur en est souvent
réduit à offrir son livre
pour qu'on parle de lui. Toute rentrée d'argent est exclue. Le but de
beaucoup de Tunisiens qui
publient à compte d'auteur est de pouvoir demander leur adhésion à
l'Union des Écrivains
Tunisiens. Fondée en 1971, cette organisation n'a jamais réussi à
acquérir une réelle notoriété
parce qu'elle est restée un rouage officieux du pouvoir en place,
recevant nombre de
mercenaires. Cependant, pour les auteurs, elle est une occasion de se
faire connaître. En effet,
l'Union anime des clubs dont ll'activité est de présenter et de
discuter des livres. La
majorité des auteurs arrête de publier après le premier ouvrage.
Après avoir franchi tous ces obstacles, peut-être que les quelques
maisons d'édition connues sur
la place accepteront de le publier sans contrepartie. La qualité de ces
éditions laisse souvent
à désirer. Les employés manquent de professionnalisme et les auteurs ne
savent pas, ou ne
veulent pas, corriger leurs textes. D'où le résultat mitigé offert au
lecteur. Pour les ouvrages
de pure création littéraire, le nombre d'exemplaires vendus reste très
faible. Le marché
tunisien ne constitue pas une possibilité de gain pour l'auteur. Sans
compter les déboires de
celui-ci avec son éditeur qui n'est pas toujours étouffé par les
scrupules. Il faut dire, à la
décharge de ce dernier, que le risque de perte financière est réel. En
2000, environ 120 livres
littéraires en arabe, tous genres confondus, ont ainsi vu le jour.
Pour ce qui concerne la critique, il y a un écart entre deux types.
D'abord le journaliste qui,
parfois sans lire l'ouvrage, publie un texte impressionniste ne
comportant aucune référence et
ne permettant pas de se faire une idée exacte du contenu et de la valeur
de l'ouvrage. On a là
affaire à des circuits. Tel auteur ne sera vanté que dans tel journal et
complètement ignoré de
tel autre. Ensuite le professeur d'université qui a de la difficulté à
se départir d'un langage
hermétique comportant des termes techniques copiés en Occident. Le
véritable vulgarisateur est
rare. Du coup, la production de l'écrivain n'est pas bien connue.
Parfois, la célébrité vient, non pas de la valeur du texte, mais de son
interdiction par la
censure. Officiellement, elle n'existe pas. En réalité, les éditeurs la
craignent comme la
peste. Elle peut se manifester de multiples manières et à tous les
stades de la fabrication du
livre. La plupart du temps, ce sera au moment du dépôt légal :
l'autorisation de publier ne
vient jamais. Il arrive aussi que la police saisisse dans les librairies
tous les exemplaires
imprimés. Pour éviter cette perte sèche, les éditeurs invitent les
auteurs à l'autocensure, ou
bien ils la pratiquent directement eux-mêmes.
Voilà le circuit habituel de l'écrivain tunisien. Reste que les bons
auteurs en font souvent
l'impasse. Quelques uns parmi les meilleurs ne font pas partie de l'Union.
Certains n'ont jamais
participé aux activités des clubs, ni publié de textes dans les
journaux. L'un ou l'autre édite,
à compte d'auteur, une oeuvre de qualité. Et c'est parmi eux que la
critique orientale sait
reconnaître les auteurs de valeur qu'elle attend du Maghreb.
En définitive, la situation sociologique de l'écrivain en Tunisie laisse
à désirer : des auteurs
cherchant à se faire un nom rapidement sans réelle volonté de continuer,
des éditeurs amateurs,
une distribution improvisée, des critiques inconscients des enjeux et ne
couvrant pas
systématiquement le champ d'investigation, une autocensure omniprésente.
Autant de facteurs qui
pèsent sur la classe moyenne de la littérature. Mais ils n'arrêtent pas
les bons auteurs qui,
malgré tout, arrivent à percer et à se faire ainsi reconnaître.