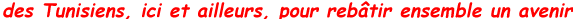'Union Générale des Étudiants Tunisiens (UGET) a célébré, durant la première semaine de
février, le cinquantenaire de sa création (février-mars 1952) conjugué à la commémoration
du 5 février 1972, date mythique en milieu étudiant tunisien puisqu'elle évoque le congrès
extraordinaire tenu par les étudiants en vue d'achever les travaux du congrès de Korba
d'août 1970, au cours duquel le pouvoir de Bourguiba avait, par l'interruption violente des
travaux, confisqué aux profits du PSD la centrale syndicale étudiante. Ce congrès
extraordinaire dont les travaux furent eux aussi interrompus par une répression brutale qui
avait abouti à l'arrestation et à l'emprisonnement de dizaines de militants étudiants et
d'extrême-gauche avait marqué la rupture par rapport au régime et l'accession de l'UGET à
l'autonomie par rapport au PSD.
'Union Générale des Étudiants Tunisiens (UGET) a célébré, durant la première semaine de
février, le cinquantenaire de sa création (février-mars 1952) conjugué à la commémoration
du 5 février 1972, date mythique en milieu étudiant tunisien puisqu'elle évoque le congrès
extraordinaire tenu par les étudiants en vue d'achever les travaux du congrès de Korba
d'août 1970, au cours duquel le pouvoir de Bourguiba avait, par l'interruption violente des
travaux, confisqué aux profits du PSD la centrale syndicale étudiante. Ce congrès
extraordinaire dont les travaux furent eux aussi interrompus par une répression brutale qui
avait abouti à l'arrestation et à l'emprisonnement de dizaines de militants étudiants et
d'extrême-gauche avait marqué la rupture par rapport au régime et l'accession de l'UGET à
l'autonomie par rapport au PSD.
C'est dire l'importance que revêt cette date en milieu
étudiant et la célébration de cette année devait revêtir, selon le programme élaboré par le
Bureau exécutif de l'UGET, la forme de manifestations diverses et débats autour de
l'histoire de l'UGET, de la mondialisation et l'emploi des jeunes, du devenir de la centrale
estudiantine. Malheureusement, certaines manifestations furent annulées, d'autres
dégénérèrent en violences verbales et physiques et l'ensemble des festivités se déroula dans
un climat d'affrontements et de règlements de comptes entre fractions militantes
contestataires du Bureau exécutif actuel et celui-ci, dont ces fractions contestent la
légitimité et qu'elles accusent de s'être allié avec les étudiants destouriens. Cette
atmosphère houleuse se déroule pourtant dans un climat d'indifférence de l'ensemble des
étudiants.
Des interrogations se posent alors : pourquoi cette indifférence des étudiants
par rapport aux conflits qui agitent les militants de l'UGET ? Pourquoi ceux-ci se
réduisent-ils aujourd'hui à une poignée d'étudiants ? Y aurait-il « dépolitisation » des
étudiants et manque d'engagement de leur part ? Pourquoi l'UGET est-elle plongée dans cette
crise qui fait que, tout en étant sans conteste l'organisation estudiantine de référence
pour les étudiants, elle n'arrive tout de même pas à les mobiliser massivement d'une façon
continue ? Le problème est-il inhérent à l'UGET, son fonctionnement, son programme et ses
militants ? Est-il inhérent à la jeunesse estudiantine, à une absence de combativité, de
perspectives ?
Ces interrogations et d'autres encore je me les suis posées dans une
discussion avec Habib Kasderli, historien et universitaire tunisien, ancien
militant de l'UGET qui fut sollicité par le Bureau exécutif pour une intervention sur
l'histoire de cette organisation. « Il y avait une cinquantaine d'étudiants présents car les
deux autres tendances d'extrême-gauche organisaient, au même moment, des manifestations pour
la Palestine. Les manifestations du cinquantenaire se passent un peu dans la
désorganisation », estime-t-il. « Il y a officiellement un programme du Bureau exécutif mais, à
chaque partie de ce programme, il y a problème. Le programme n'arrive pas à retenir
l'attention. Ajouté à cela que les contestataires au Bureau exécutif réclament l'ouverture
des adhésions et la tenue d'une Commission administrative qui destituerait l'actuel
Secrétaire général. Ils lui reprochent d'avoir participé à une table ronde organisée par le
journal Essabah où il y avait également un représentant des étudiants destouriens. D'où leur
affirmation qu'il a trahi un des mots d'ordre du mouvement étudiant qui est la rupture
politique et organisationnelle avec le pouvoir ».
Ces propos vont dans le même sens que
d'autres propos tenus par des étudiants qui rapportent que les contestataires au Bureau
exécutif accusent celui-ci de compromissions avec le pouvoir car il considère que les
étudiants destouriens ont leur place à l'UGET. Ici se trouve donc posé le problème de
l'autonomie syndicale et du sens qu'on lui accorde et qui, depuis de nombreuses années déjà
et jusqu'à aujourd'hui, peut se résumer par l'affirmation, souvent exprimée par des militants
étudiants : « l'UGET est à nous. Les destouriens n'ont pas à y être ». Y aurait-il là une
dérive grave dans la mesure où l'on peut considérer qu'en tant que syndicat, l'UGET est
ouverte à toutes les tendances politiques et que seul le jeu démocratique peut définir
celles qui sont les plus représentatives des aspirations estudiantines ? Sommes-nous au
contraire dans la continuité d'une histoire qui fait de l'UGET davantage une organisation
politique des étudiants, ayant pour objet de défendre un positionnement de la jeunesse
estudiantine sur la scène politique, qu'une organisation syndicale, ayant pour but de
défendre, en priorité, des revendications corporatistes en vue d'améliorer la qualité des
études et les conditions de travail de tous les étudiants comme leurs perspectives d'avenir ?
UGET : organisation politique ou syndicat ?
Les quelques éléments d'histoire fournis par Habib Kasderli pourraient sans doute donner
quelques pistes pour répondre à ces questionnements : « Il y a des événements fondateurs
comme l'affrontement, en février-mars 1952, entre les autorités coloniales et un mouvement
lycéen nationaliste naissant qui a été à l'origine de la création de l'UGET dont le premier
congrès s'est tenu en juillet 1953, à Paris ».
Ces événements fondateurs sont essentiellement
liés à la lutte anti-coloniale des lycéens puis des étudiants de l'Institut des Hautes
Études et à la création d'une coordination d'étudiants qui avait dirigé des grèves. Dans ce
mouvement, les destouriens étaient hégémoniques et parmi eux on peut citer Amar Mahjoubi et
Chtourou ; mais des communistes, comme Zakaria Harmel et Manoubia Lamri participaient aussi,
bien qu'ils n'étaient pas dans la coordination mais dans l'AET (Association des Étudiants
Tunisiens). Elle aurait servi, jusqu'en 1955, de façade légale pour les activités de
l'UGET, clandestine alors. La naissance de l'UGET en pleine lutte anti-coloniale était
marquée par la présence massive des destouriens qui étaient les plus actifs. C'est pourquoi
l'UGET a fourni des cadres à la fois pour la lutte nationale et pour la construction de
l'État moderne (sur 40 ministres de Bourguiba fournis par les organisations nationales,
l'organisation estudiantine a fourni à elle seule 19 ministres).
Dès sa naissance donc,
l'UGET se positionnait sur la scène politique par rapport à des revendications presque
essentiellement nationalistes et comme l'expression, en milieu lycéen et étudiant, de
l'idéologie du Néo-destour. Que depuis, l'UGET ait été considérée, par ce parti, comme une
bretelle en milieu étudiant, cela ne fait aucun doute et cela se concrétisa au Congrès de
Bizerte, en 1964, où l'on imposa la mise sous la tutelle du PSD de toutes les organisations
nationales. Or, depuis les années 60, les combats des étudiants non destouriens ou de gauche
avaient pour but de conquérir leur place au sein de l'UGET, monopolisée par les militants du
PSD, d'en faire une organisation représentative des intérêts des étudiants et non de ceux du
parti dont elle était sous la tutelle : c'est pourquoi l'ingérence du régime et du PSD fut à
Korba si violente car, pour la première fois depuis la constitution de l'organisation
estudiantine, une majorité démocratique et de gauche allait accéder à la direction.
De Korba
aux journées de février 1972 se consomma la rupture avec les destouriens et la
concrétisation de la construction d'une UGET autonome du pouvoir, représentée alors par des
structures syndicales provisoires et un Comité Universitaire Provisoire qui avaient pour
tâche principale de préparer le XVIIIe congrès, non achevé à Korba, et de reconquérir la
structure estudiantine, confisquée, à cette époque, par le PSD. Depuis, et jusqu'au XVIIIème
congrès tenu dix-huit ans après Korba (1988), le mouvement étudiant n'a eu de cesse que de
reconquérir la légalité de son organisation. « La nouveauté à cette époque, remarque H.
Kasderli, c'est que l'UGET a fourni des cadres pour la relève du mouvement démocratique.
Elle a joué un rôle de contestation même si elle était traversée par des courants politiques
parfois antagonistes ».
Usine de cadres du mouvement national avant l'Indépendance, usine de
cadre du mouvement démocratique après, cela n'est-il pas déjà un indicateur de l'identité de
cette organisation en milieu étudiant, historiquement plus politique que syndicale,
soucieuse de mobiliser la jeunesse autour de mots d'ordre nationalistes ou démocratiques
mais toujours dans la perspective du changement social, mettant en second plan les
aspirations strictement corporatistes des étudiants en tant que tels.
Avec de tels
objectifs, comment l'UGET n'aurait-elle pas fait l'objet de la répression d'un pouvoir
antidémocratique et des manipulations diverses en vue soit de limiter son influence, soit
de noyauter l'organisation de l'intérieur. Dans les années 1980, n'utilise-t-on pas le
mouvement intégriste pour limiter l'influence de l'extrême-gauche à l'Université ? N'est-ce
pas à la même période où le pouvoir autorise enfin la tenue du XVIIIe Congrès qui redonne à
l'UGET sa légalité, qu'il autorise aussi la légalisation de l'UGTE, créée et tenue par le
courant islamiste et qui l'aide à remporter les élection au conseil scientifique ? Cette
UGTE sera dissoute après l'interdiction de Ennahda mais elle laissa quand même, en milieu
étudiant, le souvenir de la mobilisation fanatique de ses militants et des affrontements
sanglants qui les ont opposés aux militants d'extrême-gauche. Alors, il est vrai
qu'aujourd'hui, lourdement marquéE par cet itinéraire, « l'UGET n'arrive plus à distinguer le
rôle d'un syndicat de celui d'une organisation politique.
La cause principale en est la
répression car le pouvoir a reconnu l'organisation mais ne lui laisse pas d'espace de
travail » (H. K.). Or, pourrions-nous opposer à cet argument que la mobilisation ne fut
jamais plus forte que dans les grandes répressions : du temps où les autorités coloniales
tiraient sur les manifestants, où les autorités de l'État indépendant emprisonnaient,
torturaient et condamnaient ? N'est-ce pas justement dans ces moments-là que les solidarités
se consolidaient, que les élites estudiantines étaient les plus créatives ? La répression
prend certes, aujourd'hui des formes plus subtiles/politique de la carotte et le bâton, - on donne d'une main, on reprend de l'autre -, on distribue la caresse et la punition. Et
puis, ne l'oublions pas, il y a encore des étudiants qu'on torture et qu'on emprisonne et,
jusqu'à dernièrement, cette manifestation d'autorité qui n'a pas de nom et qui mit en prison
pour plusieurs années et pour un simple délit d'opinion, des militants d'extrême-gauche
venus se livrer à la justice et parmi lesquels se trouve Hamma Hammami, Secrétaire général
du Parti Ouvrier Communiste Tunisien (POCT), organisation à ce jour non reconnue et l'un
de ceux, justement, qui ont fait les journées de février 1972.
Mais cette répression
peut-elle expliquer les luttes et les affrontements violents inter-tendances dans l'UGET ?
Explique-t-elle cette remarque d'un étudiant en médecine : « l'UGET ? je connais pas »,
cette autre d'un Ugétiste des années 1970 : « l'UGET fonctionne comme une secte ou un
groupuscule politique » et ce constat simple et objectif de H. Kasderli : « il y avait une
cinquantaine d'étudiants ». Si la répression ne saurait, à elle seule, expliquer la
situation actuelle, c'est alors que les causes sont à rechercher ailleurs. Y a-t-il
dépolitisation de la jeunesse estudiantine ? Évaluant numériquement les journées de février
1972, un militant de l'époque analyse la situation d'alors en ces termes : « sur le campus,
il pouvait y avoir plus d'un millier d'étudiants, assis par terre, en cercles de discussion,
des militants de choc. Nous étions plus d'une centaine, prêts à tout, nous savions les
risques que nous courrions, la police, la torture, la prison ; nous acceptions tout, nous
avions un idéal : la démocratie, la révolution comme on disait à l'époque. Nous avions un
ennemi, le PSD, le régime et sa police. Et puis, il y avait le Viet-nam, la Révolution
culturelle chinoise, la Palestine et, c'était hier pour nous, mai 1968. Tout cela a beaucoup
contribué à notre engagement ».
Cet engagement, est-il le même encore aujourd'hui par rapport
à la fois à la société tunisienne et aux grands événements du monde ? « Il faut conscientiser
les étudiants » dit ce militant de l'UGET. Car il est devenu courant d'entendre dire que la
jeunesse estudiantine est « dépolitisée », dépolitisation que Habib Kasderli définit comme « le
désintérêt de la chose publique et la chute des idéaux ». « Pourtant, continue-t-il, ils
savent ce qui se passe dans le pays et dans le monde, mais ils ne veulent plus s'engager.
C'est le passage de la connaissance à l'engagement qui fait problème mais ce phénomène
concerne tout le pays. Est-ce la peur ou est-ce le manque de confiance dans les
organisations et les hommes ? La peur, qui a pu naître après ce que les étudiants ont vu du
terrorisme intégriste à l'université d'une part, et de l'intégrisme comme objet de
répression d'autre part, est peut-être une des causes du désengagement. Mais le
désengagement, c'est aussi, je pense, le refus de croire aux choses inefficaces ».
Pourtant,
les étudiants poursuivent des études dans des conditions d'une précarité effarante :
insuffisance de foyers universitaires avec autorisation d'occuper une chambre de une à deux
années, alors que les études durent en moyenne cinq ans, restaurants universitaires
surpeuplés où la nourriture extrêmement insuffisante est parfois immangeable, bourses
insuffisantes et ne couvrant qu'à peine les frais de transport et de logement, conditions de
travail pénibles dans les facultés aux bibliothèques et amphi surpeuplés, insuffisance de
professeurs. Par ailleurs, l'un des principaux problèmes auquel les étudiants sont
confrontés est le chômage des diplômés auquel s'ajoute la dévalorisation de certains
diplômes (d'une façon générale, les maîtrises obtenues dans les facultés de lettres et de
droit et sciences économiques) due entre autres à la baisse vertigineuse du niveau
scientifique des étudiants et des contraintes du marché de l'emploi. Or, tous ces problèmes
sont très peu répercutés au niveau de l'UGET : « il est frappant qu'une université aussi
importante, il y a environ 230 000 étudiants, n'a pas d'expression syndicale estudiantine
et il est urgent qu'elle en ait une, vital pour les étudiants qu'ils aient une voix pour
s'exprimer sur la réforme de l'enseignement, sur le marché du travail et qu'ils aient un
outil pour améliorer leurs conditions d'existence » (H.K.). Pourquoi l'UGET ne joue-t-elle
pas ce rôle ? Et si la jeunesse estudiantine ne se reconnaît que très peu dans les luttes
menées aujourd'hui par leur centrale syndicale, pourquoi ne fait-elle pas pression pour que
les choses changent, pourquoi n'émerge-t-il pas, de l'absolu anonymat, de « la masse » comme
aiment à l'appeler les militants, une expression organisée dans laquelle elle se
reconnaîtrait ? Pourquoi cette jeunesse estudiantine donne-t-elle l'impression de subir
l'UGET comme le pays subit le parti au pouvoir, en espérant que cela change mais sans rien
faire pour cela ? Sans doute que les procédés utilisés à l'intérieur de l'UGET par les
fractions en présence et les violences, même si elles ne sont que verbales (mais elles ne
sont pas que verbales), dont les étudiants sont souvent les spectateurs et qui ont une
assez longue histoire dans le mouvement étudiant, ont-ils en quelque sorte « traumatisé »,
de génération en génération, les étudiants.
Sans doute, la pratique du rapport vertical
organisation-masse, militant conscient-étudiant non conscient, parole-silence, tout cela
matérialisé dans le verbe et la logistique utilisés par les militants de l'UGET et autres
militants en milieu universitaire, place-t-il définitivement les étudiants en situation de
mineurs et donc peu productifs d'idées, d'actions, d'initiatives, de contestation. Sans
doute aussi, s'est-il établi entre l'UGET et les étudiants une distance construite sur la
méconnaissance ou l'éloignement par rapport à leurs aspirations réelles qui a entretenu et
favorisé la sur-politisation-qui-exclut aux dépends de la syndicalisation-qui-rassemble.
Mais, au delà de toutes ces interrogations, n'est-ce pas surtout dans du neuf que veulent
tailler les jeunes étudiants, lassés et désabusés des médailles et des titres de gloire des
générations qui les ont précédés, des discours et des mots qui séduisent un temps mais dont
les promesses sont le plus souvent contredites par les alliances politicardes, le manque de
prise sur le réel, l'archaïsme des mots d'ordre et des modes d'organisation. Une jeunesse en
désarroi et dont l'énergie combative se heurte au mur de béton des affrontements
idéologiques face auxquels elle pourrait fredonner, comme le poète : « mourir pour des idées,
c'est bien beau, mais lesquelles ? ». Une jeunesse enfin qui réclame son droit au bonheur et
à la paix, partie intégrante de celle qui, de Gênes à Porto Alegre, s'élève contre la
mondialisation du Capital et la planétarisation de la violence.