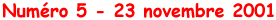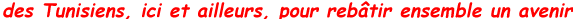u moment où l'on s'apprête à annoncer une nouvelle atteinte à la Constitution en vue de permettre la réélection du président Ben Ali, et où ceux qui s'opposent à cette démarche n'ont d'autre préoccupation que de prouver l'existence de successeurs capables de prendre le relais, il nous a paru important de réfléchir à ce que, grâce à de nombreuses retouches, la Constitution tunisienne donnait comme pouvoir au président de la République, pour déterminer si la priorité de l'heure est de réfléchir à la réhabilitation de la République, par un rééquilibrage des pouvoirs, ou bien s'il faut envisager de simples changements d'hommes.
u moment où l'on s'apprête à annoncer une nouvelle atteinte à la Constitution en vue de permettre la réélection du président Ben Ali, et où ceux qui s'opposent à cette démarche n'ont d'autre préoccupation que de prouver l'existence de successeurs capables de prendre le relais, il nous a paru important de réfléchir à ce que, grâce à de nombreuses retouches, la Constitution tunisienne donnait comme pouvoir au président de la République, pour déterminer si la priorité de l'heure est de réfléchir à la réhabilitation de la République, par un rééquilibrage des pouvoirs, ou bien s'il faut envisager de simples changements d'hommes.
Depuis son adoption par l'Assemblée nationale constituante en juin 1959, la Constitution tunisienne a connu 13 amendements plus ou moins importants, tant au niveau institutionnel que politique. L'ensemble des modifications a dénaturé le texte initial. Seul le premier chapitre relatif aux « Dispositions générales » était relativement préservé. Déjà fragilisée dans le « texte fondamental » original, la République a subi une progressive décomposition, aussi bien sous l'impact des révisions successives, que par une contre-nature républicaine de son fonctionnement : le parti unique instauré de fait depuis l'indépendance sans interruption significative.
Nous retiendrons trois grandes dates qui constituent, à notre sens, les trois révisions les plus décisives, qui ont permis au pouvoir en place depuis 1956 de remodeler, voire de dénaturer, le régime politique présidentiel et sa forme républicaine. Tout d'abord, la révision du 8 février 1976, à laquelle nous pouvons rattacher celle de 1975 accordant la présidence à vie à l'ancien président Bourguiba, ensuite celle de 1988 intervenue quelques mois après l'accession de l'actuel président au pouvoir le 7 novembre 1987, et enfin la dernière, qui date du 27 octobre 1997.
En 1974 Bourguiba venait d'entamer un nouveau mandat présidentiel après avoir été élu au suffrage universel direct, alors qu'il était candidat unique à sa propre succession. La même année un projet de révision de la Constitution fut déposé à l'Assemblée nationale, apportant un amendement permettant d'accorder au chef de l'État, en guise de remerciement et de reconnaissance, et à titre exceptionnel, la présidence à vie. Le projet sera voté en deuxième lecture en 1975.
La République, déjà souffrante sur le plan politique, entame, avec cette révision, un processus de démantèlement constitutionnel et institutionnel, qui allait se manifester de nouveau, quelques mois plus tard, le 8 février 1976. À cette époque le président Bourguiba affaibli par ses problèmes de santé, et surtout rassuré par son nouveau statut constitutionnel de président à vie, donne le feu vert à une refonte spectaculaire de la Constitution. La réforme permettait globalement au président de la République de se décharger de certaines de ses attributions sur le gouvernement, d'établir une répartition plus souple des compétences au sein de l'exécutif et de changer la nature des rapports entre l'exécutif et le législatif. Pour cela la moitié de la Constitution fut modifiée. Les changements les plus intéressants sont les suivants :
1- La « constitutionalisation » du gouvernement, qui ne faisait pas partie de la nomenclature constitutionnelle de l'État jusqu'à cette date, avait permis une parlementarisation trompeuse du régime politique, en raison du monopole absolu accordé au président de la République en matière de nomination du Premier ministre, et quasi absolu en matière de nomination des autres membres du gouvernement. Une majorité parlementaire même issue d'une hypothétique élection législative libre demeure inopérante. L'exécutif, même quand il est bicéphale, reste sous le contrôle infaillible du chef de l'État.
2- L'allégement des charges constitutionnelles du président de la République avait permis d'évacuer plusieurs compétences vers le gouvernement et surtout vers le Premier ministre, dans de multiples domaines. Il s'agit surtout de charger le gouvernement de la mise en oeuvre de la politique générale de l'État, et pour cela le Premier ministre s'est vu placé à la tête de l'appareil administratif, bénéficiant en sus du monopole de la force publique. Par ailleurs, Le Premier ministre va se voir attribuer une compétence réglementaire par voie de délégation, il va pouvoir suppléer le président de la République à la présidence du Conseil des ministres et contresigner les décrets du chef de l'État avec le membre du gouvernement concerné. Le nouveau statut constitutionnel du Premier ministre le rapproche de celui d'un vice-président, surtout qu'il est désormais suppléant du président en cas d'empêchement provisoire, et l'article 57 en fait même le successeur automatique en cas de vacance de la présidence.
3- La responsabilité politique de l'exécutif devant le pouvoir législatif devrait, en théorie, permettre au Parlement de contraindre le gouvernement à démissionner en votant une motion de censure. Via un mécanisme assez compliqué techniquement, voire utopique politiquement, il est même capable de renverser le président de la République. Le président détenait en contrepartie le pouvoir de dissoudre la Chambre des députés. La révision de 1976 ressemblait alors à un réaménagement interne et à une simple « constitutionalisation » de multiples usages imposés par l'émergence d'une seconde figure à la tête de l'État, celle de l'ex-Premier ministre Hédi Nouira. Même si le président de la République a dû approuver cette nouvelle donne, il a sauvegardé par ailleurs l'essentiel des pouvoirs, et il est resté l'axe fondamental du régime politique présidentiel que les constitutionnalistes qualifiaient déjà de « présidentialiste ». Ainsi, en s'appuyant sur des pouvoirs constitutionnels excessivement larges, sur un législatif coopérant et dominé, sur un pouvoir judiciaire entièrement dépendant et sur un pervers système de parti unique, le régime a pu se maintenir jusqu'en 1987.
Le 7 novembre 1987 le peuple tunisien s'est réveillé sur une nouvelle « ère républicaine ». En annonçant, dans sa fameuse déclaration de destitution de Bourguiba, l'abolition de la présidence à vie, le nouveau président de la République ne s'est pour autant pas démarqué de l'ancien régime, il s'est présenté au contraire comme son légitime héritier. L'abolition de la présidence à vie ouvrait certainement la voie à un sauvetage in extremis de la République, mais ceci n'était certainement pas suffisant, une tâche ardue attendait le pouvoir en place. Des thèmes comme la concentration et le déséquilibre des pouvoirs constitutionnels, la dépendance de la justice, l'imbrication de l'appareil de l'État et celui du parti au pouvoir, l'absence de transparence administrative et financière, les violations systématiques des libertés publiques et individuelles, l'absence des conditions élémentaires d'une alternance politique durable et irréversible, menaçaient sérieusement la survie du modèle républicain choisi en 1957.
En deux temps, tous les espoirs vont se dissiper. D'abord en 1988 à travers une révision en profondeur de la Constitution, qui allait accentuer le déséquilibre institutionnel en faveur du président de la République au détriment du gouvernement. Ensuite en 1997, à travers une autre révision qui était animée cette fois par le souci de renforcer la position constitutionnelle du chef de l'État au détriment du pouvoir législatif. Le président Ben Ali a pu ainsi récupérer tous les pouvoirs concédés par Bourguiba en 1976 et les a même renforcés spectaculairement. Nous allons nous arrêter sur ces deux moments-clé de l'histoire de la « République ».
En 1988 plusieurs dispositions sont insérées dans la Constitution, visant le renforcement du statut et des attributions du président et sa stabilisation face à son « propre » gouvernement :
1- L'abolition de la présidence à vie n'avait, contrairement aux apparences, aucun impact technique sur le sauvetage urgent de la République : étant accordée en termes exclusifs et nominatifs au président Bourguiba, elle est devenue automatiquement caduque par le simple fait de sa destitution en 1987.
2- La puissance du statut constitutionnel et politique du Premier ministre, issue des textes et des vides laissés par l'ancien président, devrait disparaître au profit du président de la République. D'abord par l'élimination de la succession automatique en cas de vacance de la présidence. L'institution fut remplacée par un système d'intérim provisoire assuré pour une durée maximale de 60 jours par le président de la Chambre des députés. Celui-ci est chargé uniquement de la préparation des nouvelles élections, auxquelles il ne pourrait pas se porter candidat. Ainsi l'éviction du président de la République en place, surtout pour motif d'incapacité totale, devient constitutionnellement inexploitable et donc politiquement ingérable, ce qui interdit la réédition du 7 novembre 1987.
Ensuite, le régime de la responsabilité politique de l'exécutif devant le parlement allait être redéfini. La motion de censure, introduite pour la première fois en 1976, permettait dans une logique parlementaire au pouvoir législatif de contrôler, voir sanctionner l'exécutif tout entier, lui-même chargé de la définition et de la mise en oeuvre de la politique générale de l'État. La motion de censure pouvait, dans cette perspective, atteindre le sommet de l'État, la raison en est évidente : le président fixe les orientations et les choix politiques fondamentaux du pays, il en est donc responsable devant le Parlement, le gouvernement est chargé de la mise en oeuvre de cette politique et en assume donc la responsabilité. Le régime de la responsabilité politique, bien que copié sur le modèle parlementaire et parachuté dans une Constitution présidentialiste, était dans l'ensemble équilibré, et donc, virtuellement, menaçant.
La révision de 1988, ordonnée par le président Ben Ali, consistait en la matière à écarter tous les risques qui pourraient peser sur le chef de l'État en exposant le gouvernement seul devant le Parlement. La motion de censure ne devrait plus atteindre le sommet de l'État, désormais déresponsabilisé devant le législatif. Une fois votée à la majorité renforcée des deux tiers, celle-ci provoque la démission du gouvernement. Une seconde motion ne provoque plus la démission du président, mais ouvre seulement devant ce dernier une option discrétionnaire : la dissolution de la chambre ou une nouvelle démission du gouvernement. Cela présume que le gouvernement est devenu le seul chargé de déterminer et de gérer les affaires de l'État, étant donné qu'il en est désormais le seul responsable. Il n'en est rien, c'est toujours le président, et plus que jamais, qui élabore les choix politiques fondamentaux.
Moralité : le gouvernement est devenu seul responsable d'une politique qui n'est pas la sienne. Ce modèle de responsabilité est particulier à la Tunisie, il s'agit d'une curiosité constitutionnelle rarissime, d'autant plus que le texte de l'article 62 de la Constitution ne permet au Parlement d'affronter le gouvernement, et de censurer son action, que dans la mesure où ce dernier sort du cadre de la politique fixée par le président. La Constitution fait étrangement du pouvoir législatif un gardien de la politique du président contre un gouvernement souverainement désigné par le chef de l'exécutif !
3- L'aspect le plus important de la réforme de 1988 visait à récupérer certaines compétences concédées en 1976 au profit du Premier ministre, ainsi l'article 60 a disparu et du coup le Premier ministre perd la direction de l'appareil administratif de l'État et de la force publique, placés désormais sous la direction directe et personnelle du président de la République. Ce qui n'est pas sans conséquences sur la balance des pouvoirs institutionnels à l'intérieur même du pouvoir exécutif. Dans la révision de 1988 il n'y avait rien de concrètement positif dans le sens de la République, encore une fois le pouvoir semble préoccupé par le réaménagement interne de ses rouages et par le souci de consolider la position constitutionnelle de son président. La nouvelle donne constitutionnelle a encore contribué à engraisser les attributions du président de la République et à concentrer les pouvoirs entre ses mains. Le principe de séparation des pouvoirs proclamé dans le Préambule de la Constitution n'est plus qu'une pétition de principe.
Le 27 octobre 1997, la révision relançait le processus, en ciblant cette fois le pouvoir législatif. Nous retiendrons de cet amendement deux éléments fondamentaux : d'abord, l'assignation du domaine d'intervention législative du Parlement. Ensuite l'élargissement soudain et particulier du domaine du référendum.
Il s'agit pour le premier aspect d'une redéfinition radicale des limites de compétences entre le président de la République et la Chambre des représentants en matière d'édictions des règles de droit. En voulant mimer le modèle de la Constitution française et l'implanter dans un contexte politique manifestement différent, on a réservé une partie seulement du domaine de l'édiction des règles juridiques à la Chambre des députés, laissant au président, par la généralisation de son intervention par décrets dans tous les autres domaines, la possibilité d'accaparer la compétence initiale, la compétence parlementaire devenant l'exception et celle du président la règle. Le nouvel article 35 a même élaboré un système de protection du domaine réglementaire du président : le Conseil constitutionnel, jusqu'alors organe simplement consultatif a désormais, à côté de son rôle consultatif, pour unique compétence décisionnelle celle de sanctionner toute initiative parlementaire qui empiéterait sur le domaine présidentiel. Le domaine législatif reste, quant à lui, sans protection, car la loi interdit tout recours direct contre les décrets réglementaires du président de la République.
Le résultat est paradoxal : les lois, actes législatifs et expression de la volonté générale sont contestables, alors que les décrets, simples actes administratifs, sont immunisés. La technique du référendum, absente dans le texte initial de la Constitution, avait fait une apparition timide en 1976. Ben Ali a ordonné en 1997 l'extension de son domaine. À coté du référendum prévu pour la ratification de certains Traités internationaux, le domaine du référendum législatif s'est élargi en même temps qu'on a pu voir apparaître, pour la première fois dans la Constitution tunisienne, la technique du référendum constitutionnel et consultatif. Cet arsenal constitutionnel préventif semble démesuré si l'on sait qu'en pratique, il n'y a jamais eu de référendum en Tunisie. L'avenir proche nous montrera si le premier recours à cette arme à double tranchant servira ou non à enterrer définitivement la République. Aujourd'hui, le déséquilibre institutionnel des pouvoirs atteint dans la Constitution tunisienne un degré tel que nous pouvons nous demander si nous somme encore dans un système de séparation de pouvoirs et de liberté et donc de Constitution.
Que reste-t-il d'une République dans un régime de non-Constitution ?
1- Un texte déséquilibré, sans cesse manipulé, pour justifier en droit le culte de la personne ;
2- Un exécutif surpuissant coiffé par un président dominant qui bénéficie d'un ensemble de prérogatives constitutionnelles lui permettant de régner, sans égal et sans partage ;
3- Un législatif fragilisé dans son statut, son domaine de compétences privilégié et étouffé par un régime de parti unique de fait ;
4- Des contres pouvoirs (partis politiques, associations, ONG, médias, ...), enchaînés et à défaut persécutés ,
5- Des libertés limitées, réglementées par des lois dont la constitutionnalité est souvent douteuse (loi sur les associations, Code de la presse, loi sur les partis politiques, ...) ;
6- Un appareil administratif partial parfaitement dompté, au service du parti au pouvoir ;
7- L'absence, durant 42 ans d'indépendance, d'une seule opportunité électorale légale, libre et démocratique.
Pour la beauté magique du chiffre sept, je décide de m'arrêter là.