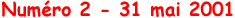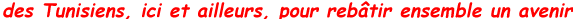n projet de réforme de l'assurance maladie, concocté et ficelé par
les administratifs des caisses et des directions des affaires
sociales, vient d'être renvoyé à une « pause de réflexion » par les
pouvoirs publics qui reculent ainsi devant une formidable pression du
pouvoir médical.
n projet de réforme de l'assurance maladie, concocté et ficelé par
les administratifs des caisses et des directions des affaires
sociales, vient d'être renvoyé à une « pause de réflexion » par les
pouvoirs publics qui reculent ainsi devant une formidable pression du
pouvoir médical.
En effet, réunis à l'appel de leur intersyndicale, l'ensemble des
professionnels de la libre pratique thérapeutique ont élevé une forte
indignation dans un langage sans concession, dénonçant en particulier
l'autoritarisme de l'administration et sa gestion improvisée,
cavalière, irréfléchie, d'un dossier complexe et grave, impliquant le
devenir de leur profession et de la santé des citoyens.
Cette réforme vise essentiellement la réhabilitation du médecin
généraliste, l'application de la capitation (inscription d'un quota de
malades par médecin dans sa circonscription, ce qui devrait limiter la
liberté de choix du malade) et établissement d'une filière de soins
qui obligerait les malades à passer par le praticien de première ligne
avant d'être éventuellement adressé par ce dernier à un spécialiste.
Selon l'administration, cette réforme vise à une maîtrise des dépenses
de santé par une limitation du « vagabondage » des malades de médecin
en médecin par l'inflation des prescriptions et examens annexes, par
le classement des médicaments en thérapies prioritaires et d'autres
dites de confort etc. Elle peut avoir l'avantage d'un rééquilibrage de
la carte sanitaire au profit des zones mal distribuées et des jeunes
médecins sans clientèle.
Du point de vue des praticiens libéraux, cette réforme introduit une
lourdeur administrative dans le processus de remboursement des
honoraires ou frais pharmaceutiques, car la réforme institue un
paiement par l'usager d'un ticket modérateur, lequel peut encourager à
l'inflation des dépenses, le malade n'ayant plus à débourser qu'une
quote-part, sur le champ.
La réforme, qui n'est pas préparée informatiquement et ne dispose même
pas encore d'un cadre juridique, était prévue pour janvier 2002 dans
ses premières applications, sans que soit envisagé le statut de
l'hôpital ou celui des cliniques et polycliniques. Rien n'est
envisagé, non plus, pour les non-assurés, auxquels pourrait être
réservée une médecine de second ordre.
Déjà, les ménages prennent en charge la moitié des dépenses de santé
(qui s'élèvent à un 1 280 millions de Dollars), ce qui, de
l'avis des responsables des caisses et des syndicats, place la Tunisie
immédiatement derrière un pays comme les USA, où l'on sait à quel
point une médecine privée et un système d'assurances coûteux privent des
cohortes de malades des soins indispensables !
En Tunisie, selon les déclarations, quelques 30% des usagers ne
seraient pas assurés. Cependant, 750 000 individus sur une population
de 9 millions bénéficient de soins gratuits. Pour une grande partie
des assurés sociaux, le remboursement des frais est ridicule : ainsi,
une consultation de généraliste est remboursée au dixième de son coût et
un plafonnement très bas limite le volume des dépenses remboursables.
Autant dire que la majorité de la population hésite de plus en plus à
consulter et à entamer des soins. La moindre intervention chirurgicale
est susceptible d'engloutir un salaire de cadre moyen (2,5 fois le
SMIG). Une grippe, une affection virale ou infectieuse bénigne,
surtout en pédiatrie, absorbe l'équivalent d'un quart du SMIG !
Dans ce débat qui fait rage, quelques idées sont à retenir. D'abord,
la libre pratique médicale constitue en Tunisie un vrai pouvoir très
structuré, qui vient de faire reculer l'État. Les médecins semblent
redouter un contrôle du fisc par le biais de la capitation et du
ticket modérateur et ils craignent une baisse de leurs revenus, la
médecine étant de grand rapport pour un certain nombre de cabinets (ou
d'officines pour les pharmaciens), mais au sein même de ce corps sévit
de plus en plus une douloureuse condition et un déclassement : près
d'un millier de médecins sont au chômage.
D'autre part, la médecine publique semble n'attendre qu'une régression
plus accusée de son état déjà peu reluisant. L'État, qui se désengage
de plus en plus des services publics, va-t-il lâcher tout à fait un de
ses piliers depuis l'indépendance ?
La mondialisation encourage, sans doute, à la privatisation. Mais ce
que dénoncent les partenaires engagés dans cette bataille (médecins et
citoyens), c'est que cette libéralisation se fasse paradoxalement avec
l'autoritarisme et dans la culture du secret qui sont un style de
gouvernance.
Ainsi, nul ne connaît à quelques mois de l'application présumée le
volume de l'enveloppe attribuée à cette réforme.
Une pause de réflexion vient d'être édictée, comme un sursis pour une
réforme dont un certain nombre de décideurs disent déjà qu'elle sera
renvoyée aux calendes.
En fait, tout n'est pas à jeter dans ce projet. Mais la conduite des
opérations, l'absence d'un véritable débat entre partenaires sociaux,
la parcimonie et la « démagogie manipulatrice » de l'information ont
discrédité un projet pourtant nécessaire. La puissance du lobby
médical, devant lequel l'État semble prendre peur d'y perdre une de
ses bases sociales, fait le reste.
En définitive, les autorités, comme en bien des situations, pêchent
plus par la méthode que par les intentions. Dans une ambiance générale
de perte et de tendance à l'indocilité, ainsi que dans un climat de
dénonciation d'absence de dialogue, d'incurie administrative et de
gaspillage qui se fait ailleurs que dans les dépenses de santé - les
seuls stades pour les Jeux Méditerranéens ont coûté plus cher que la
contribution annuelle de l'État en matière de santé - le pouvoir
médical met le doigt sur la plaie du système tunisien de gouvernance.