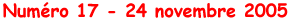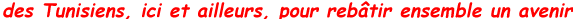as tout à fait, dans le sens où les dictatures de la modernité occidentale n'étaient que de simples intermèdes
forcément éphémères, instaurées par le grand capital dans des situations de crise et pour barrer la route à la
« menace » révolutionnaire. Ces dictatures étaient aussi le résultat d'une perversion d'un État de droit déjà
existant.
as tout à fait, dans le sens où les dictatures de la modernité occidentale n'étaient que de simples intermèdes
forcément éphémères, instaurées par le grand capital dans des situations de crise et pour barrer la route à la
« menace » révolutionnaire. Ces dictatures étaient aussi le résultat d'une perversion d'un État de droit déjà
existant.
Maintenant, il semble que l'histoire ne tolère plus aussi facilement ce genre de dictature à caractère « flagrant »,
où un seul individu impose sa loi et son seul point de vue à tous les autres, avec à la fois l'appui et
l'instrumentalisation des institutions répressives comme l'armée et la police et celle de la transmission
propagandiste, organisations dont la culture politique se crispe sur la seule bénédiction des faits et dires du
« chef ».
Chez nous, cette forme anti-moderne de pouvoir politique existe bel et bien, mais avec des freins qui lui sont
imposés par un certain code de conduite permettant un minimum de respectabilité et de crédibilité sur le plan
extérieur.
La différence maintenant, est que ce genre de pouvoir politique ne se présente pas chez nous comme phénomène
exceptionnel, ponctuel, mais en tant que phénomène en perpétuelle reproduction.
Pour marquer sa rupture avec le pouvoir totalitaire de Bourguiba, celui du 7 novembre a commencé par prendre des
« précautions » politiques qui rappellent une certaine recherche de légitimité démocratique, mais cette phase était
de très courte vie. À peine si les élites politiques du pays avaient commencé à y croire et à s'y investir que
très rapidement ce pouvoir décide tout seul que cette légitimité est acquise. Le réflexe totalitaire revient. Le
pouvoir s'installe aussitôt dans une logique de monologue et à la place du large consensus national que seul un
large vis-à-vis institutionnel peut assurer autour de lui, il se met à procéder par élimination maximale : celui
qui n'est pas inconditionnellement avec moi est contre moi. L'absence de toute nuance qu'implique cette logique
totale a fait que tout le monde s'est trouvé malgré lui en dehors du jeu politique minimal.
Résultat : gestion politique sur la base du schéma « un chef, un parti, un peuple », avec une philosophie qui fait
du chef l'incarnation du parti et du peuple.
Bien évidemment ce schéma qui revient de près et de loin par rapport à notre histoire ne peut plus fonctionner
dans l'histoire actuelle. D'abord la notion de peuple, bloc monolithique, n'est plus possible aujourd'hui, et même si
on n'a pas une société libre, auto-fondée, souveraine, le peuple est traversé par toutes formes de différenciation.
Celle d'un seul parti non plus, on ne peut pas disserter ici sur les raisons d'adhésion des gens au parti du
pouvoir, son élite elle-même n'a jamais senti le besoin de réfléchir sur cela avec le recul qu'il faut, mais il
reste clair que ce parti ne peut en aucune manière répondre tout seul aux aspirations politiques, idéologiques,
culturelles, diverses du peuple tunisien, l'existence sur le terrain politique d'autres partis le prouve même si
ces partis subissent une stratégie d'asphyxie qui cherche à les maintenir dans l'isolement pour pouvoir dire que le
peuple n'en a pas besoin.
Un seul chef, oui, mais pas un chef total. La conscience moderne portée avec grande conviction par une bonne partie
de la société tunisienne et par une élite qui ne compte céder à aucune forme d'obscurantisme politique qu'il soit
d'essence « laïque » ou religieuse, empêche d'accepter d'être dirigé par le mépris et la peur, qui en dehors des
règles d'un État de droit, restent et quoi qu'on dise les deux rouages les plus opérants politiquement dans notre
pays.