
|
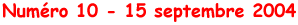
|
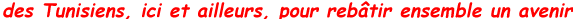
|
|

|


Réalités : un exposé de la situation partiel et partial
Certes, il est bien « fini le temps où une initiative de l'opposition pouvait faire la Une des journaux indépendants et le sujet favori du débat public ». Mais n'est-il pas trop commode, voire complaisant, d'expliquer cette constatation en renvoyant dos à dos l'opposition, le pouvoir et la société ? Alors qu'à l'évidence, l'hégémonie de l'État-Parti est la cause principale de l'absence de toute vie politique digne de ce nom. Certes, « une élection présidentielle pluraliste n'a de sens que si elle offre un choix crédible pour l'électeur ». Mais envisager une quelconque « opportunité à saisir afin de passer d'une candidature de témoignage à une véritable candidature élective », c'est se tromper de situation et de pays et faire fi des résultats de la dernière élection présidentielle où le candidat du pouvoir a été gratifié de 99,36% des voix, alors que ses deux adversaires ont dû se partager les restes. Comment peut-on nourrir l'illusion d'une « vraie bataille politique » à l'occasion de la prochaine élection présidentielle lorsqu'on sait que les conditions minimales d'une simple compétition n'existent pas. Le pouvoir et son parti monopolisent l'audiovisuel et les espaces publics ; l'administration partisane ne concède à l'opposition que ce que le pouvoir lui ordonne de céder, et la campagne électorale officielle est conçue comme une sorte de « récréation sous haute surveillance » au cours de laquelle l'opposition n'a l'autorisation que de faire de la figuration. Moyens exorbitants sans limitation d'aucune sorte pour le candidat élu d'avance ; moyens dérisoires, distribués au compte-gouttes pour les autres. Loin d'être une « vraie bataille politique », elle promet d'être un véritable massacre. Zyed Krichen a délibérément laissé de côté le « contenu » du débat qui agite l'opposition reconnue (PDP, FDTL, Ettajdid), ou non reconnue. On se demande pourquoi. Si la plupart des partis de l'opposition « radicale » ont refusé de s'aligner derrière le candidat d'Ettajdid, ce n'est pas en raison de divergences concernant « la plateforme idéologique et le programme politique » de ce parti, mais c'est essentiellement parce que ce candidat ne peut l'être que par la grâce d'une loi discriminatoire faite sur mesure pour exclure les opposants « crédibles » et favoriser les candidats d'une opposition que Zyed Krichen qualifie de « modérée », la récompensant de quinze ans d'allégeance au pouvoir en place. Ce refus tient aussi compte du fait que cette élection présidentielle survient suite à la modification radicale de la Constitution qui limitait les mandats présidentiels et prévoyait une alternance en 2004. Ces amendements qui changent arbitrairement la règle du jeu au seul profit des tenants du pouvoir ont été rejetés par l'ensemble des démocrates réunis le 12 Mai 2002. Ce jour-là, seul Ettajdid manquait à l'appel. Nous sommes loin d'« une nouvelle forme, toute tunisienne, de discussions byzantines ». Il s'agit d'un débat de fond que notre presse évite de soulever. Enfin, affirmer en conclusion que « les partis d'opposition, toutes tendances confondues, vont encore rater un rendez-vous de l'histoire et que cette fois-ci, on peut tout dire, sauf que c'est de la responsabilité du parti au pouvoir » est une fâcheuse contre-vérité historique. Rappelons que les élections de 1981 ont été falsifiées ; que les élections de 1989, au lendemain du changement, ont abouti à un parlement monocolore alors qu'on aurait pu, en introduisant une dose de proportionnelle, garantir à l'opposition - qui a officiellement récolté 20% des voix - une présence dans la dignité ; que les élections de 1994, véritable humiliation pour l'opposition qui n'obtint que 2,7% des voix mais s'est vue tout de même allouer, pour son allégeance, 19 sièges au Parlement ; et que les élections de 1999 où, officiellement, les deux candidats de l'opposition à l'élection présidentielle, gommés des écrans et de la radio pendant la « campagne récréation », n'ont obtenu - à eux deux - que 0,64% des voix. Les rendez-vous historiques ratés ne manquent pas. Et, chaque fois, la responsabilité du pouvoir est primordiale. Une élection doit couronner une vie politique pluraliste de cinq années pendant lesquelles représentants du pouvoir et de l'opposition peuvent bénéficier des mêmes droits, accéder également aux médias, disposer de moyens de financement publics suffisants, profiter sans entraves des espaces publics pour dialoguer librement avec les citoyens. Sommes-nous, de près ou de loin, dans ce cas de figure ? Pouvons-nous, en fait, parler d'élections, de compétition, de bataille politique ? Toutes les élections passées ont été des sortes de rites organisés par le parti au pouvoir, appuyé sur une administration aux ordres. Elles ont toutes été des rendez-vous manqués. Selon la Constitution, avant qu'elle ne soit modifiée, le rendez-vous de 2004 aurait dû être un rendez-vous « réellement » historique, aboutissant à une alternance pacifique. Tout a été bloqué par le pouvoir et son parti qui, effrayés par le changement, en ont décidé autrement. En fait, ce n'est pas l'opposition, c'est tout le pays qui rate un rendez-vous avec l'Histoire, et le pouvoir est seul à en assumer la responsabilité.
Mustapha Benjaâfar
Secrétaire général du FDTL |
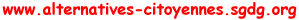  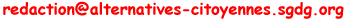 |
|





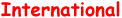





 ous le titre « L'opposition et l'élection présidentielle »
ous le titre « L'opposition et l'élection présidentielle » 