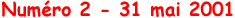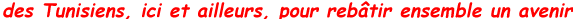uand la montagne accouche d'une souris, il existe deux manières d'aborder les questions
relatives à la liberté de la presse, et chacune d'elles nous renseigne sur la nature des rapports
qui existent entre l'État, la société et l'individu. Soit en s'imprégnant du sentiment que la
confiance règne entre les gouvernants et les gouvernés et que la liberté d'informer et de
s'exprimer est un droit naturel et non un privilège accordé par une autorité politique, et, dans
cette perspective, convenir donc de laisser les usages sociaux et individuels structurer le
secteur de l'information, pour aboutir à une configuration, y compris juridique, transparente
qui recueille l'assentiment de tous. Soit, au contraire, en s'entêtant à l'idée que les rapports
entre gouvernants et gouvernés sont emprunts de méfiance, voire de suspicion, auquel cas il
revient à l'État seul, à travers ses structures, d'édicter des lois et de prendre des mesures, en
vue de régenter à sa manière, et selon l'humeur du moment, ce secteur.
uand la montagne accouche d'une souris, il existe deux manières d'aborder les questions
relatives à la liberté de la presse, et chacune d'elles nous renseigne sur la nature des rapports
qui existent entre l'État, la société et l'individu. Soit en s'imprégnant du sentiment que la
confiance règne entre les gouvernants et les gouvernés et que la liberté d'informer et de
s'exprimer est un droit naturel et non un privilège accordé par une autorité politique, et, dans
cette perspective, convenir donc de laisser les usages sociaux et individuels structurer le
secteur de l'information, pour aboutir à une configuration, y compris juridique, transparente
qui recueille l'assentiment de tous. Soit, au contraire, en s'entêtant à l'idée que les rapports
entre gouvernants et gouvernés sont emprunts de méfiance, voire de suspicion, auquel cas il
revient à l'État seul, à travers ses structures, d'édicter des lois et de prendre des mesures, en
vue de régenter à sa manière, et selon l'humeur du moment, ce secteur.
Dans cette optique, les libertés d'information, d'expression et d'opinion ne sont plus perçues
comme des droits naturels, mais comme des gratifications que les États daignent nous accorder
pour nous les retirer ensuite, selon les appréciations que leurs dirigeants assignent à ces
droits. Et le recours aux dispositifs juridiques, tout autant aux amendements qui les
accompagnent, reflète les volontés politiques qui s'expriment selon les contingences du moment.
En Tunisie, depuis l'ère de l'indépendance, un consensus s'étant forgé autour de l'idée que la
presse et l'information constituent un secteur vital - plus pour l'État que pour la société et
pour l'individu -, toute évolution dans ce secteur ne peut être impulsée que par le « haut ».
Le secteur de l'audiovisuel demeurant sous la coupe exclusive de l'État, une législation sur la
presse écrite s'avère donc nécessaire pour nous tracer les limites à ne pas transgresser et les
procédures à suivre pour pouvoir nous informer et nous exprimer dans la plus grande légalité.
Or, ces limites et procédures brillent souvent par leurs ambivalences et leurs imprécisions,
ce qui explique le recours fréquent aux amendements pour modifier le contenu et le sens
de ces dispositifs en fonction des vicissitudes de la conjoncture politique. Les derniers
amendements introduits au code de la presse feignent d'entretenir encore l'illusion de
changements substantiels dans ce secteur, avec la suppression du délit de diffamation envers
l'ordre public, le transfert de plusieurs dispositions contenues dans ce code et leur insertion
dans le code pénal et le code de la poste, l'ouverture d'un guichet unique pour le dépôt légal
des oeuvres imprimées, ou encore l'obligation qui est faite au propriétaire d'un journal de recruter la
moitié de ses effectifs parmi les diplômés de l'enseignement supérieur. Mais, en fait et dans leur
substance, toutes ces dispositions ne changent absolument rien à la nature intrinsèque de ce code qui perdure depuis les années 1975. Aucune mention n'est faite du monopole devenu insensé de l'État sur l'audiovisuel, au moment où notre paysage s'ouvre aux chaînes satellitaires et où les connexions à Internet donnent aux usagers des possibilités d'information, d'expression et de contestation en dehors de tout contrôle étatique, alors que les quelques demandes de créations de radio privées demeurent jusqu'à ce jour sans réponse de l'administration.
Dans ce même sillage, la disposition relative au recrutement obligatoire parmi les diplômés de
l'enseignement supérieur introduit une discrimination flagrante entre les diplômés et les non
diplômés, ce qui est pour le moins incongru dans ce métier où la vocation, les aptitudes
personnelles et l'art de l'écriture priment sur toute autre qualification diplômante. Et la liste
de ces talentueux journalistes dépourvus de diplômes, qui avaient pourtant marqué de leur
empreinte la presse nationale et internationale, serait bien longue à dresser. D'autre part, sur
la question de la mise en pratique d'une telle disposition, nous sommes en droit de nous
demander par quels moyens l'État peut s'employer à obliger un propriétaire « privé » à se soumettre à une telle injonction, alors que le quota du « tiers » énoncé déjà dans les anciennes dispositions, n'avait jamais reçu une application effective et totale.
Au-delà de ces replâtrages et modifications de circonstance, deux enseignements s'imposent.
D'une part, les recensements des amendements introduits au code de la presse depuis son avènement montrent que la liberté de la presse ne se décrète pas, et qu'aucun nouvel amendement n'a généré une dynamique de la presse ou stimulé des potentialités créatives et imaginatives des journalistes. Tout au contraire, à force de recourir aux amendements, les esprits finissent par se résigner, pour sombrer dans l'indifférence, voire dans l'apathie. D'autre part, au-delà de tous ces débats juridiques qui resurgissent furtivement au gré des événements, pour le grand bonheur des techniciens du droit, il convient d'admettre que les rapports de l'administration au monde de la presse et des journalistes ne tirent pas leur consistance
seulement des dispositions légales. Ils se fondent, en outre, sur une armada de principes non
écrits, souvent implicites, voire subjectifs, dont nous avons fait mention dans notre précédente
contribution [Alternatives citoyennes numéro 1 du 28 avril 2001, NDLR].
C'est ainsi que les modalités de l'octroi ou non des récépissés au moment du dépôt du dossier
de demande, de l'accès aux sources de l'information pour une publication nouvellement admise, de la distribution de la manne publicitaire, mais encore de la distribution du journal, etc., répondent souvent à des critères d'appréciation dont les fondements varient et fluctuent. En conséquence, la dynamique qui pourrait être impulsée à ce secteur ne peut émaner de nouveaux dispositifs légaux ou de déclarations de principes, fussent-ils les plus nobles, mais d'une ferme volonté d'admettre que toute l'organisation, la structuration et la gestion de ce secteur sont à revoir radicalement.
Le débat qui s'ensuivra ne doit pas se polariser sur le seul aspect juridique, mais doit
impérativement associer toutes les franges représentatives de la société. Autrement dit, il
convient d'abord de circonscrire ces maux qui rongent les fondements même du secteur de
l'information, de délimiter par la suite les responsabilités et d'en identifier les auteurs, pour
inaugurer enfin une autre manière d'aborder la liberté de la presse dans notre pays qui tourne
complètement le dos à toute mainmise du politique sur l'information, en attendant - s'il existe
réellement une volonté de délier complètement les langues - que soient suscités de larges débats contradictoires et qu'il soit mis fin à l'ampleur des rumeurs qui prolifèrent. Alors, convenons de supprimer le régime des récépissés, en permettant à toute personne qui en a fait et qui en fera la demande de se voir accorder aussitôt le droit de publier son journal !