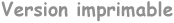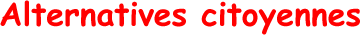
|
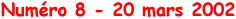
|
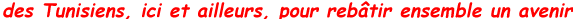
|
|

|


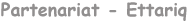
Constitution et droits des femmes au Maghreb
En marge de cette même question soulevée à l'occasion du 8 mars par l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), nous évoquons comparativement les situations marocaine et algérienne, en rapportant l'essentiel de deux conférences prononcées par Malika Berradhi (Maroc) et Souad Ben Jaballah (Algérie), toutes deux professeurs de droit et militantes du mouvement associatif féministe. Pour sa part, Sana Ben Achour, maître de conférences à la Faculté des Sciences Juridiques de l'Ariana et Secrétaire générale de l'ATFD, a répondu aux questions d'Attariq Aljadid relatives à la rencontre que l'association organise sur le même thème. Décidément, du côté des femmes aussi, il y a de la Constitution dans l'air ! Au Maroc Quel référentiel interpelle le double examen de la Constitution marocaine et de la Moudawana en cette période de transition de la monarchie vers un État de droit ? Voilà à quoi tenta de répondre Malika Berradhi au cours d'une conférence précise et engagée. Les contradictions et les apories dont sont chargés ces deux textes rendent encore plus complexes leur rencontre et leur confrontation. Car le texte fondamental à la source des lois régissant l'activité publique est, au Maroc, d'inspiration occidentale, tandis que le Code de la famille régissant tous les aspects de la vie privée y est d'inspiration religieuse. La condition juridique faite aux femmes cristallise cette contradiction. La révision du Code de la famille rend « incontournable l'interrogation du référentiel qui est partout objet de débats et de polémiques ». Dans cette perspective, « l'analyse objective est souvent sacrifiée au profit des positions idéologiques instrumentalisant la religion, voire la culture en général, à des fins purement politiques ». Ainsi, la première épreuve de conflit et surenchère s'est-elle jouée à l'occasion du plan d'action pour l'intégration des femmes au développement. Et si la question de l'alphabétisation, celle de la santé reproductive ou celle de la lutte contre la pauvreté sont bien passées, celle du renforcement de la capacité des femmes a soulevé un tollé du côté de la sensibilité islamiste. Ainsi, ce renforcement devait impliquer la réforme du Code de la famille autour de huit propositions : l'élévation de l'âge du mariage à 18 ans, conformément à la Convention sur les droits de l'enfant que le Maroc a ratifiée sans réserves ; la tutelle matrimoniale (de manière à laisser à la femme le choix de son tuteur) ; la suppression de la polygamie, le remplacement de la répudiation par le divorce judiciaire ; la garde de l'enfant (qui à partir de 12 ans pour le garçon et 15 ans pour la fille, peut choisir de vivre avec tel ou tel parent) ; ainsi que la suppression de la déchéance du droit de garde pour toute femme qui désire se remarier ; la représentation légale totale pour la femme... de façon à ce que la mère puisse représenter ses enfants mineurs devant le juge ; enfin, la conservation du domicile pour les femmes en cas de divorce... La réforme de la Moudawana suscita un tollé de protestations, autant qu'en 1992 des propositions de réformes suggérées par des associations de femmes avaient provoqué l'opposition des Ulémas. On se souvient alors qu'aux dizaines de milliers de progressistes marocains descendus dans la rue pour soutenir la réforme, avait répondu un cortège d'un million de Marocains et de Marocaines appelés à protester par le courant islamiste. C'est d'abord le désaccord sur le référentiel (au Maroc, le roi est Commandeur des croyants) entre partisans de la modernité et conservateurs qui s'est fixé donc sur la procédure de réforme de la Moudawana, la bloquant. La tendance conservatrice s'est fondée sur certains articles de la Constitution tels le statut du roi et celui de l'État marocain qui est un État musulman. Le deuxième facteur de blocage renvoie au Fiqh, d'inspiration malékite, qui renvoie à une interprétation restrictive de la Chariâa. Le troisième facteur de blocage est sociologique et renvoie à l'ensemble des usages familiaux et sociaux qui installent un carcan pour les femmes. Mais Malika Berradhi souligne, à l'inverse, des coutumes intégrées aux moeurs nationales et non liées à l'Islam, surtout une nouvelle tradition occidentale introduisant une autre conception du pouvoir avec respect des droits de l'homme. Cette référence a été inscrite en 1996 dans le préambule de la Constitution marocaine. Mais la condition juridique des femmes, façonnée par tous ces éléments, reste en-deçà, voire en contradiction avec les nouvelles valeurs inscrites dans la Constitution, sans parler des Conventions internationales auxquelles le Maroc a adhéré. Cette question-là risque d'être encore au coeur de la campagne électorale, la condition juridique des femmes devenant le point d'appui de la conquête de l'instance législative et de l'appareil de pouvoir. En Algérie Le Code de la famille, en date de 1984, a été dès le départ conçu comme la traduction juridique des valeurs intrinsèques de la société algérienne. Il est dénoncé aujourd'hui pour son caractère discriminatoire et anticonstitutionnel par des mouvements progressistes algériens. Souad Ben Jaballah, professeur de droit et présidente d'une association, a examiné le rapport entre les deux textes en tenant compte de la double contrainte, celle de l'engagement des autorités algériennes signataires de Conventions internationales et celle de la présentation de l'identité nationale. Ce sont là les deux points d'appui d'un pacte politique national. Souad Ben Jaballah a rappelé que lors des débats de l'Assemblée nationale algérienne visant à voter le Code de la famille, une instruction présidentielle était venue alors (en 1984) enjoindre aux députés du FLN, parti unique, de rejeter toutes les propositions contraires à la Chariâa. « En se référant à une source de légitimation sacrée, le président de la République d'alors se mettait hors du champ institutionnel et constitutionnel ». Ce caractère sacré marquera dès le départ le débat autour du Code, cristallisé sur la question de la polygamie, du droit des femmes au divorce, etc. Aucune véritable discussion sur les droits des femmes à l'intérieur de la famille ne fut entreprise, le Code demeurant enfermé dans l'espace balisé de la Chariâa, mise au service de l'idéologie patriarcale. Aussi le Code est-il plutôt un « Code de bonne conduite » pour les femmes. Apparaissant, au terme de débats, comme un texte répondant à un compromis politique destiné à satisfaire la tendance la plus conservatrice du pouvoir, le texte, construit tout entier autour de l'autorité de l'homme et de l'obéissance de la femme, est, selon Souad Ben Jaballah, pétri de contradictions internes. Ces contradictions affleurent essentiellement au niveau de l'institution du mariage, de ses conditions et notamment de l'existence et de l'identité du tuteur matrimonial qui peut être légalement le juge. Mais - souligne ironiquement Souad Ben Jaballah - une femme juge peut jouer le rôle de tuteur matrimonial pour une autre femme tout en ayant besoin pour son propre mariage d'un tuteur ! D'autres contradictions, notamment au niveau de la garde des enfants par la femme et de son droit au logement (qui peut lui être refusé), conduisent à des situations socialement désastreuses. Quant à la polygamie, Souad Ben Jaballah désigne l'Article 8 qui la codifie comme un exemple « d'absurdité ». Mais, au-delà de contradictions multiples dans le détail de ses prescriptions, le Code de la famille est « en rupture avec la logique du système politique algérien » qui énonçait la protection égale de tous les citoyens. Mais ce texte est-il conforme à la Constitution algérienne ? Celle-ci énonce dans ses différentes moutures que l'Islam est la religion de l'État, mais nulle part il n'est inscrit que la Chariâa doit être source de la loi. Les Articles 39 et 62 de la Constitution de 1976 rappellent et réitèrent les garanties des droits des femmes dans les domaines politique, économique, social et culturel. L'Article 151 stipule que les règles relatives au statut personnel et au droit de la famille relèvent du domaine de la loi et donc du droit positif. Cependant - et c'est là toute l'ambiguïté - les sources de la loi ne sont pas spécifiées. De plus, la Charte nationale, préambule de la loi fondamentale, est présentée dans l'Article 6 de la Constitution de 1976 comme la source unique des lois du pays. Or, rien dans cette source ne renvoie à la Chariâa comme référence. Et pourtant, l'avant-projet du Code de la famille présenté par les représentants du gouvernement entendait « s'inspirer des traditions islamiques », faisant de la Chariâa la seule source de la loi, à l'exclusion de la Constitution et de la Charte nationale ! De ce fait, le Code de la famille cristallise « tous les antagonismes culturels de la société algérienne et, au point de vue politique, il est porteur de toutes les contradictions, mais aussi de toutes les attentes au nom desquelles les Algérien(ne)s se mobilisent et descendent dans la rue ». Aussi, tel qu'il est, le Code de la famille souligne l'échec de l'État algérien à poursuivre le processus de sécularisation entrepris dans d'autres champs du droit (par exemple le Code pénal) et son échec à garantir à tous les citoyens algériens un statut égalitaire. Au-delà de l'avenir de la condition des femmes, il se joue aussi, dans la controverse ou les conflits autour du Code de la famille, la question du statut du religieux dans un État tentant d'opérer une transition démocratique. L'État algérien devrait impulser une nouvelle politique juridique dans un espace normatif balisé par la Constitution de 1996 qui maintient l'Islam religion de l'État (Article 2), tout en réitérant l'égalité des citoyens sans discrimination de sexe, et avec comme boussole les Conventions internationales dont est réaffirmée la primauté sur la loi nationale. En Tunisie Sana Ben Achour, Secrétaire générale de l'ATFD : l'égalité entre les sexes, valeur fondatrice d'une société démocratique. Attariq Aljadid : L'Association tunisienne des femmes démocrates organise pour le 8 mars une table ronde sur le thème « Constitution et droits des femmes ». Pourquoi une telle préoccupation aujourd'hui ? Est-ce parce que s'amorce une réforme politique de la Constitution tunisienne ? Sana Ben Achour : Le thème « Constitution et droits des femmes » a été proposé et retenu lors du dernier congrès, au nombre des axes fondamentaux de la réflexion et de l'action collective au sein de l'association. La question a toujours agité les militantes, qui l'ont abordée sous plusieurs angles. La question est aujourd'hui réactivée. L'association ne peut garder, sur une question aussi fondamentale, le silence. La manifestation du 8 mars 2002 en représente le premier moment... Cette initiative est née du besoin ressenti par les militantes de donner aux principes de l'égalité entre les sexes, de la non-discrimination à l'égard des femmes, de la citoyenneté pleine et entière et de son exercice effectif, un ancrage constitutionnel, afin d'en faire les valeurs fondatrices d'une société démocratique dont les bases sont aujourd'hui objet de réforme. Il s'agit pour l'association d'examiner au fond une question dont les retombées sont extrêmement importantes sur le statut des citoyennes et des citoyens. A. A. : Comment allez-vous aborder la réflexion sur les rapports de la Constitution et des droits des femmes ? S.B.A : Il s'agit pour l'instant de faire un premier état des lieux en examinant la question des droits des femmes dans leur triple articulation au référentiel religieux de l'Article premier de la Constitution, à l'égalité des citoyens en droit et en devoir de l'Article 6 et au respect des principes du statut personnel énoncé à l'Article 8. Concernant le premier point, il faut rappeler que l'association a eu à relever l'obstacle à l'égalité que constitue le recours à l'Article 1er sur l'Islam religion d'État. Invoqué pour faire barrage à la réception des droits des femmes reconnus dans les instruments internationaux (réserves à l'encontre de certaines dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard de femmes, réserves à l'encontre de la Convention sur les droits des enfants, en particulier des jeunes filles), l'Article 1er sert également de base à une pratique administrative et à une jurisprudence des tribunaux conservatrices du modèle traditionnel de la ségrégation patriarcale. Cette « sur-validation » du droit par l'Islam, dont le jeu politique n'échappe pas aux féministes et dont l'enjeu est le statut des femmes dans la société, doit cesser aux yeux de notre association qui pose le principe de la séparation du politique et du religieux. Concernant le deuxième point, il y a lieu de relever que l'égalité devant la loi - dont l'énoncé constitutionnel est laconique - n'est toujours pas une réalité tant dans les relations familiales que dans la vie publique. Au niveau du droit privé, plusieurs inégalités - et non des moindres - persistent, dont les inégalités successorales. Au niveau de la vie publique, rien n'est fait pour véritablement appuyer la participation des femmes à la vie politique et à la prise de décision autonome. Concernant le troisième point, il pose le problème crucial de l'identification des principes du statut personnel à respecter, étant rappelé qu'aucun principe n'a été matériellement défini par la Constitution. C'est dire si l'on a du pain sur la planche ! A. A. : La réforme de la Constitution prévoit l'inscription des droits de l'homme dans le texte fondamental. Votre association, un mouvement de femmes, n'aurait-il pas intérêt à revendiquer également l'inscription explicite des droits des femmes ? S.B.A : Notre mouvement considère que les droits des femmes font partie intégrante des droits de la personne (expression que nous substituons à celle des droits de l'homme) avec laquelle elles ont en partage la dignité humaine. Cependant, nous considérons, sur la base de notre attachement aux principes de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qu'il est impératif de décliner les droits de la personne au féminin, de les énoncer explicitement et de prendre surtout toutes les mesures appropriées pour leur attacher pleins effets et leur donner une effectivité entière. Car il est entendu que les droits de la personne ne peuvent se suffire à une existence purement formelle. A. A. : L'ATFD est connue pour ses engagements démocratiques qu'elle lie à la question de la citoyenneté des femmes. De ce point de vue, elle est souvent présentée comme une association politique autant que féministe. Dans la mesure où elle milite pour l'instauration d'un État de droit permettant l'exercice d'une citoyenneté libre, pleine et entière pour tous, a-t-elle aussi une position par rapport au projet de réforme constitutionnelle ? S.B.A : Féministes et démocrates, les militantes de l'association revendiquent pleinement cette double identité. Et si à l'occasion du 8 mars l'association pose la question du rapport Constitution et droits des femmes, c'est bien par implication dans le champ public et parce qu'elle est convaincue qu'il ne peut y avoir de démocratie sans les femmes. C'est, d'ailleurs, dans cette perspective que le débat est aujourd'hui amorcé sur la question. Pour l'instant, il s'agit simplement de déblayer le terrain en identifiant les multiples facettes du problème. Cette réflexion est appelée à se prolonger et devrait aboutir à dégager une position commune sur le projet de réforme constitutionnelle. A. A. : Il fut un temps où le mouvement des femmes, même avant qu'il ne fut légal et organisé en associations, fêtait le 8 mars avec éclat : rencontres publiques, fêtes, marches dans les rues avec bouquets de mimosas. C'était la belle époque du féminisme. Pourquoi donc vous retranchez-vous dans votre local ? Votre engagement féministe s'est-il marginalisé et affaibli ? Ou la situation générale entraîne-t-elle cette régression, voire cette tristesse ? S.B.A : Moi aussi, je regrette beaucoup cette période où le 8 mars revêtait le sens d'une fête. Je peux affirmer, sans déformer la réalité, que nous nous trouvons aujourd'hui, de fait, assignées à résidence. Les requêtes de notre association pour organiser des manifestations publiques se heurtent quasi systématiquement à des fins de non recevoir, parfois explicites, le plus souvent déguisées, refus que l'association n'a pas manqué de dénoncer à chaque fois. C'est pour ne pas compromettre définitivement nos manifestations que nous nous retranchons dans le local non sans avoir préalablement fait et refait le tour des lieux... un véritable parcours du combattant. Et encore, je me souviens d'une manifestation à laquelle nos invités ont été empêchés d'accéder au local. Il faut croire que, comme toutes les autres associations autonomes du pays, notre association « plie » sous le poids de la censure à laquelle elle résiste du reste vaillamment. Références (fournies par la rédaction d'Alternatives Citoyennes) : Maroc :
- Constitution de 1996 :
Algérie :
- Constitution de 1976 :
Tunisie :
- Textes législatifs tunisiens consolidés :
Nadia Omrane
Journaliste. Tunis. |
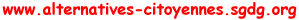  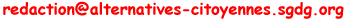 |
|




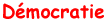


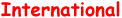

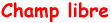

 n colloque a réuni courant janvier, à la Faculté des Sciences juridiques de Tunis II,
des spécialistes en Droit de la famille, des constitutionnalistes et des magistrats pour
interroger une problématique complexe et sensible, celle des rapports de la Constitution avec
le Code de la famille des cinq pays maghrébins.
n colloque a réuni courant janvier, à la Faculté des Sciences juridiques de Tunis II,
des spécialistes en Droit de la famille, des constitutionnalistes et des magistrats pour
interroger une problématique complexe et sensible, celle des rapports de la Constitution avec
le Code de la famille des cinq pays maghrébins.