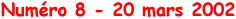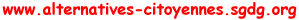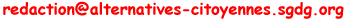ivre culte pour certains, nouveau Manifeste communiste pour d'autres, Empire, le dernier
ouvrage du philosophe et militant italien Antonio Negri, écrit en collaboration avec
l'universitaire Michael Hardt, figure connue de la gauche radicale américaine, est considéré
comme l'une des références majeures du mouvement anti-mondialisation, notamment dans les
pays anglo-saxons. Il a également été l'objet de nombreuses controverses mais l'écho du livre
doit autant à l'intérêt de certaines des thèses qui y sont développées qu'à la conjoncture dans
laquelle il est paru. Il est en effet l'expression d'un renouveau du mouvement social et
intellectuel anticapitaliste tel qu'il a commencé à se manifester au lendemain des grandes grèves
de l'hiver 1995 en France avant de prendre son véritable élan à la suite des manifestations
spectaculaires contre la globalisation capitaliste, à Seattle, en novembre 1999. Il exprime, à ce
titre, l'urgence d'une clarification théorique d'ensemble ressentie de plus en plus largement :
où en est le capitalisme, toujours triomphant malgré les désastres dont il est la cause ? Où en
est la lutte des classes, vite enterrée après la chute des dictatures staliniennes d'Europe de
l'Est ? Que reste-t-il de 150 ans d'histoire du mouvement ouvrier ? Quelles sont les acteurs du
changement historique à souhaiter ? Quel programme? Quelle stratégie ?
ivre culte pour certains, nouveau Manifeste communiste pour d'autres, Empire, le dernier
ouvrage du philosophe et militant italien Antonio Negri, écrit en collaboration avec
l'universitaire Michael Hardt, figure connue de la gauche radicale américaine, est considéré
comme l'une des références majeures du mouvement anti-mondialisation, notamment dans les
pays anglo-saxons. Il a également été l'objet de nombreuses controverses mais l'écho du livre
doit autant à l'intérêt de certaines des thèses qui y sont développées qu'à la conjoncture dans
laquelle il est paru. Il est en effet l'expression d'un renouveau du mouvement social et
intellectuel anticapitaliste tel qu'il a commencé à se manifester au lendemain des grandes grèves
de l'hiver 1995 en France avant de prendre son véritable élan à la suite des manifestations
spectaculaires contre la globalisation capitaliste, à Seattle, en novembre 1999. Il exprime, à ce
titre, l'urgence d'une clarification théorique d'ensemble ressentie de plus en plus largement :
où en est le capitalisme, toujours triomphant malgré les désastres dont il est la cause ? Où en
est la lutte des classes, vite enterrée après la chute des dictatures staliniennes d'Europe de
l'Est ? Que reste-t-il de 150 ans d'histoire du mouvement ouvrier ? Quelles sont les acteurs du
changement historique à souhaiter ? Quel programme? Quelle stratégie ?
Il n'est pas possible dans les limites d'une telle présentation d'aborder toutes les questions
soulevées par Michael Hardt et Toni Negri. Je me contenterais donc de formuler une série de
remarques suggérées par une première lecture nécessairement insuffisante.
L'Empire, stade suprême de l'impérialisme ?
La thèse centrale du livre est que l'impérialisme a vécu : « Dans l'actuelle phase impériale, il
n'y a plus d'impérialisme - ou, quand il subsiste, c'est un phénomène de transition vers une
circulation des valeurs et des pouvoirs à l'échelle de l'Empire ». La mondialisation aurait ainsi
permis la réalisation du marché mondial ; elle aurait unifié économiquement et politiquement la
planète, sans pour autant donner naissance à un État supranational. L'extension planétaire des
rapports de production capitalistes, ou la « subsomption réelle » de la production sociale
mondiale par le capital, aurait pour corollaire l'identification de l'État et du capital, c'est-à-dire
la dissolution des médiations politiques dont le signe le plus fort serait le déclin de la
souveraineté des États-nations.
Il ne s'agit pas, s'empressent de préciser les auteurs, d'un déclin de la souveraineté « en tant
que telle ». Une nouvelle forme mondiale de souveraineté se met en effet en place ; une
souveraineté qui n'est plus tout à fait une souveraineté, l'Empire. Ce nouveau pouvoir
souverain, impossible à identifier parce qu'il serait partout et nulle part, privé de centre et de
périphérie, sans « extérieur », serait donc l'expression de la domination d'un marché mondial
« uni sous une logique unique » à différentes procédures institutionnelles nationales,
internationales et supranationales configurant des réseaux multiformes de pouvoir, sans pour
autant converger pour constituer un État supranational. Ce pouvoir sans « lieu de pouvoir »
est l'Empire.
Rejetant l'hypothèse de l'émergence d'un État mondial, les auteurs écartent donc
également la thèse d'un super-impérialisme qui dominerait le monde. Sorte de pouvoir SDF, ce
« non-lieu », pourtant tout puissant, se distingue substantiellement de l'impérialisme dans la
mesure où ce dernier repose sur la souveraineté des États-nations avec leurs frontières
territoriales bien définies et se caractérise par l'extension de cette souveraineté au-delà des
limites de leurs frontières. L'Empire, lui, « n'établit pas de centre territorial du pouvoir et ne
s'appuie pas sur des frontières ou des barrières fixées. C'est un appareil décentralisé et
déterritorialisé de gouvernement, qui intègre progressivement l'espace du monde entier à
l'intérieur de ses frontières ouvertes et en perpétuelle expansion. L'Empire gère des identités
hybrides, des hiérarchies flexibles et des échanges pluriels en modulant ses réseaux de
commandement. »
L'ouvrage débute par une passionnante analyse des évolutions juridiques contemporaines, et
notamment celles qui concernent les relations internationales, pour tenter d'y repérer les
symptômes de la mise en place d'un tel pouvoir supranational. D'une manière très pertinente
à la lumière des événements qui ont suivi les attentats du 11 septembre, Hardt et Negri
déchiffrent ensuite les codes et les dispositifs idéologiques qui accompagnent la mondialisation
libérale : faire la guerre au nom de la paix, détruire au nom de l'éthique, tuer au nom des droits
de l'homme. Autant d'interventions militaires à visées hégémoniques, présentées comme
d'indispensables opérations de police pour neutraliser des adversaires politiques
métamorphosés par le discours impérial en serial-killer (les « terroristes ») ou en vulgaires
délinquants (les États « voyous »). « Tout comme la guerre elle-même, l'ennemi vient à être à
la fois « banalisé » (réduit à un objet de répression policière de routine) et « absolutisé »
(comme l'Ennemi, menace absolue contre l'ordre éthique mondial). »
Hardt et Negri semblent moins à l'aise cependant pour cerner les « conditions matérielles » qui
constituent le soubassement de l'Empire. Leurs efforts pour « descendre au niveau du
concret », et « découvrir les moyens et les forces de production de la réalité sociale, ainsi que
les subjectivités qui l'animent », ne sont guère convaincants.
Evanescente et abstraite, leur analyse de l'accumulation capitaliste manque particulièrement de
précisions lorsqu'il s'agit de démontrer comment l'Empire constitue le marché mondial et
modifie en profondeur les conditions sur lesquelles reposaient les impérialismes classiques.
Ceux-ci supposaient en effet la mise en relation d'espaces inégalement développés,
notamment du point de vue de la productivité du travail. Les pays les plus compétitifs
captent ainsi à travers l'échange inégal une partie de la valeur produite dans les pays les moins
compétitifs. La mondialisation actuelle remet-elle en cause ce cadre cloisonné et hiérarchisé ?
Ouvre-t-elle la voie à la formation d'un marché mondial homogène ? C'est la position que
défendent les organisations financières internationales et tous ceux qui prônent la
généralisation du libre-échange. La concurrence mondiale est ainsi censée obliger les « pays en
voie de développement » ou les PMA comme ont dit aujourd'hui, à développer leur
productivité pour être plus compétitifs sur le marché international et combler ainsi leur retard
par rapport aux pays les plus riches. On sait qu'il n'en est rien et que les écarts continuent de
se creuser.
Jusqu'à quel point peut-on affirmer néanmoins que la mondialisation actuelle exprime une
tendance à la réalisation de ce marché mondial malgré les puissantes contre-tendances qui s'y
opposent et notamment le différentiel de productivité entre les pays dominants et les autres ?
Le débat reste ouvert. Sans ignorer l'approfondissement des disparités économiques et
sociales, Hardt et Negri concluent un peu rapidement, et sans démontrer empiriquement leur
thèse, que l'unification du marché mondial et d'ores et déjà une réalité.
La fracture Nord-Sud appartient selon eux au passé : « les divisions spatiales entre les trois
« mondes » (le premier, le second et le troisième, ou « tiers ») se sont brouillées au point que
l'on trouve continuellement le premier dans le troisième, le troisième dans le premier, et le
second presque plus nulle part ». La réalisation du marché mondial signifierait donc
l'achèvement du processus de subsomption réelle de toutes les formes économiques au capital.
En vérité, loin d'une homogénéisation du monde, le système de dominations et de dépendances
hiérarchiques demeure et s'appuie notamment sur la coexistence de marchés à productivités
différentes.
Le déclin définitif des États-nations ?
Le caractère évasif des analyses d'Empire concernant l'accumulation du capital conduit ses
auteurs à conclure trop rapidement à la fin des États-nations comme États souverains. Les
formulations sont flottantes mais la conviction de Hardt et Negri semble affirmée : « il n'y a
plus d'État-nation ». Dans un article intitulé « La multitude contre l'Empire », Antonio Negri
écrit : « L'ère de la globalisation ne met pas un terme à l'État-nation, qui continue à remplir
des fonctions utiles à la régulation économique, politique, et à l'établissement de normes
culturelles ; mais les États-nationaux ont bel et bien perdu leur rôle en matière d'autorité
souveraine. »
Les hésitations au niveau de l'expression renvoient peut être au fait que la notion de
souveraineté est, en réalité, mal délimitée. Les auteurs en parlent parfois comme de ce qui est
au principe même de l'État moderne, ce qui fonde l'autorité qui est la sienne et qui la légitime.
La remise en cause de l'État-nation se rapporte ici au rapport État/nation/peuple mais aussi à
la capacité de cet État-nation à se poser sur la scène des relations internationales comme acteur
indépendant. Parfois, encore, la souveraineté concerne ses « trois caractéristiques essentielles
- militaire, politique, culturelle ». Hardt et Negri nous renvoient ainsi aux fonctions régaliennes
ou se contentent de souligner la marge de plus en plus étroite d'intervention économique des
États. Les auteurs restent trop souvent approximatifs ou procèdent par généralisation d'une
tendance réelle mais contradictoire. La reconfiguration du monde, en cours, ne semble pas,
pourtant, pouvoir être synthétisée dans les termes univoques de déclin ou de disparition des
États-nations.
En réalité, la situation actuelle paraît plus complexe, caractérisée par une interrelation étroite
de décisions inter-étatiques, de coordinations entre États souverains et « leurs »
multinationales, et de décisions supranationales. Il s'agit peut-être là d'une forme structurelle
et non pas transitoire : l'ordre impérial mondialisé ne supprimant pas l'ancien ordre des
dominations inter-étatiques mais s'y superposant. Ainsi, la mondialisation capitaliste modifie
fortement les conditions dans lesquelles les États peuvent réguler leurs économies, désormais
largement ouvertes sur le marché mondial ; elle entame même dans une certaine mesure leurs
capacités de contrôle et d'initiative mais les États continuent de jouer un rôle décisif qui, selon
certains, auraient même tendance à s'accroître.
Dans un excellent article, où il démonte de manière empirique les conclusions d'Empire, James
Petras, universitaire de la gauche radicale américaine, affirme ainsi que les États impérialistes
sont en vérité des composantes de plus en plus importantes de l'économie mondiale. Il
rappelle le rôle croissant des États notamment pour gérer les crises financières et
économiques et cite les nombreuses interventions en ce sens des États-Unis ; il souligne
également le rôle des États dans la compétition inter-impérialiste et dans la concurrence entre
firmes pour la conquête de marchés ou la protection des marchés locaux.
Autant de faits
(James Petras est encore plus exhaustif) que Hardt et Negri reconnaissent parfois mais comme
de simples interventions techniques. Le plus souvent, ils choisissent d'insister plutôt sur
l'étroitesse des marges d'intervention économique des États. Un de leurs arguments, pour
démontrer le déclin de l'autorité souveraine des États, est la puissance des firmes
transnationales qui imposeraient désormais unilatéralement leurs choix aux États. Il est
incontestable que ces gigantesques entreprises, qui déploient leurs emprises sur tous les
marchés du monde, disposent d'un véritable pouvoir politique qui s'impose aux États comme
aux institutions internationales.
Là encore, cependant, les choses ne sont pas univoques et ce qui est en cours ne peut être
compris comme la simple soumission des États aux grandes firmes (ou à l'abstraction du
marché mondial) mais comme une ré-articulation de leurs rapports qui permette aux États de
garantir les conditions générales de l'accumulation, fut-ce parfois contre les intérêts immédiats
des multinationales. En tout état de cause, ces firmes géantes conservent des liens étroits avec
leurs marchés et leurs États d'origine.
L'économiste français Michel Husson donne à ce
propos des chiffres intéressants qui montrent que le marché intérieur continue « à jouer le rôle
de base arrière » des multinationales. Une étude du ministère français de l'Économie,
concernant les 83 000 filiales des 750 plus grands groupes mondiaux, établit que « les
multinationales sont en général les mieux implantés dans leur pays d'origine [...]. Près de la
moitié des effectifs des groupes implantés en Europe ne sont pas issus de groupes européens
lorsque les effectifs domestiques sont exclus [mais] ce chiffre est réduit à 10% seulement
lorsque sont pris en compte les effectifs domestiques. Ce chiffre de 10% est comparable pour
l'Amérique du Nord, et inférieur à 3% pour le Japon. Dans le cas de la France en particulier,
on peut noter que 77% des effectifs des groupes multinationaux présents dans notre pays
appartiennent à des groupes français, 12% à des groupes européens, et 11% à des groupes
d'autres nationalités ». James Petras, dans l'article précédemment cité, donne également de
nombreuses indications qui vont dans le même sens.
Même quand elles sont multinationales, les entreprises continuent de s'appuyer sur la
puissance militaire, monétaire et commerciale des grands États dont l'intervention est souvent
décisive pour la conquête et la défense des marchés, pour l'établissement de normes et de
règles qui leur sont favorables. Garantir les conditions de l'accumulation du capital, c'est
notamment garantir l'ordre social. L'État souverain reste, à ce titre, l'outil politique
indispensable des entreprises, les PME comme les immenses firmes transnationales. L'État
reste la source privilégiée du droit et la médiation toujours nécessaire pour que soient
adoptées, appliquées et acceptées les lois internationales. Il est vrai que des interventions
armées internationales ont servi à réprimer révoltes et révolution mais ce sont toujours et
encore les États qui ont pour charge le rétablissement de l'ordre et la coercition quotidienne. La
formule d'Engels assimilant l'État à une bande d'hommes armés est, certes, un peu rapide mais
l'État est aussi cela : une bande d'hommes armés pour prévenir et mater la rébellion de ceux
d'en bas. Au-delà des forces de coercition, l'appareil bureaucratique, la hiérarchie des
fonctionnaires qui constituent la chair de l'État, l'ensemble du personnel disciplinaire et de
contrôle, oeuvrant officiellement pour le « service public » et le bien commun, ont besoin d'un
cadre étatique au moins en partie souverain pour justifier leur emprise sur la société.
L'État réprime, encadre ; il assure également le consentement. Or celui-ci est un produit de la
souveraineté. Hardt et Negri consacrent de nombreuses pages à montrer les contradictions et
les limites de la notion moderne de souveraineté. Ils déconstruisent, de même, à juste titre les
notions de « peuple » et de « nation ». Cependant, ces mécanismes, mélange d'illusion et de
réalité, qui paraissent effectivement en crise aujourd'hui, sont pour l'heure toujours au
fondement des États, indispensables à la légitimation du système. Cette souveraineté semble
d'autant moins obsolète, en vérité, qu'on peut formuler l'hypothèse qu'elle n'est pas
l'attribut de la seule machine étatique (ou du peuple/nation par la médiation des procédures de
la représentation) mais de l'ensemble du système politique (la société politique et la société
civile dans leur acception gramscienne). La souveraineté outrepasse l'État comme machine ;
elle est un rapport, un rapport de forces éminemment contradictoire qui fonde le consentement
mais s'oppose en même temps à la complète dépossession politique du peuple. Elle est ainsi,
pour une part, le produit du « pouvoir constituant » (pour parler comme Negri) qui s'impose
à l'État.
Pour les auteurs d'Empire, ces modes de légitimation articulés autour du concept de
souveraineté seraient désormais anachroniques et vains. S'inspirant des travaux de Michel
Foucault, Gilles Deleuze et Felix Guattari, ils défendent la thèse d'un « nouveau paradigme du
pouvoir, dépassant en l'intégrant la « société de contrôle » (elle-même dépassant en
l'intégrant la « société disciplinaire ») pour constituer à l'échelle de l'Empire, un
« biopouvoir », combinant pouvoir, capture des corps et des affects, et production de la vie.
Dans ce paradigme, toutes les forces économiques, politiques, culturelles, toutes les forces de
la production et de la reproduction de la vie, sont happées par le capitalisme ; leur
subsomption, jusque-là simplement formelle, devient réelle. La communication, dans toutes
ses modalités, désormais au centre de la production, maîtrise la vie sociale et politique pour
devenir le vecteur privilégié de la légitimation.
L'actualité de la question nationale
La thèse de l'Empire conduit ses auteurs à sous-estimer considérablement l'efficacité des luttes
dans le cadre de l'État-nation. Par crainte de la réactivation d'un nationalisme rétrograde, ils en
arrivent nécessairement à se méfier des combats dont l'objet est de préserver les capacités
d'intervention économique des États notamment en ce qui concerne la réglementation des
échanges et des mouvements de capitaux. Leurs analyses unilatérales peuvent aboutir à
désarmer les mouvements populaires en particulier dans les pays dépendants. Quel projet de
développement est-il concevable si l'on rejette a priori toute forme de protectionnisme ?
Comment rompre la spirale du sous-développement et de la dépendance en dehors du cadre
d'un État souverain ?
« Dans le cadre de la thématique que nous avons proposée, déclare Toni Negri dans un
entretien fort intéressant à la revue Vacarme, n'importe quelle fonction souveraine comme la
Nation ou même une fédération de Nations est désormais complètement dépassée. » Negri
balaye en quelques mots la « classique objection léniniste » qu'il réduit à une simple
préoccupation tactique, avoir « un point sur lequel faire levier. » Dans Empire, il appelle, avec
Michael Hardt, à « refuser toute stratégie politique impliquant le retour à ce vieux dispositif
- comme de chercher à ressusciter l'État-nation pour se protéger contre le capital mondial ». Ce
jugement serait valable au Nord comme au Sud, indistinctement.
Les deux auteurs consacrent, en effet, un long développement pour expliciter leur démarche.
La distinction fondamentale mise en avant par Lénine entre le nationalisme réactionnaire des
pays dominants et le nationalisme progressiste des pays dominés n'aurait plus cours. Or, si
l'on ne peut qu'approuver leur diagnostic sur le destin dictatorial et réactionnaire des États
postcoloniaux, c'est-à-dire des mouvements nationaux institués, cela ne supprime pas le
caractère double, à la fois progressistes et réactionnaires, des mouvements nationaux
« constituants », qui luttent encore pour leur institution.
Ce potentiel progressiste ou, pour échapper à la connotation évolutionniste du terme, les
virtualités anti-coloniales et anti-impérialistes de ces mouvements ont justifié le soutien dont
ils ont bénéficié à juste titre. S'il est vrai, comme le soulignent les auteurs d'Empire, que
désormais les anciennes colonies sont bien souvent sous l'emprise de dictatures parfaitement
infâmes ; s'il est certain que la notion même de « bourgeoisie nationale » (toujours
problématique) n'a plus guère de sens aujourd'hui (les bourgeoisies des pays dépendants
fonctionnent largement comme relais du capital mondialisé), il n'en demeure pas moins que la
question nationale y reste d'actualité, concentrant les revendications de rupture avec les
mécanismes et les institutions qui reproduisent la dépendance, le déni de souveraineté et la
défense d'une identité opprimée.
Certes, le problème est plus complexe qu'au temps des colonies mais il ne peut se résoudre
non plus en ayant recours à une périodisation qui fait succéder l'Empire à l'impérialisme alors
que plus vraisemblablement les formes se superposent et s'entrelacent. Les peuples des pays
dominés s'opposent, d'une part, à des régimes politiques issus des processus de
décolonisation mais ils sont confrontés, d'autre part, à une forme de domination qui se
dédouble : la domination « classique » des États impérialistes et la domination du capitalisme
mondialisé qui outrepasse ces impérialismes. Malgré ses spécificités, le combat d'un peuple
soumis à une situation directement coloniale, comme c'est le cas du peuple palestinien,
n'échappe pas non plus à ces multiples déterminations.
Contre l'Empire ?
La définition que Hardt et Negri donnent de l'Empire est finalement assez désespérante : la
subsomption réelle par le capital de toute la vie et de la reproduction de la vie semble laisser
peu de place au désir de contestation. Tel n'est pas, cependant, leur avis. Les deux
philosophes-militants refusent aussi bien la thèse de la « fin de l'histoire » que le messianisme
catastrophiste de l'écroulement du capitalisme. Selon eux, « le paradoxe d'un pouvoir qui, tout
en unifiant et englobant en lui-même tous les éléments de la vie sociale (et en perdant du même
coup sa capacité de médiatiser effectivement les différentes forces sociales), révèle à ce
moment même un nouveau contexte, un nouveau milieu de pluralité et de singularisation non
maîtrisable - un milieu de l'événement ».
Loin, donc, de clore l'histoire, l'Empire libère un nouveau potentiel événementiel. Cependant,
les déchirures soudaines de l'Empire ne garantissent en rien l'émergence d'une alternative. Et,
pour conclure vite, il faut ajouter qu'il est difficile de suivre les auteurs lorsqu'ils évoquent,
comme mode de subversion, le jaillissement du désir et de l'expression polymorphe
d'individualités singulières et « nomades », constituant une « multitude », nouveau sujet de la
révolution dont il y aurait bien des choses à dire. Ils soulignent, certes, l'insuffisance de la
stratégie de la multiplication des « contre-pouvoirs » et insistent sur la nécessité de l'associer à
« l'insurrection » et au « pouvoir constituant » de la multitude, mais une telle démarche
stratégique, censée être isomorphe au pouvoir en réseau de l'Empire, risque de disperser
la multitude dans le labyrinthe impérial.
La problématique centrale du léninisme est « comment prendre le pouvoir ? ». Celle du
trotskisme est « comment prendre le pouvoir sans être pris par lui ? ». Michael Hardt et Toni
Negri se demandent, eux, « comment prendre un pouvoir qui n'existe plus, sans pour autant le
prendre ? ». Difficile, dans ces conditions, de ne pas craindre que le « contre-Empire » qu'ils
appellent de leurs voeux ne soit autre chose qu'un couteau sans lame et auquel il manque le
manche. « C'est justement là, répondront-ils, qu'il est le plus tranchant ! ».