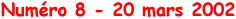Alternatives citoyennes : Le terme de Ijmâ, qui figure dans le titre de votre ouvrage, semble difficilement traduisible. À quoi renvoie donc ce concept ?
 Latifa Lakhdar : Al-Ijmâ est un principe d'autorité. Il traduit en même temps un grand pouvoir masculin ; c'est donc une institution « morale » qui cumule deux armes redoutables. C'est le troisième fondement de ce qui est appelé par le savoir islamique Usūl al-fiqh. Disons que l'expression pratique ou opérationnelle de ces Usūl (ou fondements du droit musulman) a fini, à travers un parcours historique compliqué et difficile à résumer ici, par dominer toute la pensée musulmane classique orthodoxe, ainsi que la pensée néo-orthodoxe, aux dépens de la théologie comme champ de réflexion qui appelle une « confrontation » continuelle avec la philosophie et avec l'histoire. Or nous sommes là devant le point le plus problématique de la pensée musulmane ; l'hégémonie de l'esprit juridique va déboucher sur une situation religieusement « paradoxale » et historiquement dépourvue de perspective.
Latifa Lakhdar : Al-Ijmâ est un principe d'autorité. Il traduit en même temps un grand pouvoir masculin ; c'est donc une institution « morale » qui cumule deux armes redoutables. C'est le troisième fondement de ce qui est appelé par le savoir islamique Usūl al-fiqh. Disons que l'expression pratique ou opérationnelle de ces Usūl (ou fondements du droit musulman) a fini, à travers un parcours historique compliqué et difficile à résumer ici, par dominer toute la pensée musulmane classique orthodoxe, ainsi que la pensée néo-orthodoxe, aux dépens de la théologie comme champ de réflexion qui appelle une « confrontation » continuelle avec la philosophie et avec l'histoire. Or nous sommes là devant le point le plus problématique de la pensée musulmane ; l'hégémonie de l'esprit juridique va déboucher sur une situation religieusement « paradoxale » et historiquement dépourvue de perspective.
On peut résumer cette situation par l'institution - à travers l'organisation des « sciences charaïques » - d'une mécanique qui consiste à dispenser la foi par la loi. Or autant la foi peut être un champ de « perte » dans le sens philosophique, dans le sens du dépassement et dans celui de l'amour, autant la loi veut dire un mouvement de fermeture et de rigidité. Ainsi l'Islam se trouve réduit à des expressions juridiques, à la Charïa (ensemble de lois), ou même encore aux hudūd (ensemble de lois punitives). On comprendrait facilement dans ce cadre que le Coran, discours fort, philosophique, transcendant, en tombant sous la coupe des a priori de cette théologie juridique, soit appauvri et aseptisé par rapport à sa dimension humaniste et existentialiste, et que cette dialectique négative prenne de l'importance à mesure que l'ambiance où régnait la discussion libre et les polémiques enrichissantes à l'époque classique de l'Islam ne sont plus qu'un lointain souvenir.
A.C. : Dans ce contexte de fermeture et d'appauvrissement, que devient le statut de la femme ?
L.L. : La femme musulmane est évidemment le maillon le plus faible - nous n'avons pas besoin de le démontrer - et, dans un tel contexte de rétrécissement et de dogmatisme, il n'était pas difficile de lui faire subir les effets d'une vision essentialiste, sexiste, comme il était aisé pour les Ulémas, d'en faire l'objet d'une construction religieuse prétendant tirer sa légitimité du discours divin. Par cette construction et à travers le statut qu'on lui a octroyé, la femme est placée dans l'espace du sacré. Or le sacré défie l'histoire et cherche toujours à se situer en dehors de toute historicité : c'est déjà là la plus grande manoeuvre de marginalisation. Mais, un démontage de cette construction nous permet de saisir que les rapports entre les deux sexes dans cet espace musulman sont établis sur la base d'un pouvoir masculin, représenté par les Ulémas, intellectuels organiques d'une société patriarcale misogyne, et que ce pouvoir se traduit par un Ijmâ. Je tiens à dire que Ijmâ est pris ici dans le sens de l'unanimité et non dans celui de consensus parce que consensus suppose discussions et concessions de part et d'autre, ce qui n'est pas du tout le cas pour notre sujet. Unanimité donc autour d'un statut et d'une mise en représentation de ces rapports en tant qu'on les considère comme preuve de vérité divine : voilà le sens de mon titre.
A.C. : On connaît les résultats de cette construction idéologique, infériorisant la femme au plan de son statut dans le mariage, de l'héritage, du témoignage, du voile, bref de toutes les formes de domination masculine. Comment tentez-vous de déconstruire ce système ?
L.L. : Je suis partie du constat suivant : les historiens s'accordent plus ou moins pour dire que l'histoire musulmane se divise en quatre périodes essentielles :
(1) la période fondatrice (prophétique et celle des Rashîdîne) ;
(2) la période classique, créative, où l'Islam s'impose comme culture et comme civilisation à
dimension universelle ;
(3) la période de décadence politique et culturelle, marquée par le dogmatisme et l'hégémonie
de l'esprit mythique et irrationnel ;
(4) la période de la Nahdha, qui représente un intermède libéral.
Demandons à la femme si elle a été actrice active lors de ces différentes périodes de l'histoire
musulmane, sa réponse sera sūrement négative (mise à part l'histoire des exceptions ou celle
que Joan Kelly appelle l'histoire compensatoire).
Devant cela, on ne peut que s'interroger sur les mécanismes qui sont intervenus dans sa
marginalisation.
On pourrait m'objecter que de toutes les façons la femme était dans une situation universelle
de marginalisation, surtout avant l'histoire moderne. Il est évident qu'un esprit critique
comparatiste ne peut pas perdre de vue cette réalité ; mais cela n'explique rien. Ce qui
m'intéresse, c'est de voir les mécanismes par lesquels furent fixés les rapports entre les sexes
dans l'espace musulman.
Ces mécanismes se traduisent sur le champ social ; il n'est pas nécessaire de dire qu'ils en sont en même temps et d'une certaine façon le reflet, c'est évident et c'est là le champ de la
sociologie. Mais il est important pour l'historien de la culture de les saisir là où ils se situent
en plus clair, c'est-à-dire au niveau du savoir religieux musulman. À ce point-là, je peux dire
que la pensée de Michel Foucault a été pour moi d'un grand apport, car quand on procède à
l'analyse du savoir religieux musulman dispensé autour de la question des rapports entre les
deux sexes, quand on traite du Fiqh, du Hadith, de l'exégèse, de l'histoire (considérée au
début comme branche des sciences religieuses), quand on soumet ces disciplines à une
approche critique, on ne peut que se rendre compte que ce savoir n'a aucune neutralité et qu'il
reflète en profondeur un rapport de pouvoir immense auquel l'homme soumet la femme. En
utilisant la démarche qui consiste à faire « l'archéologie du savoir », j'ai eu à constater que ce savoir ne tire pas sa légitimité du sacré comme il le prétend, mais d'une certaine lecture, d'une certaine orientation et d'une certaine façon d'agencer ce sacré, opérations qui se sont déroulées sans aucune participation féminine réelle et sans aucune présence qui tienne compte de la sensibilité féminine et qui s'étaient déroulées contre les femmes.
Cette démarche a permis de remettre en cause beaucoup d'évidences et de démystifier
quelques « vérités » :
- celle qui dit que le hijab (ou le voile) est une loi divine éternelle et incontestable ;
- celle de la femme créée à partir de la côte inférieure d'Adam, ce qui connote qu'elle n'est que dérivée et donc qu'elle est création de deuxième degré ;
- celle de Aïcha, « la mère des croyants », femme heureuse et source prétendue de la « moitié des lois charaïques », y compris celles qui consacrent l'infériorité des femmes, alors même qu'elle fut attaquée, culpabilisée, diffamée et malmenée par ses contemporains jusqu'à lui faire perdre toute crédibilité, je pourrais en citer d'autres...
A.C. : Votre démarche intellectuelle, de ce point de vue, apparaît aussi comme celle d'un savoir engagé ?
L.L. : Oui, j'ai fait ce livre pour mettre la recherche historique au service des sollicitations du temps présent dans une perspective militante, sans sortir des règles de la rigueur, c'est ma quête à travers ce livre et aussi parce que je suis convaincue qu'on ne peut pas prétendre à « la citoyenneté libre du monde » dans la facilité et sans avoir acquis au préalable la liberté que doit nous procurer la « thérapie » de réflexion et de réponse concernant des interrogations que nous adresse notre propre culture. La souveraineté et l'autonomie intellectuelle - un peu dans le sens kantien - sont les plus grands principes de la laïcité et, à mon sens, l'appartenance à l'universel les exige très clairement.