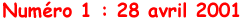istorien, islamologue, Hichem Jaït est l'auteur d'ouvrages sur la personnalité et le devenir
arabo-islamique, pour reprendre un de ces titres qui cristallise l'axe essentiel de sa réflexion
de chercheur. L'ensemble de cette réflexion a connu une très large audience et discussion dans
l'environnement directement concerné mais aussi dans des cercles beaucoup plus large, à
l'échelle mondiale.
istorien, islamologue, Hichem Jaït est l'auteur d'ouvrages sur la personnalité et le devenir
arabo-islamique, pour reprendre un de ces titres qui cristallise l'axe essentiel de sa réflexion
de chercheur. L'ensemble de cette réflexion a connu une très large audience et discussion dans
l'environnement directement concerné mais aussi dans des cercles beaucoup plus large, à
l'échelle mondiale.
Cet intellectuel de grand talent et de grande notoriété n'hésite pas à sortir de sa tour
d'ivoire pour des engagements publics forts sur des sujets graves, tels l'indépendance, la
justice ou la liberté d'expression et de création. Ses prises de position le conduisirent devant
la justice en 1989 et à diverses formes de pression, enfin à une prompte mise à la retraite de
sa carrière de professeur d'université, une fois ses soixante ans atteints, alors que l'État
n'hésite pas à reconduire dans leurs exercices universitaires, d'obscurs et poussiéreux « Bac+7», zélés serviteurs du régime et baptisés « intellectuels » !
Hichem Jaït n'en a cure. Après un parcours souvent solitaire, il s'est fait un grand nom et il
est tout à la fois, l'honneur de l'élite pensante tunisienne et le recours du mouvement
démocratique qui sait de quel poids peut être l'engagement de Hichem Jaït à ses côté. Parce que
Hichem Jaït est un intellectuel exemplaire, engagé, celui dont Michel Foucault disait qu'il se
tient dans le guet de l'histoire, chaque fois qu'une idée singulière peut la faire avancer, et
en première ligne de la résistance, chaque fois que le pouvoir politique s'attaque à
l'universel.
Or, aujourd'hui, l'universel c'est le respect de la dignité humaine, de sa liberté, de son droit
et cela seul construit le patriotisme, façonne les générations à venir, l'identité d'un pays
dont il n'aura pas à avoir honte mais à s'enorgueillir.
Nadia Omrane : Vous avez eu par le passé des engagements publics retentissants, puis vous vous êtes
retiré dans votre tour d'ivoire. Aujourd'hui, vous en ressortez de manière très remarquée.
Pourquoi maintenant et par la cosignature d'un manifeste ?
Hichem Jaït : Pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a des problèmes qui se posent, tout de même,
de manière parfaitement ciblée sur le plan du temps, à savoir, la reconduction ou non du
président de la République actuel en 2004. C'est un problème qui préoccupe l'élite, l'élite
pensante, parce que constitutionnellement, comme chacun sait, le président n'a pas le droit de
se représenter. De son côté, il semblerait qu'il pourrait y avoir un désir de sa part de le
faire, en remaniant la constitution ou par référendum, comme d'autres chefs d'État dans le monde
arabe - je pense à Moubarak, par exemple.
D'autre part, je pense aussi qu'au bout de 17 ans de pouvoir - cela sera le cas du président Ben
Ali en 2004 - le pouvoir use fatalement, que ce soit dans les pays développés ou non. C'est
énorme, 17 ans. Les gens ont besoin de changement. C'est évident et notoire dans les pays
industrialisés et démocratiques. Mais même dans les pays comme les nôtres, c'est difficile de
« se taper » 30 ans de Bourguiba et peut-être 30 ans de Ben Ali. Cela fait des régimes stables et
dans un certain sens, c'est bon. Mais d'un autre côté, cela empêche un renouvellement de la
pensée, des horizons, des hommes etc.
Je voudrais ajouter surtout que depuis tout ce temps, j'ai toujours souhaité qu'il y ait un jour
ou l'autre, une espèce de changement politique, d'autant qu'il n'y a presque plus d'opposition, de
fait. Or, il ne s'est rien passé de tel. Donc à mon sens, je doute que dans le cadre d'un
prolongement de l'actuel mandat présidentiel, il y ait un changement de politique, parce qu'il y
a toujours des habitudes qui sont prises, dont il est difficile de se déprendre, parce que les
mêmes hommes sont là, exécutant ce type de politique et il est difficile de les changer. De
sorte que je ne crois pas du tout à une possibilité de changement.
Enfin, la situation des libertés est arrivée à un tel point que nous ne pouvons qu'exprimer
notre désir de liberté, j'allais dire d'un minimum de liberté, qui n'existe même pas. Chaque
fois que j'ouvre un journal national, en arabe ou en français, c'est du néant. La censure,
l'autocensure et surtout l'obsession du politique sur un fond d'inexistence du politique sont
tout à fait harassantes. On ne voit guère de perspectives.
En ce qui me concerne personnellement, je me suis retiré pour travailler parce que je considère
qu'à long terme, c'est mieux pour tout le monde, pour moi-même, pour mon pays, pour mes élèves,
pour ceux qui me lisent. Mais il faut que l'intellectuel en tant que tel, de temps en temps - et c'est
ce que j'ai toujours fait - exprime une position.
N. O. : Justement, d'autres personnalités, des universitaires particulièrement, ont également
signé ce manifeste, alors que jusqu'ici ils étaient restés bien silencieux. Est-ce un fait
notable, d'après vous ?
H. J. : Oui, c'est un fait notable. Cela marque que les gens n'ont plus peur, qu'ils ont
pris leurs responsabilités. Ces intellectuels sont l'élite de la nation et il s'agit d'une élite
désintéressée. Il y a d'autres élites, économiques et autres, mais elles sont tenues par leurs
intérêts. Les universitaires, les enseignants des lycées et collèges, les avocats, etc., sont une
élite qui pense et qui n'est pas tenue par des intérêts matériels. Elle est l'élite du pays en
ce sens qu'elle peut exprimer l'opinion générale. Cela a toujours été le cas. Je vous donne un
exemple. Dans les débuts de la IIIe République en France, dans la représentation parlementaire
- le pouvoir se trouvant dans le parlement - le recrutement se faisait essentiellement chez les
avocats qui, n'étant pas tenus par des intérêts particuliers forts, avaient le sentiment de
pouvoir représenter le peuple. Plus tard, dans la IIIe République des professeurs, c'étaient les
intellectuels qui pensaient et entendaient représenter les intérêts de la nation. Voilà, tous
ceux qui ont quelque chose dans la tête, qui peuvent avoir une représentation du tout-social et
qui ne sont pas engagés par des intérêts de classe, même s'ils n'ont pas tout à fait l'écoute de
l'homme de la rue - chose qu'ils pourraient avoir d'ailleurs, s'il y avait des libertés, car ils
ont toujours des idées à proposer - représentent la quintessence de ce que peut être une nation.
Une nation, ce n'est pas le grand nombre, et encore moins le grand nombre qu'on amène par camions
pour applaudir ou qu'on terrorise par la menace de perdre un emploi ou qu'on séduit par la
promesse d'avoir un emploi ou des avantages ; non, il y a l'âme d'une nation et ce sont les gens
qui ont des idées et des projets à proposer. On nous demande quel est notre poids, eh bien, il
est moral et important. La preuve, c'est que chaque fois qu'il y a eu destruction d'un peuple,
on commence par détruire ses intellectuels.
N. O. : En dehors de ces idées fortes sur le nécessaire positionnement de l'intellectuel,
qu'y a-t-il de particulier dans ce manifeste (hormis la question de l'alternance et de
l'ensemble des libertés publiques) qui vous a retenu, y a-t-il quelque chose qui vous semble
manquer ?
H. J. : D'abord, ce manifeste a été signé par des intellectuels, au sens large du terme,
il y en avait 80 déjà quand je l'ai signé, et ce sont des gens pour lesquels j'ai de l'estime
et qui, jusqu'ici, ne s'étaient pas manifestés.
Ceci est tout à fait remarquable, car il ne s'agit pas d'une dizaine de personnes
professionnelles de la politique, mais d'un mouvement de fond qui s'amorce et d'une véritable
prise de conscience. Ce manifeste clos à 130 signataires d'universitaires, de médecins,
d'avocats et de journalistes me paraît très important. Car il faut aussi qu'il y ait toute une
catégorie de compétences, parmi les meilleures, qui réfléchissent au destin de leur pays et qui
le disent clairement.
Quant au contenu du manifeste, bien évidemment, j'étais d'accord avec l'essentiel. De toutes
façons, ce sont des idées que tout le monde partage et il est temps de le dire à la clarté du
jour. En plus, c'est un texte modéré, qui revient à l'historique des choses, qui a une
perspective historique. Il dit ce que nous sommes, ce que nous attendons, ce que les générations
futures devraient espérer. Il y a un sens patriotique évident là-dedans qui surplombe le
quotidien et la politicaillerie.
N. O. : Ce manifeste, paru le 20 mars, n'est pas le seul. Un texte plus ramassé et portant
sur les revendications essentielles du mouvement démocratique, issu - dit-on - du Forum du Dr
Ben Jaâfar et signé par 270 personnes, a également été rendu public. Concomitamment, Rachid
Ghanouchi, l'émir réélu à 75% des voix par le mouvement En-nahdha (islamiste) et Mohamed
Mouadda, Secrétaire général du MDS dans les instances qui ne sont plus légales, ont porté à
l'attention du mouvement démocratique un texte globalement proche dans son contenu - au plan des
revendications démocratiques - mais plus radical. Cependant, une petite phrase précise que c'est
dans le cadre de l'identité arabo-musulmane et des valeurs civilisationnelles que se défendent
le projet démocratique, les droits humains et les droits des femmes. Face à cette petite
phrase, un certain nombre d'acteurs du mouvement démocratique considèrent qu'il s'agit là d'une
limitation grave, sinon d'une dénaturation du combat démocratique, voire d'une imposture.
Êtes-vous d'un tel avis ? Pensez-vous que les droits humains, valeurs universelles, soient
réductibles à un contexte identitaire ? Ou jugez-vous qu'ils puissent être traduisibles en
termes identitaires spécifiques et que cela soit pour certaines sociétés une voie passante ?
H. J. : Je n'ai pas lu ces textes, on ne me les a pas soumis. J'ai l'impression que le
manifeste que j'ai signé a entraîné un mouvement, c'est une bonne chose et je ne vois pas comme
une concurrence que les gens s'expriment dans le sens des libertés.
Votre question est cependant ciblée, je vous dis tout de suite que les droits humains sont
universels et qu'il ne saurait y avoir (car figurez-vous qu'il y en a eu) de charte possible
parlant des droits de l'homme musulman. Les libertés sont universelles. Elles sont une valeur
moderne et cela n'est pas parce qu'elles sont modernes qu'il faut y renoncer. Cela fait partie
des apports fondamentaux et positifs de la modernité. Je ne cesse de le répéter : tout ce qui
parle de manière universelle à l'esprit, au droit, au coeur humain, à la justice, porte quelque
chose de moral, l'idée du Bien. Être libre, c'est un bien ; donner son droit, c'est un bien, un
bien moral naturellement, respecter l'individu, c'est un bien.
Toute la démocratie se fonde sur un postulat philosophique qui est le respect de la dignité de
l'homme. C'est une nouveauté dans l'horizon de l'histoire humaine. C'est la modernité morale,
éthique et, par conséquent, politique.
D'autre part, je ne vois pas en quoi l'identité arabo-islamique est menacée en Tunisie. Je le
dis d'autant plus facilement que j'ai écrit un livre sur l'identité arabo-islamique, pour
l'ensemble du monde arabe, il y a longtemps. Actuellement, ni la pratique de la langue ni celle
de la religion, que ce soit par une vraie croyance interne ou pour des raisons sociologiques et
culturelles, ne sont menacées en Tunisie ni par l'État, ni par la majorité de la population, ni
même par les intellectuels.
Je suis, bien sûr, pour la liberté de conscience. Si on interprète l'identité arabo-musulmane
dans le sens d'un retour à la Chariaâ, je dis clairement : « non », car il faut une
sécularisation judiciaire et législative et dans le monde social. Mais si, au contraire, on
l'interprète comme une appartenance à une aire culturelle, comme on parle d'européanité ou
d'americanité, alors, bien sûr, il y a toujours un fond historique, et les fondements culturels
arabo-islamiques sont clairs à mes yeux.
Vous savez, la démocratie se fonde sur un consensus et elle ne peut fonctionner que sur des
consensus.
N. O. : Peut-il y avoir un consensus entre le mouvement islamiste qui, aujourd'hui, en tout
cas dans le discours d'En-nahdha, s'active dans le terrain démocratique et une frange du
mouvement démocratique, qui se revendique comme laïque et articule le projet démocratique à la
laïcité ?
H. J. : je ne vois pas en quoi le mouvement démocratique demande à être laïque. Il faut
faire très attention. Si on entend par « laïque » la séparation de l'État et de la religion, pour
l'instant on n'en est pas là et c'est un problème vaste. S'il s'agit d'une sécularisation de la
législation, nous y sommes depuis bien longtemps, depuis le XIXe siècle.
Mais si on considère la laïcité sur le modèle français avec un fond d'hostilité à l'Église,
personnellement, je dis « non ». Je ne suis pas hostile aux moeurs islamiques de ce pays, chacun
est libre de toutes manières. Et, cela va de soi, chacun est libre dans le respect de la loi.
Car pour nous, qui avons signé ce texte, la démocratie n'est pas un concept dilué, ni une
auberge espagnole, mais c'est quelque chose autour de quoi doit se faire un consensus national.
L'appartenance à un courant démocratique est capitale, car il s'agit de la mise en place d'un
véritable changement social, culturel et politique.
N. O. : À votre avis, le mouvement islamiste tunisien, En-nahdha, tel que vous le connaissez,
peut-il appartenir à ce mouvement démocratique et participer à la conduite du changement que
vous venez d'évoquer ? Il propose un discours rénové, se réclame des droits de l'homme et
dénonce la violence, en appelle à une synergie avec tous les démocrates. Il a tenu son congrès
en toute transparence, mais dans ses résolutions, s'il s'inscrit dans la généalogie des
réformateurs musulmans, il gomme Tahar Haddad de cette filiation et dénonce à partir de
l'indépendance, la reconduite par les successeurs du Protectorat, de l'occidentalisation
acculturatrice et il n'évoque même pas la forme républicaine de l'État. À la tribune du Congrès
se trouvait une fraternité islamiste, un Ayatollah, des Frères musulmans, un proche de Hassen
Tourabi etc.
Quelle sémiologie pourriez-vous conduire, comment interpréter la contradiction de ces signes
qu'il donne ? Ou, n'est-ce pas, après tout, qu'une façon d'évoluer, peut-être difficile,
peut-être ambiguë, mais tout de même positive ? Est-ce que ce sont des signes auxquels il faut
s'arrêter, ou faut-il se dire que le consensus se fait pour un changement démocratique et que
c'est là l'essentiel ?
H. J. : Vous savez, Rached Ghanouchi me paraît, d'après ce qu'il écrit, être un islamiste
modéré. Mais il doit y avoir des mouvances diverses et puis, il faudrait savoir dans quelle
mesure R. Ghanouchi tient toute la mouvance islamiste. Il faut faire cette hypothèse que les
modérés peuvent être dépassés par les extrémistes.
Ceci est à voir. Mais sur le plan du fond, il n'est pas bon d'exclure du mouvement démocratique
n'importe quelle tendance, dans la mesure même où cette tendance déclare admettre la démocratie
et les libertés fondamentales. D'autant qu'on ne peut pas refuser à quiconque d'avoir ses
propres idées. Cela fait partie des risques de la liberté. Et c'est pour cela que la liberté
doit avoir de bons défenseurs, doit être transparente, doit inspirer confiance au public, à la
population. Il n'y a pas lieu de craindre le moindre débat et la démocratie est débat.
Supposons que demain, par extraordinaire, il y ait en Tunisie un parlement pluraliste qui
contienne 10 à 15 % d'islamistes. Je ne vois pas pourquoi ce serait quelque chose de
catastrophique. Cela serait faire preuve d'une grande fragilité et d'un manque de confiance en
soi que de se dire que ce serait un danger. Non, je ne vois pas que ce serait un danger.
Qu'il y ait en face un courant laïciste, tous s'exprimant dans une enceinte légale, à la bonne
heure !
N. O. : Ne courrait-on pas à un affrontement ?
H. J. : Non, mais il faut qu'il y ait une majorité de gens attachés à la pratique
démocratique. Et pour cela, il faut du temps. Il faut éduquer les gens à l'exercice de la
démocratie. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler tout de suite de démocratie. Il faut une
période de transition démocratique. Il faut une mutation vers les valeurs démocratiques, par les
institutions. Dans un deuxième temps, il faut une éducation à ces valeurs, à la base, à l'école.
Cela prendra une génération.
Mais il faut que les institutions s'installent d'abord, avec un respect - et de bonne foi ! -
pour ces institutions. Alors, la mutation psychologique, morale peut se faire pour la
démocratie, une démocratie saine et noble, et cela après une génération, peut-être deux.
C'est-à-dire, quand cela s'incruste dans les esprits. Alors, on s'attachera à son pays non pas
par un patriotisme aveugle, mais parce que c'est un pays qui représente des valeurs et ces
valeurs, ce sont les valeurs de l'homme.
N. O. : Alors vous êtes optimiste sur un avenir démocratique pour la Tunisie ?
H. J. : Oui, vous savez, je vous parle maintenant en patriote. J'aime mon pays, j'y ai été
heureux pendant 20 ans. Après les choses en ont été autrement. Nous sommes un petit pays, nous
n'avons pas beaucoup d'argent - ce qui n'est pas une mauvaise chose -, nous avons une bonne
élite, nous avons été colonisés par la France qui est tout de même le centre de la culture
européenne - davantage que l'Allemagne - et, une fois dépassée cette situation, c'est un peu une chance, car la
France nous est un bon modèle, moins autoritariste que les USA. Nous représentons peu de
choses au niveau du monde arabe, compte tenu de nos ressources, mais nous pouvons offrir - étant
donné notre histoire, notre position géographique - un magnifique exemple pour le monde
musulman. Bourguiba, à qui je reproche beaucoup de choses, a apporté sa pierre à l'édifice en
libérant la femme et en permettant une forme de libération de l'esprit. Il fut un temps où
j'appréhendais notre environnement. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation économique et
technologique, il me semble que nous pouvons donner une chance à nos nouvelles générations. Nous
sommes responsables de nos enfants, de nos petits-enfants, de notre jeunesse et nous pouvons les
amener sur les chemins de la culture et de la civilisation, de la démocratie, mais d'une
démocratie graduelle. Car, je ne suis pas, non plus, de ceux qui mettront dès le départ en
cause l'autorité de l'État et de la cohésion sociale.
Je suis absolument contre toute anarchie et contre toute guerre civile dans ce pays. Il faut
aussi une certaine forme de responsabilité. S'il faut une période de transition, il faut que
cela soit une transition tranquille.
N. O. : Et dans cette attente, comment vivez-vous votre condition d'intellectuel ? En
êtes-vous satisfait ?
H. J. : J'en suis satisfait puisque je l'ai choisie, mais d'un autre côté, ce n'est pas
facile d'être un intellectuel en Tunisie. Le régime n'aime pas les intellectuels quand ils font
leur métier d'intellectuel, à savoir produire et non seulement contester, et deuxièmement
exprimer un point de vue quand ils le peuvent.
N. O. : Vous-même, au moins, vous avez pu produire ?
H. J. : Produire oui, mais avec certaines difficultés. Car j'ai été sous Bourguiba et sous
Ben Ali plus au moins réprimé. Et sous Ben Ali davantage car j'ai été psychologiquement réprimé.
J'ai pu produire, mais il a fallu beaucoup de volonté. Et il y a aussi la société telle qu'elle
a été façonnée par 50 ans d'histoire et pour tout dire, 50 ans de dictature car Bourguiba était
aussi un dictateur, et la dictature n'a jamais été quelque chose de satisfaisant pour la
liberté de l'esprit, pour le respect de la culture et de la création.
Cet état de dictature a perverti la société de telle sorte qu'elle est devenue très
matérialiste. Dans le passé, elle était aussi complètement focalisée sur les fonctions de
pouvoir. Elle a perdu cette espèce de flamme que lui ont donné deux éléments d'avant
l'indépendance. D'abord le respect du savoir, chez nos anciens, la civilisation islamique est
une civilisation du savoir dont les dernières traces ont été éliminées par la réussite
politique.
Et puis du côté de la France, dans les années 50, quand se dessinait ma vocation d'intellectuel,
il y avait aussi un grand respect de la culture. Certains restes de cela demeurent en dépit des
pressions d'une post-modernité très technique et financière.
La Tunisie a perdu ces dimensions à cause de la prépondérance de la politique de la course aux
fonctions, à l'argent - c'est moins évident au Maroc.
Aussi, c'est une société qui dans ses larges composantes, accorde peu de place aux choses de
l'esprit et aux intellectuels.
Aussi, certes j'ai réussi en tant qu'intellectuel à me frayer un chemin, mais ce fut pour moi un
long combat, sans grand encouragement et très solitaire.