|
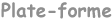



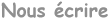

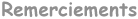
Partager
|
6 avril 2011 : célébration de la mort du loup
Ce 6 avril 2011, s'est entreprise la réhabilitation de Bourguiba, sur
plusieurs media et particulièrement à l'initiative de Nessma TV dont le
producteur est son propre neveu Tarek Ben Ammar, ainsi qu'à Monastir,
ville natale de l'ancien président, où pour la première fois depuis sa
mort en 2000, la population lui rendit un fervent hommage. Car depuis
dix ans, sa disparition était commémorée en catimini, à l'abri des
regards, ainsi qu'il finit ses jours, non pas dans son palais de Skanès
mais sous les hautes murailles de la résidence du gouverneur, en une
mort du loup qu'il aimait déclamer.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le Sort a voulu t'appeler,
Puis après comme moi, souffre et meurs sans parler
(Alfred de Vigny)
En effet, le président déchu Ben Ali avait pris ombrage de la stature et
de la statue du père de l'indépendance qu'il avait déboulonnée de son
piédestal, quelques semaines après le coup d'État du 7 novembre,
marquant ainsi « la fin d'une époque » ainsi que nous
le titrions dans la revue Le Maghreb. Il avait mis un zèle
tout particulier à l'effacer de la mémoire collective, faisant des jours
fériés de sa gloire de simples jours ordinaires et ramenant le
Combattant suprême au statut banalisé des autres résistants de la lutte
nationale. Les thuriféraires de l'ancien dictateur avaient tenté de
rehausser ce nain politique que fut Ben Ali au niveau de Bourguiba,
décuplant la dimension des portraits géants dont ils affublaient le
coeur des villes tandis que ses historiographes cherchaient à lui donner une
épaisseur grossière, à défaut de la densité du vieux Zaïm.
Faut-il pour autant procéder à une béatification de Bourguiba ?
Non, car il ne fut pas un saint. Lui-même avait inauguré sa propre
historiographie, d'une façon parfois même cocasse, ponctuant le récit de
son destin qu'il faisait à la chaire de la faculté de droit, de
l'accident d'un testicule non descendu, ce qui eût pu changer le cours
des choses, à la manière du nez de Cléopâtre !
Autoritaire, dans un « paternalisme débonnaire »
selon l'expression de Jean Lacouture, il n'hésita pas à se faire père
fouettard, tyrannique, très dur avec des jeunes opposants
perspectivistes, communistes, baathistes, puis de l'Unité populaire,
qui après avoir été torturés, laissèrent dans les geôles du Bourguibisme
aujourd'hui magnifié les plus belles années de leur vie. Il expédia
aussi les étudiants rebelles se faire quelquefois mordre par les chacals
au camp de Rjim Maâtoug, en plein Sahara, qui devint l'oasis luxuriante
qu'on connaît aujourd'hui.
Il fut aussi impitoyable avec ceux qui lui disputaient le pouvoir, tel
Salah Ben Youssef qu'il fit assassiner en Suisse, et avec les militaires
du complot de 1962 éventé par un spécialiste des renseignements (devinez
qui...). Il fit, raconte un avocat de la défense, dissoudre à la chaux
vive les cadavres des insurgés de Gafsa (janvier 1980), après leur
pendaison.
Il fut très répressif contre le mouvement syndical, embastillant en
janvier 1978 le vieux lion Habib Achour dont la verve tribunitienne
étouffait ses propres talents d'orateur. En cela, il devait se ranger au
côté de la bourgeoisie, lui le père des pauvres et des humbles qui ne
chercha jamais à s'enrichir lui-même. De même, il fit donner les armes
contre les paysans soulevés contre les coopératives à Ouardanine, en en
faisant porter la responsabilité sur son quadruple ministre Ahmed Ben
Salah, ainsi qu'un enregistrement d'une Radioscopie de Jacques
Chancel le répétait en boucle le 20 mars 2011, sur les ondes de Radio
Tunis. Avec le même machiavélisme (au sens politique du terme), il tira
son épingle d'un jeu sinistre contre les émeutiers du pain, faisant
sauter le fusible Mohamed Mzali et redorant sa popularité. Il était
toujours « malade », dans l'ignorance des méfaits des uns et
des autres, mais - même en dehors des affaires politiques -
sans coeur pour la mère suppliante à qui il refusa la
grâce pour son fils adolescent Jamel, pendu le jour de ses 20 ans pour
un meurtre pour lequel il avait toutes les circonstances atténuantes
(cf. Le Maghreb, 1988).
Il aurait même refusé de gracier les quelques émeutiers du pain
condamnés à mort (janvier 1984), n'était le formidable mouvement
d'opinion contre la peine de mort soulevé dans la société civile et
n'était l'intervention de son épouse, Wassila Ben Ammar : la
première dame de Tunisie fit souvent des incursions dans la politique et
fut au coeur de quelques intrigues et ramifications familiales ou
tunisoises mais avec plus de distinction et moins d'apprêt que celle
qui, ces dernières années, lui succéda à ce rang, en déclassant la
fonction et provoquant sa détestation.
À l'évidence, Bourguiba ne fut pas un saint homme. Fut-il au moins un
grand chef d'État ? On le dit visionnaire, anticipant sur le cours
de l'histoire, surtout pour la question palestinienne. Mais se mesurant
au plus grand, au général de Gaulle, plus dans une obstination
narcissique que patriotique, il envoya à Bizerte de jeunes recrues à la
boucherie, ce que ne lui pardonneront jamais les familles du lieutenant
Mohamed Aziz Taj et du commandant Mohamed El Bejaoui (cf.
Réalités, octobre 1991).
Mais il faut rendre à César ce qui revient à César. C'est Bourguiba qui
construisit l'État tunisien sur ces deux piliers que sont l'éducation
généralisée et gratuite et le statut libre et égalitaire des femmes
tunisiennes : l'éducation posa les bases d'une administration de
grands commis de l'État, d'un personnel politique et d'une
intelligentsia qui permettent jusqu'à aujourd'hui à la Tunisie de
traverser toutes les turbulences sans vraiment vaciller ; le Code
du statut personnel a assuré la notoriété internationale d'une
tunisianité moderniste et rationaliste.
Avec « la foi dans l'homme » qu'il professait et
portait par le mouvement émancipateur de la Nahdha des années
30, inspiré par les Lumières de l'occident, ce despote éclairé sema les
graines de la démocratie sans en permettre la florescence, en éternisant
sa présidence.
Dans sa conception civile et laïcisante du vivre-ensemble en Tunisie, il
maintint à l'écart des affaires publiques la religion et l'armée. La
seconde, loyale pour l'essentiel et protectrice jusqu'à aujourd'hui,
enfanta malgré tout « le félon » qui devait le
déposer. La première, sortie depuis les années 80 de la sphère privée,
devenue politique sinon politicienne, met en péril la pérennité de son
héritage, ce legs embrouillé et paradoxal que sa descendance, ses
enfants adoptifs, ses enfants naturels, ont du mal aujourd'hui à
expliquer, à justifier, à prolonger.
Jusqu'à quand ces couples attablés à la terrasse d'un grand hôtel
surplombant la baie de Carthage, pourront-ils entonner malicieusement
l'ancien hymne national « Birrouh al Habib, zaïm al
watan » auquel il porte un toast, levant leur verre en direction
d'un palais vacant : « yahya Bourguiba » ?
Nadia Omrane
|

