|
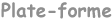



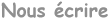

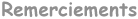
Partager
|
En marge de la conférence des chefs d'État de la FAO.
Comment éviter à la Tunisie d'aller vers une crise alimentaire ?
Entretien avec le Pr. Hassine Dimassi
La Tunisie n'a pas été foudroyée par la crise alimentaire comme certains pays africains (Egypte, Mauritanie,
Maroc et la ville d'Oran ces jours-ci...). On en connaît les causes à l'échelle internationale et leurs
répercussions sur les pays du Sud aux agricultures fragiles : la spéculation autour du prix des céréales,
l'orientation des terres agricoles vers la production pour bioéthanol et la dépendance des agricultures du Sud,
orientées par les institutions financières internationales, bailleurs de fonds, vers les cultures d'exportation,
sont à l'origine du désastre.
La FAO (violement critiquée par le président sénégalais) réunit à Rome du 3 au 6 juin une conférence des chefs
d'État. En marge, nous avons interrogé le Pr. d'économie Hassine Dimassi, autour de la question agraire en Tunisie.
Nos lecteurs identifieront la stratégie de production agroalimentaire mise en oeuvre, ses difficultés et ses
risques.
Sans doute, dans une contribution dans un journal électronique, tout ne pourra être dit mais nous reviendrons sur
certaines pistes ébauchées, particulièrement la question de l'émiettement des terres agricoles, la question de
l'eau qui sera une des priorités à régler et enfin celle de la formation des compétences agronomiques et des
chercheurs.
À ce propos, les solutions envisagées par le Pr. Dimassi nous semblent demeurer dans la logique actuelle, celle
d'une dépendance en matière d'importation céréalière et en aliments pour le bétail. Or, les biotechnologies
végétales ouvrent d'autres perspectives, à l'échelle de la Tunisie dont les chercheurs confirmés pourraient mettre
à profits leurs savoirs et expériences dans un réseau méditerranéen et dans un plus large rayonnement sur
l'Afrique.
Le Japon vient de promettre de doubler d'ici 2015, grâce à une aide financière conséquente, la production de riz en
Afrique. Pure philanthropie ? À voir, car le Japon, très avancé en biotechnologie végétale, ne pourrait-il pas
ainsi expérimenter quelques semences génétiquement modifiées, porteuses d'une plus grande productivité et d'une
meilleure résistance au stress hydrique mais aussi de risques pour la santé ?
Les chercheurs tunisiens outillés peuvent à la fois servir de relais et de vigiles pour ce genre de nouvelles
pratiques agricoles. Il y a là, dans la perspective d'une crise alimentaire mondiale, un champ d'espérance nouvelle
pour peu que l'on demeure dans le cadre d'une agriculture raisonnée et des principes de précautions.
Nous ne terminerons pas cette évocation d'une science agronomique innovante sans une pensée pour le Pr. Mohamed
Marrakchi, généticien et expert en OGM, professeur à la faculté des sciences de Tunis où il forma des promotions de
disciples, qui vient de disparaître.
La Rédaction
Alternatives Citoyennes : Quelles sont les grandes orientations de la politique agricole tunisienne ?
Favorisent-elles ou menacent-elles notre sécurité alimentaire ?
Hassine Dimassi : Vu ses multiples contraintes naturelles (pluviométrie très irrégulière, fertilité
médiocre de la majorité des sols, ...), ou sociales (extrême émiettement des exploitations agricoles, faibles
maîtrise du savoir cultural, ...), l'agriculture tunisienne ne peut pas tenir le coup sans le soutien de l'État.
Or, depuis l'indépendance et jusqu'à nos jours, le comportement de l'État envers l'agriculture a connu trois
principales étapes.
Au cours des années 60, l'État a tenté de prendre entièrement à sa charge, et de façon directe, l'agriculture
tunisienne. C'est dans ce cadre qu'ont été créées les « coopératives de production agricoles » dans le
nord du pays, et les « coopératives de polycultures » dans le centre et le sud. L'objectif de cette
immense réforme des structures agricoles étant de créer des exploitations à dimensions optimales, de moderniser les
méthodes culturales, de diversifier la production agricole, et d'assurer à la majorité des paysans des revenus
stables et convenables. Pour différentes raisons, cette profonde réforme des structures agricoles a lamentablement
échoué, et ce malgré ses nobles objectifs.
Au cours des années 70, l'État a pris aussi entièrement en charge l'agriculture mais de façon plutôt indirecte. En
plus des énormes investissements publics dans l'infrastructure agricole, et en particulier dans l'hydraulique
agricole et les travaux de « conservation des eaux et des sols », l'État subventionnait très largement la
quasi-totalité des intrants agricoles (eau d'irrigation, carburants, semences, engrais chimiques, pesticides et
insecticides, aliments du cheptel). L'État soutenait aussi les investissements des exploitants agricoles privés, en
leurs octroyant d'importantes subventions et crédits bonifiés, tout en les exonérant des impôts. Enfin, l'État
révisait régulièrement à la hausse les prix à la production des principales denrées agricoles en fonction de
l'évolution de leurs coûts de production. Cette politique de l'État s'est répercutée favorablement sur
l'agriculture, et par conséquent sur le monde rural. Le meilleur indicateur de cette réussite résidait dans le
sensible tassement de l'exode rural, par comparaison à d'autres pays similaires.
À partir du début des années 80, et avec l'instauration d'un « Programme d'Ajustement Structurel
Agricole » (ayant d'ailleurs précédé le P.A.S), cette politique de l'État en matière agricole va subir de
radicaux changements. Certes, l'État a continué à fournir de grands efforts dans l'infrastructure agricole. L'État
finançait aussi d'importants programmes de promotion rurale, et en particulier le « Programme de Développement
Rural Intégré ». Toutefois, l'État s'est progressivement désisté de la compensation des intrants agricoles.
Aujourd'hui, sauf rares exceptions, les agriculteurs sont contraints d'acquérir ces intrants à leurs prix du marché
en perpétuel renchérissement. Parallèlement, l'État a eu tendance à geler sur longues périodes les prix à la
production des principales denrées agricoles. À titre d'exemple, le prix à la production d'un quintal de blé dur
est demeuré figé à 26 dinars pendant 3 ans (1992-1994), à 28.5 dinars pendant 4 ans (1996-1999), et à 29.5 dinars
pendant 5 ans (2000-2004). Pire encore, le prix à la production d'un quintal d'orge (denrée essentielle pour
l'élevage) est demeuré inchangé à 15 dinars pendant 6 ans (1990-1995) et à 17 dinars pendant 9 ans (1996-2004). Un
autre exemple non moins significatif est celui du prix plancher de cession aux industriels d'une tonne de tomates.
Ce prix étant resté figé à 70 dinars pendant 5 ans (1989-1993), et à 95 dinars pendant 11 ans (1997-2007).
Cette tendance résulte du fait que la révision à la hausse des prix à la production des denrées agricoles,
accomplie par l'État, ne se fait plus en fonction de l'évolution de leurs coûts de production mais plutôt en
fonction de l'évolution de leurs prix mondiaux. Notons aussi qu'au cours des deux dernières décennies, la plupart
des prix à la production des denrées agricoles, régulés non par l'État mais par le marché, n'ont souvent connu eux
aussi que d'infimes augmentations. Parallèlement, les agriculteurs sont devenus soumis à de lourds prélèvements
fiscaux et parafiscaux. Ces prélèvements se font en majorité à la source, soit par les Offices étatiques,
acquéreurs des produits agricoles, soit par les marchés de gros. Enfin, la plupart des agriculteurs éprouvent
depuis un certain temps de grandes difficultés à accéder aux crédits bancaires (renchérissement des taux d'intérêt,
cumul des impayés, ...).
Le renchérissement des intrants et des crédits agricoles, la très forte décélération des prix à la production des
denrées agricoles, et l'alourdissement de la ponction fiscale, constituent tous des facteurs ayant contribué à
appauvrir sensiblement la majorité des agriculteurs. Toutefois, cet appauvrissement n'apparaît avec sa vraie
ampleur que dans un contexte marqué par deux évènements majeurs : une série d'années successives de disette,
et/ou un renchérissement rapide et excessif des intrants agricoles importés ou produits localement, et en
particulier les aliments du cheptel.
Cette tendance à l'appauvrissement d'un nombre croissant de paysans se reflète à travers au moins trois
indicateurs. D'abord l'exode rural massif qu'a connu le pays durant les dernières années. En effet, au cours du
quinquennat 1999-2004, sept gouvernorats du pays ont subi une baisse absolue de leur population, phénomène jamais
observé auparavant dans la Tunisie indépendante. Il s'agit de gouvernorats qui sont demeurés à dominante agricole,
tels Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kairouan, Tataouine, et Gafsa. Évidemment, cet exode se dirige soit vers
l'étranger, soit vers le littoral Est du pays, où il s'y entasse anarchiquement. Cet appauvrissement des paysans se
dégage aussi à travers le cumul des crédits bancaires impayés, et ce malgré les multiples amnisties dont ont
bénéficié les agriculteurs. Plusieurs de ces paysans n'honorent plus leur dette non parce qu'ils ne veulent pas la
rembourser mais parce qu'ils ne peuvent plus la rembourser. Enfin, l'appauvrissement des paysans se reflète à
travers l'abandon ou la liquidation du patrimoine exploitable. C'est le cas par exemple des minuscules champs non
travaillés, d'une bonne partie des périmètres irrigables non exploités, ou du cheptel bovin reproducteur voué en
masse à la boucherie.
À terme, ces tendances pourraient non seulement perturber gravement la distribution spatiale de la population sur
le territoire national (dépeuplement tragique de certaines régions et surpeuplement intenable d'autres), mais
mettre aussi sérieusement en cause la sécurité alimentaire du pays. Certaines pénuries alimentaires, longtemps
ignorées dans la Tunisie indépendante, commencent déjà à se manifester (pénurie du lait, et bientôt des viandes, et
même des dérivés des céréales).
A.C. : Les importations agricoles grèvent-elles notre balance commerciale, participent-elle à notre
endettement ? L'orientation vers les cultures d'exportations est-elle une réussite ?
H.D. : En termes purement mercantiles, la balance commerciale agroalimentaire de la Tunisie n'a cessé
de s'améliorer. En effet, en matière de produits agroalimentaires (hors produits de la pêche), le taux de
couverture des importations par les exportations est passé de 35% durant la décennie 1977-1986, à 48% durant la
décennie 1987-1996, et 60% durant la décennie 1997-2006. Deux produits ont été à l'origine de l'essentiel de cette
amélioration : les dattes et surtout l'huile d'olive. Les oliviers et les palmiers, plantés en bonne partie
durant les premières décennies de l'indépendance, tendent à atteindre leur âge de pleine production. Actuellement,
la balance commerciale agroalimentaire tunisienne profite donc des louables efforts fournis pendant l'époque où
l'État prenait presque entièrement à sa charge l'agriculture, et ce de façon directe ou indirecte.
Cependant, en termes absolus, le déficit de la balance commerciale agroalimentaire tunisienne s'est démesurément
amplifié. La moyenne annuelle de ce déficit étant passée de 182 millions de dinars durant la décennie 1977-1986, à
367 millions durant la décennie 1987-1996, et 597 millions de dinars durant la décennie 1997-2006.
Structurellement, six produits génèrent à eux seuls 80% de ce déficit : les aliments du cheptel, le blé, les
sous-produits animaux, les huiles végétales, le sucre, et les animaux et produits animaux.
Les importations d'aliments du cheptel (essentiellement l'orge, le maïs et le tourteau de soja) n'ont cessé
d'alourdir le déficit de la balance commerciale agroalimentaire. Ces produits servent à produire les aliments
composés du cheptel (volailles, mais aussi bovins et ovins). Le recours massif des éleveurs (surtout les éleveurs
hors sol) à ce genre d'aliments a été favorisé par leurs prix à l'importation assez modérés, d'une part, et par
leurs larges subventions par l'État, d'autre part. Cependant, depuis le milieu des années 90, les prix de ces
aliments du bétail ne sont plus soutenus par l'État. Par ailleurs, depuis quelques années, les prix à l'importation
de ces produits ont accusé une forte hausse n'ayant cessé de s'accentuer. Cette tendance met en réel danger
l'élevage hors sol du pays, pouvant générer de graves pénuries des viandes rouges, des viandes blanches (principale
source des protéines animales de plusieurs catégories sociales) des oeufs (idem) et du lait et ses dérivés.
Les importations de blé (dur et surtout tendre) n'ont cessé aussi de grever lourdement la balance commerciale
agroalimentaire. Les faibles progrès qu'a connu la production locale de blé n'ont pu compenser la consommation
accrue de cette denrée, voire son pur gaspillage. Le prix mondial du blé est en train de subir une véritable
flambée pouvant perdurer, et générer par conséquent de graves pénuries des dérivés des céréales (couscous, pâtes
alimentaires, et surtout pain).
La balance commerciale des sous-produits animaux (peaux, cuirs, poils, laines) accuse aussi un important déficit
structurel. Cette tendance résulte des besoins croissants du pays en ces produits, d'une part, et de la mauvaise
qualité des sous-produits animaux locaux, d'autre part.
Les importations d'huiles végétales (surtout l'huile de soja) contribuent aussi sensiblement au déficit de la
balance agroalimentaire. Le recours croissant à cette denrée remonte au début de l'indépendance... À cette époque,
la tendance était à l'exportation du maximum d'huile d'olive et à son remplacement par les huiles végétales.
Les importations de sucre pesaient depuis longtemps lourdement sur la balance agroalimentaire. Le déficit accusé
par la balance de ce produit s'est accentué ces dernières années, suite, entre autres, à l'arrêt de la production
locale du sucre de betterave...
Enfin, l'important déficit accusé par la balance « animaux vivants et produits animaux » n'a pu prendre
fin, et ce malgré l'apparente expansion de l'élevage local hors-sol. Les importations en souches reproductrices
(surtout volailles et bovins), en viandes rouges, et en lait et dérivés, sont celles qui génèrent le plus de
déficit au niveau de cette balance.
Globalement, les déficits les plus inquiétants, qui persistent encore à l'échelle de la balance commerciale
agroalimentaire, sont ceux relatifs aux produits de l'élevage (aliments du cheptel, produits et sous-produits
animaux) et aux produits céréaliers. À terme, ces déficits risquent d'atteindre des niveaux intenables, suite à la
raréfaction de ces produits sur le marché mondial.
Le déficit structurel et substantiel de la balance commerciale agroalimentaire contribue évidemment à
l'exacerbation de l'endettement de la Tunisie. Par moments, le déficit de sa balance agroalimentaire est
partiellement comblé par des ressources non négligeables en devises, provenant pour l'essentiel du pétrole, du
tourisme et de l'émigration. Cependant, durant la dernière décennie, le tassement de certaines de ces ressources en
devises (surtout celles provenant du pétrole) a contraint le pays à s'endetter amplement.
Objectivement, la promotion des cultures d'exportation représente pour un pays comme la Tunisie non un choix mais
une nécessité absolue. Dans ce domaine, les seules opportunités potentielles pour notre pays résident dans quatre
cultures : trois méditerranéennes, à savoir l'olivier, la vigne de cave, et les agrumes ; et un d'oasis,
à savoir le palmier dattier. Toutefois, la réussite dans ces quatre cultures suppose plusieurs conditions parfois
très difficiles à réaliser : reconversion d'une bonne partie des sols agricoles alloués actuellement à une
céréaliculture marginale ; remembrement des exploitations excessivement morcelées ; réallocation des
ressources hydrauliques du pays destinées à l'irrigation ; nette amélioration des méthodes culturales à
travers des vraies recherches et vulgarisations ; soutien consistant et régulier de l'État ; révision
radicale de nos accords avec l'Union Européenne concernant les produits agricoles. Donc de très grands chantiers
s'imposent à la Tunisie pour qu'elle puisse dégager un excédent agroalimentaire exportable significatif et durable.
| Produits déficitaires |
Produits excédentaires |
| | Millions de dinars | % | %
cumulé |
| Millions de dinars | % | %
cumulé |
| Aliments du cheptel | 260 | 22% | 22% |
Huile d'olive | 353 | 62% | 62% |
| Blé (tendre et dur) | 258 | 22% | 44% |
Dattes | 88 | 16% | 78% |
| Sous-produits animaux | 152 | 13% | 57% |
Autres | 126 | 22% | 100% |
| Huiles végétales | 113 | 10% | 67% |
| | | |
| Sucre | 111 | 10% | 77% |
| | | |
| Animaux et p.animaux | 47 | 4% | 81% |
| | | |
| Autres | 223 | 19% | 100% |
| | | |
| | | | |
| | | |
| Total | 1 164 | 100% | |
Total | 567 | 100% | |
Soldes de la balance commerciale agroalimentaire (moyenne annuelle de la décennie 1997-2006).
Source : « Annuaires des statistiques agricoles », Ministère de l'agriculture
A.C. : Et actuellement l'État se soucie-t-il véritablement de la condition paysanne ? Quelle est la
part des investissements dans le secteur agricole sur l'ensemble du budget de l'État ?
H.D. : Comme je l'ai signalé plus haut, le comportement de l'État envers la paysannerie a profondément
changé d'une époque à une autre. Durant les années 60, l'État a voulu intégrer durablement les paysans dans des
exploitations agricoles modernes et optimales, et par-là dans le circuit économique. Durant les années 70, l'État a
apporté un soutien incontestable à la paysannerie en subventionnant largement les intrants agricoles, en
actualisant régulièrement à la hausse les prix à la production des denrées agroalimentaires, et en exonérant les
agriculteurs des charges fiscales. Durant les années 70, l'État a contribué aussi, bien que modestement, à
l'amélioration des conditions de vie des ruraux, à travers le « programme de développement rural ». Au
cours des années 80, l'État a su concilier entre l'amélioration du revenu des paysans et leurs conditions de vie,
en instaurant un programme rationnel et efficace : le « programme de développement rural intégré ».
À partir du milieu des années 90, l'État a eu tendance à centrer son effort beaucoup plus sur l'amélioration des
conditions de vie des paysans (à travers entre autres le programme 26-26) que sur l'amélioration de leurs revenus.
Et même plus, la politique de l'État, consistant à libéraliser les prix des intrants agricoles et à geler sur de
longues périodes les prix agricoles à la production, a contribué à laminer sensiblement les revenus paysans.
Autrement dit, durant la dernière décennie, l'État a provoqué un grave étiolement du revenu des paysans, tout en
leur suscitant de nouveaux besoins. Cette politique contradictoire et irrationnelle de l'État a généré, entre
autres, le début d'un dangereux dépeuplement des campagnes tunisiennes.
Par ailleurs, l'intérêt accordé par l'État à l'agriculture est en nette régression. Actuellement, la part de
l'agriculture (y compris la pêche) dans l'ensemble des investissements publics ne dépasse guère 20% contre environ
40% au milieu des années 80. Dans l'avenir, cette tendance risque de s'accentuer, à cause de l'incapacité de l'État
à financer par ses propres moyens des projets de grande envergure, tels les barrages à réservoir.
A.C. : À qui profite la hausse des prix à la consommation, en ce qui concerne les denrées alimentaires,
particulièrement les produits laitiers ?
H.D. : À l'échelle mondiale, cette hausse pourrait profiter aux grandes et moyennes exploitations
agricoles des pays substantiellement excédentaires en produits agroalimentaires (États-Unis, Union Européenne,
Canada, Australie, Brésil, Argentine). Mais cette hausse pourrait profiter surtout aux géantes multinationales
agroalimentaires. Rappelons que l'actuelle terrible flambée des prix des produits alimentaires à l'échelle mondiale
résulte en bonne partie de la spéculation ayant touché ces produits.
En ce qui concerne la Tunisie, la hausse du prix du lait et de ses dérivés, qui n'est qu'à ses débuts, résulte en
premier lieu du très fort renchérissement des aliments du cheptel en bonne partie importés (maïs, orge, tourteau de
soja, et même le son). Toutefois, d'autres facteurs contribuent à cette hausse du prix du lait, voire à une
certaine pénurie de cette denrée : la liquidation désordonnée d'une bonne partie du cheptel bovin
reproducteur ; la fermeture d'un grand nombre des centres de collecte du lait ; l'actualisation au
compte-goutte des prix à la production de cette denrée, ...
S'il est vrai que le consommateur peut s'estimer pénalisé par l'augmentation des prix du lait et des produits
laitiers, c'est donc l'éleveur producteur qui est le plus lésé, ainsi que le collecteur dont la marge bénéficière
n'a pas augmenté.
La vente précipitée des troupeaux dont je viens de parler est un phénomène très grave car il met en jeu la
reproduction du cheptel. Il a eu lieu déjà deux fois en Tunisie une fois pendant les coopératives et une fois sous
le ministère Mzali, qui avait brutalement doublé le prix des céréales alimentaires pour le bétail.
Quant aux prix à la consommation des denrées dérivant des céréales (pâtes, couscous, pain...), on peut s'attendre à
les voir exploser sous peu. En effet, les prix sont réglés et maintenus par la caisse générale de compensation. Or,
celle-ci « n'en peut plus ». Sa charge est aujourd'hui de l'ordre de près d'1 milliard de dinars (soit 4
fois plus qu'en 2003-2004) et si l'on rajoute une charge nouvelle pour l'État de subvention des prix des carburants
de l'ordre de 500 millions de dinars, on peut comprendre que l'État n'a pas prévu une telle facture pour son
budget.
Jusqu'à présent, l'État n'a pris aucune mesure, mais sitôt les négociations avec les partenaires syndicaux conclues
(d'ici la fin juin probablement), l'État, qui redoute jusqu'ici une surenchère dans les revendications salariales
(s'il amoindrit dès à présent les subventions compensatrices des prix des denrées alimentaires), pourrait « se
lâcher » après.
L'été verra sans doute une forte révision à la hausse de ces prix, particulièrement du pain qui absorbe à lui seul
85% de la subvention de la caisse générale de compensation !
A.C. : Il semblerait que lors de la visite du ministre français de l'agriculture en Tunisie (Michel
Barnier, il y a quelques mois), on ait tenté d'encourager, par une aide française, la production de céréales pour
biocarburants, notamment du colza. Pourriez-vous confirmer et dire ce que vous en penser ?
H.D. : Il ne nous manque plus que ça ! Encourager cette petite Tunisie, à terres agricoles
cultivables inextensibles et de mauvaise qualité (4.5 millions d'hectares depuis belle lurette) à consacrer une
partie de ses céréales à la production des biocarburants ! Si tel est le cas, alors d'après ce ministre
français, la Tunisie serait donc en mesure de s'assurer une certaine autonomie en matière d'énergie, en consacrant
une partie de ses terres au colza et similaires (cultures d'huiles végétales et de sous-produits d'alimentation du
cheptel à la fois), et par conséquent à la production de carburants biologiques ! Pourtant, les deux déficits
dramatiques dont souffre la Tunisie relèvent de l'alimentation : les céréales destinées à la consommation
humaine (blé dur et blé tendre) et surtout les aliments du cheptel (maïs, orge, son, tourteau de soja). La priorité
des priorités pour la Tunisie est de s'assurer une certaine sécurité alimentaire, et non une certaine autonomie
envers les grands producteurs du pétrole. L'Union Européenne (et par conséquent la France) ferait mieux d'ouvrir
plus largement ses frontières aux produits agricoles tunisiens (en particulier à ses produits méditerranéens comme
l'huile d'olive, le vin, les oranges maltaises, ...) que de l'inciter à s'orienter vers des objectifs chimériques
comme la production de biocarburants. En rendant son marché plus facilement accessible aux produits agricoles de la
Tunisie, l'Union européenne contribuerait certainement à mieux équilibrer la balance agroalimentaire de ce pays, et
par conséquent à temporiser son déficit alimentaire de plus en plus inquiétant.
A.C. : La Banque Mondiale et le FMI interviennent-ils toujours dans nos choix agricoles et dans quel
sens ?
H.D. : Oui, certainement. D'abord parce que ces deux mastodontes nous tiennent financièrement
constamment par la gorge, du fait qu'ils nous accordent une bonne partie des crédits étrangers en devise. Ces deux
organismes nous dictent aussi aisément leurs directives, à cause de la très faible capacité de négociation de nos
autorités publiques (les pays arabes, et plus particulièrement les pays maghrébins, n'adorent négocier qu'en rangs
dispersés). En fait, en propageant à l'échelle mondiale des programmes standard d'« ajustement
structurel », la Banque Mondiale et le FMI sont devenus, depuis le milieu des années 80, de simples appareils
d'exécution, au service des intérêts des pays capitalistes dominants, et plus précisément au profit des
multinationales agroalimentaires.
En réalité, de graves mesures de politique agricole, imposées par ces deux organismes (et avec eux l'OMC depuis une
décennie), trouvent leur origine dans des événements majeurs lointains. L'une des plus graves de ces mesures
consistait à contraindre la plupart des pays du monde à aligner les prix à la production de leurs denrées
agroalimentaires non sur les coûts de production locaux (coûts prenant en considération les spécificités de chaque
pays), mais sur les prix mondiaux de ces denrées. Cette mesure répondait aux intérêts des quelques pays à forts
excédents alimentaires, et en particulier les États-Unis et l'Union Européenne.
Jusqu'au début des années 30 du XXe siècle, les États-Unis pratiquaient dans leurs « Grandes Plaines »
une céréaliculture extensive, selon la méthode culturale dite dry-farming (culture en sec selon un
assolement biennal : blé jachère). Cette méthode avait de graves inconvénients : faible usage du sol,
faibles rendements, et surtout érosion excessive des terres agricoles. Avec la « Grande Crise » des
années 30, le président américain de l'époque, Roosevelt, a opté pour un New Deal (la nouvelle donne),
visant, entre autres, à promouvoir les grands chantiers de travaux publics, afin de temporiser le fléau du chômage.
La mise en valeur du bassin du Tennessee (équipement hydroélectrique, irrigation, lutte contre l'érosion,
développement industriel, ...) fut l'une des plus grandioses réalisations de ces travaux publics. Les énormes
quantités d'eaux mobilisées par ces travaux ont favorisé une rapide expansion des cultures intensives irriguées,
basées sur un assolement triennal : blé, maïs, soja. Cette nouvelle méthode culturale a révolutionné
l'agriculture américaine : exploitation optimale des sols, protection des terres contre la désertification,
diversification de la production, expansion de l'élevage, et surtout nette amélioration des rendements. Cependant,
cette nouvelle méthode culturale a généré le cumul d'énormes stocks de produits alimentaires aux États-Unis (blé
mais aussi maïs, huile de soja, tourteau de soja, viandes, lait, beurre, ...). À l'époque, les États-Unis étaient
donc contraints non seulement de se débarrasser d'une partie de ces stocks alimentaires, surtout sous forme de dons
dans le cadre de la fameuse PL 480 (Public Law 480), mais aussi de concevoir de nouveaux types d'élevage,
consommant en grandes quantités les nouveaux aliments du cheptel (orge, maïs, tourteau de soja). C'est donc dans ce
contexte qu'a vu le jour le poulet industriel.
À partir du début des années 60, l'Union européenne a décidé de révolutionner à son tour son agriculture. La mise
en place d'une « politique agricole commune » (la PAC), accordant aux agriculteurs de larges subventions,
et assurant à ces agriculteurs des prix à la production stables et rémunérateurs, a contribué à bouleverser
radicalement l'agriculture européenne : meilleur usage des sols, diversification de la production, forte
expansion de l'élevage, nette amélioration des rendements. À l'instar de ce qui s'est passé aux États-Unis à partir
des années 40, cette PAC a généré en Union européenne à partir des années 70 d'ingérables stocks de produits
alimentaires (surtout céréales et produits animaux tels que viandes, lait, beurre, ... ).
Afin de se débarrasser de leurs énormes excédents en denrées agroalimentaires, les États-Unis et l'Union européenne
(et avec eux quelques autres pays, comme le Canada, l'Australie, le Brésil, et l'Argentine) n'ont cessé de
subventionner ces denrées, non seulement pour les produire mais aussi pour les exporter. Les États-Unis et l'Union
européenne n'ont cessé aussi de diffuser à une échelle mondiale des normes de consommation alimentaire : le
pain de boulangerie et le poulet industriel, et dans une moindre mesure l'oeuf industriel et le lait et ses
dérivés. Parallèlement, ces deux pôles dominants n'ont cessé de décourager, par l'intermédiaire du FMI, de l'OMC et
de la Banque Mondiale, la production de ces denrées standard dans les pays dominés (appel à la suppression des
subventions des intrants et à l'alignement des prix à la production locale sur les prix mondiaux).
A.C. : Au vu des exemples de la grave crise subie par des pays voisins et des risques pour notre propre
pays, quelles solutions devraient être mises en oeuvre ?
H.D. : Dans l'agriculture, comme dans l'enseignement, les erreurs stratégiques sont très difficiles à
corriger rapidement. Exemple : le processus de dépeuplement des campagnes n'est pas facile à renverser, même
si de courageuses réformes ont été entreprises.
Cependant, afin de minimiser les dégâts en perspective en matière alimentaire, il est nécessaire de manoeuvrer très
subtilement à court terme : maintenir à un niveau acceptable la subvention des produits alimentaires de base
(le pain, l'huile, le poulet, et la pastèque, qui constituent les quatre colonnes de l'alimentation des masses
populaires) ; approvisionner suffisamment le marché local en produits agroalimentaires, afin de neutraliser
les fléaux de spéculation ; arrêter la liquidation anarchique du patrimoine agricole, et plus particulièrement
du cheptel reproducteur. À moyen et long termes, d'autres réformes de structures, dont nous avons parlé plus haut,
s'imposent.
A.C. : Les statistiques donnent 42 mois d'attente aux ingénieurs agronomes avant de trouver un emploi, et
nombre d'entre eux sont obligés de se reconvertir. Les concours ouverts dans ce secteur offrent un poste pour des
dizaines de candidats. L'État ne délaisse-t-il pas ce secteur qui pourrait être pourvoyeur d'emploi ?
H.D. : Remarquons d'abord que la formation agricole en Tunisie demeure faible par comparaison au poids
de l'agriculture dans l'économie nationale (environ 12% du PIB). En 2006, les institutions d'enseignement supérieur
en lien avec l'agriculture ne comportaient que 5 720 étudiants, soit à peine 1.8% du total des étudiants
contre 3.5% en 1986. Dans la formation agricole de base, les effectifs d'élèves inscrits ont subi une importante
régression : 875 élèves en 2006 contre 1 715 en 1986 pour le « certificat d'aptitude professionnelle
agricole », et 95 élèves en 2006 contre 540 en 1986 pour le « brevet technique professionnel
agricole ».
Cette tendance à la marginalisation de la formation agricole s'explique par trois facteurs essentiels : la
saturation des besoins de l'État, l'étroitesse de la majorité des exploitations agricoles privées, et la
dévalorisation des diplômes de l'enseignement agricole.
L'État devrait assurer une solide formation agricole à tous les niveaux, mais il n'est pas tenu de recruter tous
les sortants de l'enseignement agricole. La formation agricole est faite pour mieux exploiter la terre et non pour
somnoler dans les bureaux. En 2006, le budget de fonctionnement du ministère de l'Agriculture a absorbé 230
millions de dinars, soit 3.2% du total du budget de fonctionnement de l'État. C'est déjà largement suffisant.
Pendant l'époque coloniale, les ingénieurs sortants de l'« École Coloniale Agricole » (actuel INAT) ne
recevaient effectivement leur diplôme qu'après avoir créé une consistante exploitation agricole (avec l'appui
foncier et financier de l'État), et y avoir séjourné pendant au moins 5 ans. L'État de l'indépendance disposait de
800 000 hectares de meilleures terres agricoles du pays avec lesquelles il aurait pu enfanter une réelle élite
d'exploitants agricoles. Malheureusement, la plupart des ingénieurs et techniciens supérieurs n'ont servi qu'à
peupler inutilement les bureaux. De la France, on ne retient que les mauvaises habitudes, mais pas les
bonnes !
A.C. : La France n'accorde que 1.5% de ses investissements directs en Tunisie, au secteur agricole. D'un
autre côté, la recherche en biotechnologie végétale patine, faute de moyens. Des pays comme le Japon et la France
financent cette recherche non par philanthropie mais pour mieux exploiter la biodiversité. Ne pensez-vous pas que
dans le projet d'Union pour la Méditerranée un réel partenariat entre la France et la rive Sud devrait réorienter
ce schéma de financement vers un véritable transfert technologique ?
H.D. : D'abord il ne faut pas confondre entre les investissements directs qui sont l'affaire des
privés, et le financement de la recherche qui est l'affaire de l'État.
Ensuite, en matière de recherche biotechnologique ou autres, l'État est tenu de tracer la voie stratégique. Les
sources de financement (d'ailleurs nombreuses et multiples) suivront. En effet, en Tunisie, le problème de la
recherche scientifique en général, et de la recherche agronomique en particulier, n'est pas un problème de
financement. Trop d'argent y est disponible pour la recherche, et en partie non utilisé. En réalité, la recherche
scientifique tunisienne souffre dramatiquement de quatre maux chroniques : la discontinuité des programmes de
recherche ; le peuplement des centres de recherches par les cadres « mis au frigo » ; le
copinage et l'affairisme ; et surtout la perpétuelle rupture entre le monde de la recherche et le monde
professionnel. Des milliers d'études, de rapports, d'articles, de thèses, ou de mémoires, somnolent dans les
tiroirs et casiers ; et personne n'y prête attention. On piétine et on reprend toujours de zéro. Donc, ce
n'est pas le peu d'appui logistique et financier de la France qui va résoudre le problème.
A.C. : Nous venons de fêter le 44e anniversaire de la nationalisation des terres agricoles (12 mai 1964).
Est-ce là le dernier pré carré de notre indépendance ?
H.D. : Notons que la nationalisation des terres des colons en mai 1964 s'est avérée avec du recul une
grande erreur stratégique : l'État récupéra brutalement et avec précipitation des centaines de milliers
d'hectares de bonnes terres agricoles pour les confier en gestion à une bureaucratie inexpérimentée (directeurs
administratifs, et même parfois gouverneurs !) au lieu de les céder progressivement à des véritables
entrepreneurs agronomes.
Passons. Et rappelons, qu'en Tunisie, la stratégie agricole a manqué d'une dimension essentielle et
fondamentale : la dimension temps. En effet, cette stratégie a subi depuis l'indépendance au moins trois
changements, et ce en fonction de l'humeur des dirigeants politiques du moment, et surtout en fonction des intérêts
des pays dominants.
En termes d'indépendance, ou plutôt d'autonomie, alimentaire, la Tunisie a réussi jusqu'à présent le hors-d'oeuvre
et le dessert (le maraîchage et l'arboriculture fruitière), mais elle a raté le plat de résistance (céréales et
viandes). Renverser cette vapeur n'est nullement une mince tâche. L'alternative n'est pas de mettre le paquet sur
ces deux produits. Nos potentialités naturelles et humaines ne le permettent pas. La terre procure chez nous 15
quintaux de blé à l'hectare contre 55 en Europe. Le rendement de la laitière de race pure ne dépasse guère chez
nous 5 000 litres par an contre 12 000 en Europe. L'alternative serait donc de maximiser nos excédents en
produits méditerranéens (huile d'olive, vin, agrumes, et dattes) afin de pouvoir faire face aisément à nos déficits
en viandes et céréales.
Entretien conduit par Nadia Omrane. 3 juin 2008
|

